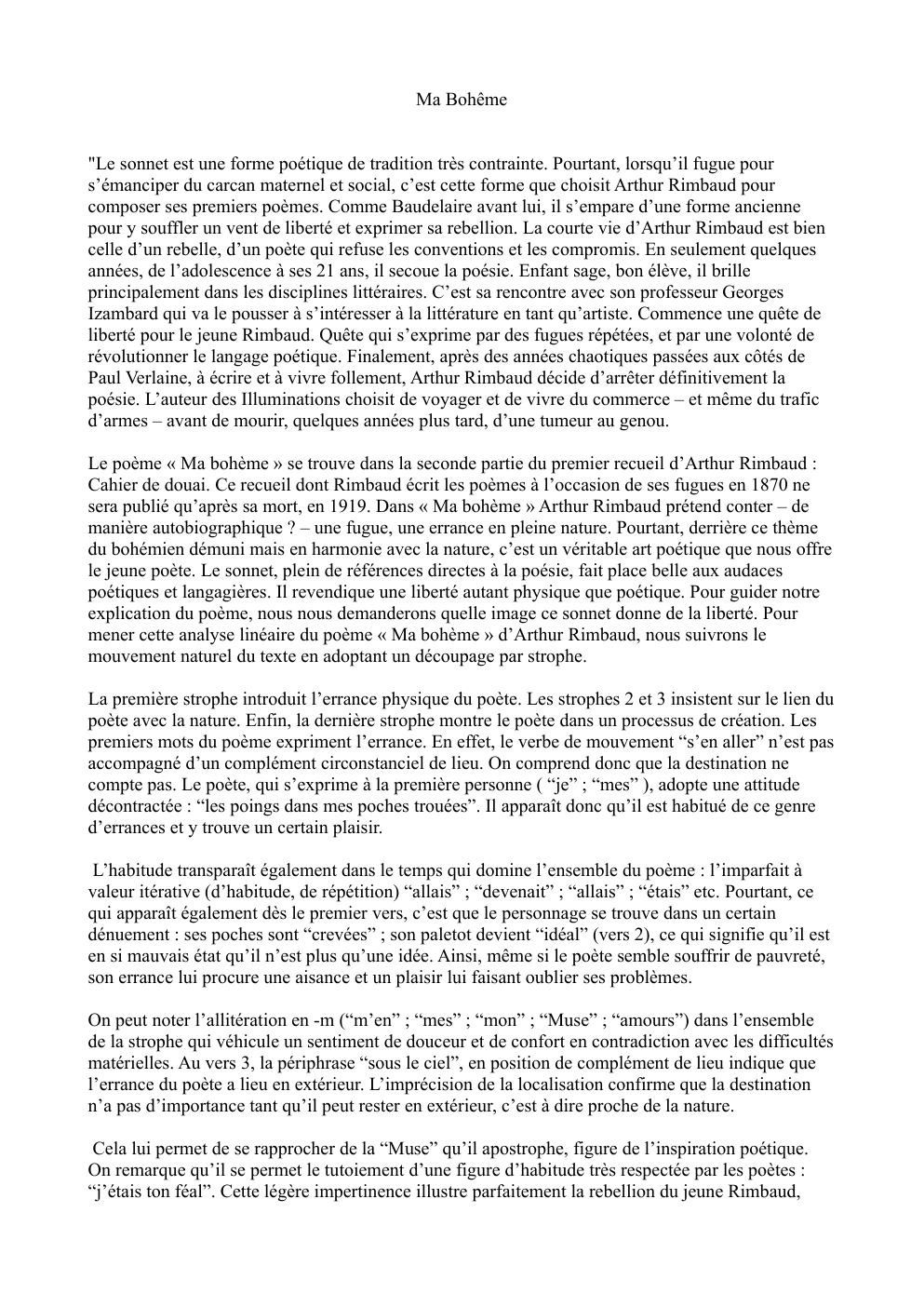Ma bohême: commentaire
Publié le 07/02/2025
Extrait du document
«
Ma Bohême
"Le sonnet est une forme poétique de tradition très contrainte.
Pourtant, lorsqu’il fugue pour
s’émanciper du carcan maternel et social, c’est cette forme que choisit Arthur Rimbaud pour
composer ses premiers poèmes.
Comme Baudelaire avant lui, il s’empare d’une forme ancienne
pour y souffler un vent de liberté et exprimer sa rebellion.
La courte vie d’Arthur Rimbaud est bien
celle d’un rebelle, d’un poète qui refuse les conventions et les compromis.
En seulement quelques
années, de l’adolescence à ses 21 ans, il secoue la poésie.
Enfant sage, bon élève, il brille
principalement dans les disciplines littéraires.
C’est sa rencontre avec son professeur Georges
Izambard qui va le pousser à s’intéresser à la littérature en tant qu’artiste.
Commence une quête de
liberté pour le jeune Rimbaud.
Quête qui s’exprime par des fugues répétées, et par une volonté de
révolutionner le langage poétique.
Finalement, après des années chaotiques passées aux côtés de
Paul Verlaine, à écrire et à vivre follement, Arthur Rimbaud décide d’arrêter définitivement la
poésie.
L’auteur des Illuminations choisit de voyager et de vivre du commerce – et même du trafic
d’armes – avant de mourir, quelques années plus tard, d’une tumeur au genou.
Le poème « Ma bohème » se trouve dans la seconde partie du premier recueil d’Arthur Rimbaud :
Cahier de douai.
Ce recueil dont Rimbaud écrit les poèmes à l’occasion de ses fugues en 1870 ne
sera publié qu’après sa mort, en 1919.
Dans « Ma bohème » Arthur Rimbaud prétend conter – de
manière autobiographique ? – une fugue, une errance en pleine nature.
Pourtant, derrière ce thème
du bohémien démuni mais en harmonie avec la nature, c’est un véritable art poétique que nous offre
le jeune poète.
Le sonnet, plein de références directes à la poésie, fait place belle aux audaces
poétiques et langagières.
Il revendique une liberté autant physique que poétique.
Pour guider notre
explication du poème, nous nous demanderons quelle image ce sonnet donne de la liberté.
Pour
mener cette analyse linéaire du poème « Ma bohème » d’Arthur Rimbaud, nous suivrons le
mouvement naturel du texte en adoptant un découpage par strophe.
La première strophe introduit l’errance physique du poète.
Les strophes 2 et 3 insistent sur le lien du
poète avec la nature.
Enfin, la dernière strophe montre le poète dans un processus de création.
Les
premiers mots du poème expriment l’errance.
En effet, le verbe de mouvement “s’en aller” n’est pas
accompagné d’un complément circonstanciel de lieu.
On comprend donc que la destination ne
compte pas.
Le poète, qui s’exprime à la première personne ( “je” ; “mes” ), adopte une attitude
décontractée : “les poings dans mes poches trouées”.
Il apparaît donc qu’il est habitué de ce genre
d’errances et y trouve un certain plaisir.
L’habitude transparaît également dans le temps qui domine l’ensemble du poème : l’imparfait à
valeur itérative (d’habitude, de répétition) “allais” ; “devenait” ; “allais” ; “étais” etc.
Pourtant, ce
qui apparaît également dès le premier vers, c’est que le personnage se trouve dans un certain
dénuement : ses poches sont “crevées” ; son paletot devient “idéal” (vers 2), ce qui signifie qu’il est
en si mauvais état qu’il n’est plus qu’une idée.
Ainsi, même si le poète semble souffrir de pauvreté,
son errance lui procure une aisance et un plaisir lui faisant oublier ses problèmes.
On peut noter l’allitération en -m (“m’en” ; “mes” ; “mon” ; “Muse” ; “amours”) dans l’ensemble
de la strophe qui véhicule un sentiment de douceur et de confort en contradiction avec les difficultés
matérielles.
Au vers 3, la périphrase “sous le ciel”, en position de complément de lieu indique que
l’errance du poète a lieu en extérieur.
L’imprécision de la localisation confirme que la destination
n’a pas d’importance tant qu’il peut rester en extérieur, c’est à dire proche de la nature.
Cela lui permet de se rapprocher de la “Muse” qu’il apostrophe, figure de l’inspiration poétique.
On remarque qu’il se permet le tutoiement d’une figure d’habitude très respectée par les poètes :
“j’étais ton féal”.
Cette légère impertinence illustre parfaitement la rebellion du jeune Rimbaud,
mais également la relation privilégiée qu’il noue avec la poésie.
Ce tutoiement peut également être
lu comme une forme d’allégresse due à la jeunesse du poète.
Cette lecture se confirme grâce aux
exclamations du vers suivant : “Oh ! là là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !” On voit très bien
que le personnage / poète se laisse emporter par sa fougue et le bonheur qu’il ressent à errer
librement dans la nature.
Autre phénomène intéressant, dans la strophe 1 ainsi que dans la strophe 2, les auxiliaire être et
avoir s’entrecroisent : “j’étais ton féal” (v.3) / “avait un large trou” (v.5) ; “Mon auberge était à la
Grande-Ourse” (v.7) / “avaient un doux frou-frou” (v.8).
On peut penser que le poète veut montrer
qu’être est plus important qu’avoir.
Donc qu’il préfère vivre libre dans le dénuement, qu’opprimé
dans l’opulence.
Enfin, observons les deux mots à la rime des vers 1 et 4 : “crevées” / “rêvées”.
On
peut comprendre ici que le pouvoir de l’imagination remplace les contraintes matérielles.
En effet, ses “poches crevées” sont remplacées par des “amours splendides (…) rêvées” Ainsi dans
cette strophe, le poète nous livre l’image d’un personnage pauvre, mais heureux dans la simplicité
et la liberté de son errance.
Le premier vers de la seconde strophe vient confirmer cette pauvreté
matérielle : “mon unique culotte avait un large trou”.
D’une part le personnage ne possède qu’une
“unique culotte” qui d’autre part est trouée.
La métaphore du “Petit-Poucet rêveur” au vers suivant est intéressante car elle permet de filer le
thème de la pauvreté (le Petit-Poucet est issu d’une famille pauvre) tout en introduisant l’idée que la
poésie est son guide.
Dans le conte original, le Petit-Poucet sème des miettes de pain pour retrouver
son chemin.
Ici, le poète laisse derrière lui “des rimes”.
Il insiste sur cet élément en le plaçant au
centre du poème (vers 7 sur 14) et en le rejetant grâce à un procédé d’enjambement.
Donc, comme
le Petit-Poucet, Rimbaud aurait fui sa famille.
Mais il laisse derrière lui quelque chose de bien plus
durable que des miettes de pain : de la poésie.
On retrouve dans cette strophe l’idée d’euphorie et
d’allégresse introduite dans la première strophe.
En effet, le poète évoque sa “course”, comme s’il courait sans but.
La métaphore du vers 3 “Mon
auberge était à la Grande-Ourse” suggère qu’il dort à la belle étoile.
Il renforce ainsi à la fois le
sentiment de liberté et l’idée de pauvreté.
Cependant, le fait de dormir dehors lui permet surtout de
trouver l’inspiration poétique.
Il voit naître des correspondances entre les sens en s’appropriant la
nature : “Mes étoiles”, ici le pronom possessif de première personne montre qu’il se sent en
harmonie avec le ciel.
Le fait qu’il évoque les étoiles normalement perçues avec la vue grâce au
toucher (“un doux frou-frou”) montre qu’il est capable de s’approprier la nature, et surtout de
percevoir et ressentir les choses différemment.
C’est pour lui le propre du poète, la création de
correspondances entre les sens et l’expression grâce au langage écrit d’une perception unique des
choses.
La troisième strophe démarre en continuité directe de la deuxième.
Il s’agit de la même
phrase, connectée par une conjonction de coordination : “Et je les écoutais”.
Ainsi, Rimbaud
poursuit sa déconstruction du sonnet classique tout en confirmant la correspondance des sens.
En
effet, il affirme écouter les étoiles, après les avoir touchées.
L’attitude du poète (“assis au bord des
routes”) est très évocatrice.
On l’imagine tout à fait “écouter” les étoiles, un carnet en main, pour
retranscrire ses émotions et sentiments sous la forme de poèmes.
Au vers suivant, l’adjectif
mélioratif “bon” insiste sur le bonheur du poète.
Il est heureux dans la simplicité de sa situation.
La
précision temporelle du mois de “septembre” permet de relier le poème....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire sur "Ma Bohême"_ Rimbaud
- Bernard Lahire Commentaire
- Droit public des biens - Commentaire d’arrêt Conseil d'Etat, 18 septembre 2015, société Prest’Air req. N° 387315
- COMMENTAIRE DE TEXTE (concours administratifs)
- Commentaire sur Salluste, La Conjuration de Catilina (XX, 3-17)