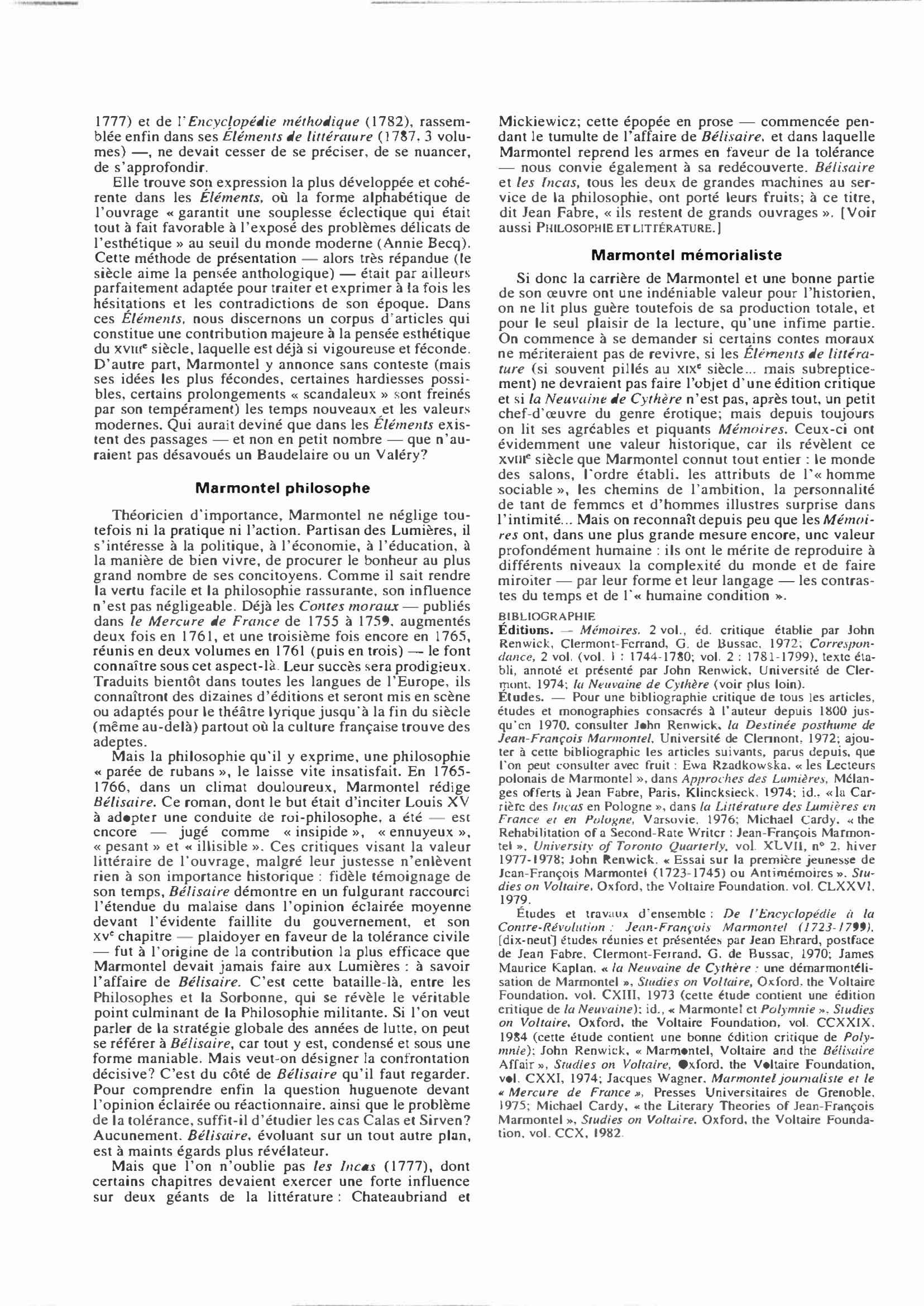MARMONTEL Jean-François
Publié le 26/11/2018

Extrait du document
«
1777)
et de l'Encyclopédie méthodique ( 1782), rassem
blée enfin dans ses Éléments de littérature ( 1787, 3 volu
mes) -, ne devait cesser de se préciser, de se nuancer,
de s'approfondir.
Elle trouve SO_!l expression la plus développée et cohé
rente dans les Eléments, où la forme alphabétique de
l'ouvrage «garantit une souplesse éclectique qui était
tout à fait favorable à l'exposé des problèmes délicats de
l'esthétique » au seuil du monde moderne (Annie Becq).
Cette méthode de présentation -alors très répandue (le
siècle aime la pensée anthologique) -était par a.illeurs
parfaitement adaptée pour traiter et exprimer à la fois les
hésitations et les contradictions de son époque.
Dans
ces Éléments, nous discernons un corpus d'articles qui
constitue une contribution majeure à la pensée esthétique
du XVllle siècle, laquelle est déjà si vigoureuse et féconde.
D'autre part, Marmontel y annonce sans conteste (mais
ses idées les plus fécondes, certaines hardiesses possi
bles, certains prolongements « scandaleux » sont freinés
par son tempérament) les temps nouveaux ,et les valeurs
modernes.
Qui aurait deviné que dans les Eléments exis
tent des passages -et non en petit nombre -que n'au
raient pas désavoués un Baudelaire ou un Valéry?
Marmontel philosophe
Théoricien d'importance, Marmontel ne néglige tou
tefois ni la pratique ni l'action.
Partisan des Lumières, il
s'intéresse à la politique, à l'économie, à l'éducation, à
la manière de bien vivre, de procurer le bonheur au plus
grand nombre de ses concitoyens.
Comme il sait rendre
la vertu facile ct la philosophie rassurante, son influence
n'est pas négligeable.
Déjà les Contes moraux- publiés
dans le Mercure de France de 1755 à 1759, augmentés
deux fois en 1761, et une troisième fois encore en 1765,
réunis en deux volumes en 1761 (puis en trois)-le font
connaître sous cet aspect-là.
Leur succès sera prodigieux.
Traduits bientôt dans toutes les langues de l'Europe.
ils
connaîtront des dizaines d'éditions et seront mis en scène
ou adaptés pour le théâtre lyrique jusqu"à la fin du siècle
(même au-delà) partout où la culture française trouve des
adeptes.
Mais la philosophie qu'il y exprime, une philosophie
«parée de rubans », le laisse vite insatisfait.
En 1765-
1766, dans un climat douloureux, Marmontel rédige
Bélisaire.
Ce roman, dont le but était d'inciter Louis XV
à ad opt er une conduite de roi-philosophe, a été - est
encore -jugé comme « insipide », «ennuyeux »,
«pesant» et «illisible».
Ces critiques visant la valeur
littéraire de l'ouvrage, malgré leur justesse n'enlèvent
rien à son importance historique : fidèle témoignage de
son temps, Bélisaire démontre en un fulgurant raccourci
l'étendue du malaise dans l'opinion éclairée moyenne
devant l'évidente faillite du gouvernement, et son
xve chapitre -plaidoyer en faveur de la tolérance civile
-fut à l'origine de la contribution la plus efficace que
Marmontel devait jamais faire aux Lumières : à savoir
l'affaire de Bélisaire.
C'est cette bataille-là, entre les
Philosophes et la Sorbonne, qui se révèle le véritable
point culminant de la Philosophie militante.
Si l'on veut
parler de la stratégie globale des années de lutte, on peut
se référer à Bélisaire, car tout y est, condensé et sous une
forme maniable.
Mais veut-on désigner la confrontation
décisive? C'est du côté de Bélisaire qu'il faut regarder.
Pour comprendre enfin la question huguenote devant
l'opinion éclairée ou réactionnaire, ainsi que le problème
de la tolérance, suffit-il d'étudier les cas Calas et Sirven?
Aucunement.
Bélisaire, évoluant sur un tout autre plan,
est à maints égards plus révélateur.
Mais que l'on n'oublie pas les Incas (1777), dont
certains chapitres devaient exercer une forte influence
sur deux géants de la littérature : Chateaubriand et Mickiewicz;
cette épopée en prose -commencée pen
dant le tumulte de l'affaire de Bélisaire, et dans laquelle
Marmontel reprend les armes en faveur de la tolérance
- nous convie également à sa redécouverte.
Bélisaire
et les Incas, tous les deux de grandes machines au ser
vice de la philosophie, ont porté leurs fruits; à ce titre,
dit Jean Fabre, «ils restent de grands ouvrages».
[Voir
aussi PHILOSOP HlE ET LITTÉRATURE.
]
Marmontel mémorialiste
Si donc la carrière de Marmontel et une bonne partie
de son œuvre ont une indéniable valeur pour l'historien,
on ne lit plus guère toutefois de sa production totale, et
pour le seul plaisir de la lecture, qu'une infime partie.
On commence à se demander si certains contes moraux
ne mériteraient pas de revivre, si les Éléments de li ttér a
ture (si souvent pillés au XIXe siècle ...
mais subreptice
ment) ne devraient pas faire l'objet d'une édition critique
et si la Neuvaine de Cythè re n'est pas, après tout, un petit
chef-d'œuvre du genre érotique; mais depuis toujours
on lit ses agréables et piquants Mémoires.
Ceux-ci ont
évidemment une valeur historique, car ils révèlent ce
xvme siècle que Marmontel connut tout entier : le monde
des salons, l'ordre établi, les attributs de l'« homme
sociable», les chemins de l'ambition, la personnalité
de tant de femmes et d'hommes illustres surprise dans
l'intimité ...
Mais on reconnaît depuis peu que les Mémoi
re s ont, dans une plus grande mesure encore, une valeur
profondément humaine: ils ont le mérite de reproduire à
différents niveaux la complexité du monde et de faire
miroiter -par leur forme et leur langage -les contras
tes du temps et de 1' « humaine condition >>.
BIBLIOGRAPHIE
É dit ion s.
- Mémoires.
2 vol., éd.
critique établie par John
Renwick, Clermont- Ferr and, G.
de Bussac.
1972; Correspon
dance.
2 vol.
(vol.
1 : 1744-1780; vol.
2 : 178 a -1799), te x te éta
bli, annoté el présenté par John Renwick, Université de Cler
mont.
1974; la Neuvaine de Cythère (voir plus loin).
É tu des .
- Pour une bibliographie critique de tous les articles,
études et monographies consacrés à r auteur depuis 1800 jus
qu 'e n 1970.
consulter John Renwick, la Destinée posthume de
Jean-François Marmomel.
Université de Clennont, 1972; ajou
ter à celle bibliographie les articles suivants, parus depu is , que
l"on peut consulter avec fruit: Ewa Rzadkowska.
, dans la Lillérature des Lumières en
France et en Pologne, Vars ovie .
1976; Michael Cardy.
«the
RehabiUtation of a Second-Rate Writcr: Jean-François Marmo n
tel>>.
University of Toronto Quarter/y, vol.
XLVII, n° 2, hiver
1977-1978; John Renwick.
«Essai sur la première jeunesse de
Jean-François Marmontel (1723-1745) ou Antimémoires ».
Stu
dies on Voltaire.
Oxford, the Voltaire Foundation, vol.
CLXXVI.
1979.
Études et tra vaux d'ensemble: De l'Encyclopédie à la
Conrre-Rt!volution : Jean-François Marmontel (1723-1799 ).
(dix-neutl études réunies et présentées par Jean Ehrard, postface
de Jean Fabre.
Clermont-Ferrand, G.
de Bussac, 1970; James
Maurice Kaplan.
« la Neuvaine de Cythère : une démarmontéli
sation de Marmontel », Studies on Voltaire, Oxford, the Voltaire
Foundation.
vol.
CXIII, 1973 (cette étude contient une édition
critique de la Neuvaine): id., « Marmontel ct Polymnie "• Sru d ies
on Voltaire.
Oxford, the Voltaire Foundation, vol.
CCXXIX,
1984 (cette étude contient une bonne édition critique de Poly
mnie); John Renwick, «Marmontel, Voltaire and the Bélisaire
A ff a ir >>, Studi es on Voltaire, Oxford.
the Voltaire Foundation,
vol.
CXXI, 1974; Jacques Wagner.
Marmontel jounzaliste et le
«Mercure de France», Presses Universitaires de Greno ble .
1975; Michael Cardy, ,, the Litcrary Theories of Jean-François
Marmontel >>, Studies on Vo/wire.
Oxford, the Voltaire Founda
tion, vol.
CCX, 1982..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- INCAS OU LA DESTRUCTION DE L’EMPIRE DU PÉROU (Les) de Jean-François Marmontel (résumé & analyse)
- Marmontel Jean François , 1723-1799, né à Bort-les-Orgues (Corrèze), écrivain français.
- Marmontel, Jean-François - écrivain.
- Marmontel, Jean-François - littérature.
- Bernis, cardinal de La Caille, abbé Nicolas Louis de Marmontel, Jean-François