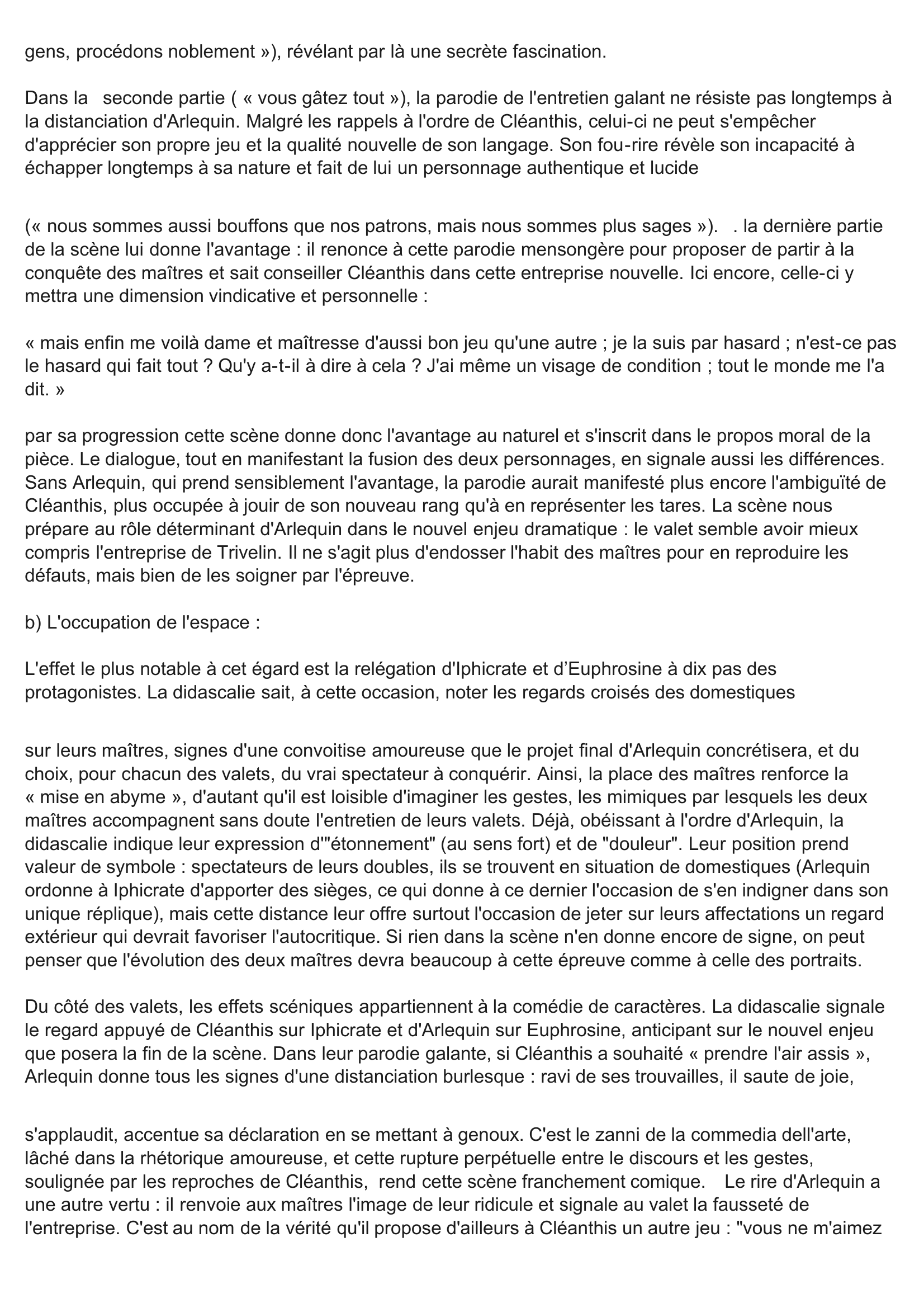Molière (Jean-Baptiste Poquelin) Marivaux Scène 6 Et 11
Publié le 08/01/2013

Extrait du document

2. Arlequin est ici le meneur de jeu : engageant Cléanthis à pardonner sans rancoeur, il dégage la leçon
morale : "quand on se repent, on est bon ; et quand on est bon, on est aussi avancé que nous." Inversée
par l'épreuve, l'inégalité sociale ne se rétablit pas vraiment. La phrase d'Arlequin considère la seule
dignité qui vaille, celle du coeur.
3. La surprise de Cléanthis au début de la scène, le réquisitoire qu'elle adresse aux maîtres laissent le
spectateur en suspens, lui faisant douter jusqu'au bout de sa capacité à pardonner.
4. La contrition d'Euphrosine abolit sa qualité de maîtresse. Sa réplique finale promet à Cléanthis une
condition fraternelle.
5. La tirade de Cléanthis marque la supériorité du valet dans la maîtrise du langage. Adressé à des
maîtres silencieux, son discours est marqué par une fonction impressive lourde de reproches : questions
rhétoriques, effets dilatoires, formes sentencieuses.

«
gens, procédons noblement »), révélant par là une secrète fascination.
Dans la seconde partie ( « vous gâtez tout »), la parodie de l'entretien galant ne résiste pas longtemps à
la distanciation d'Arlequin.
Malgré les rappels à l'ordre de Cléanthis, celui-ci ne peut s'empêcher
d'apprécier son propre jeu et la qualité nouvelle de son langage.
Son fou-rire révèle son incapacité à
échapper longtemps à sa nature et fait de lui un personnage authentique et lucide
(« nous sommes aussi bouffons que nos patrons, mais nous sommes plus sages »)..
la dernière partie
de la scène lui donne l'avantage : il renonce à cette parodie mensongère pour proposer de partir à la
conquête des maîtres et sait conseiller Cléanthis dans cette entreprise nouvelle.
Ici encore, celle-ci y
mettra une dimension vindicative et personnelle :
« mais enfin me voilà dame et maîtresse d'aussi bon jeu qu'une autre ; je la suis par hasard ; n'est-ce pas
le hasard qui fait tout ? Qu'y a-t-il à dire à cela ? J'ai même un visage de condition ; tout le monde me l'a
dit.
»
par sa progression cette scène donne donc l'avantage au naturel et s'inscrit dans le propos moral de la
pièce.
Le dialogue, tout en manifestant la fusion des deux personnages, en signale aussi les différences.
Sans Arlequin, qui prend sensiblement l'avantage, la parodie aurait manifesté plus encore l'ambiguïté de
Cléanthis, plus occupée à jouir de son nouveau rang qu'à en représenter les tares.
La scène nous
prépare au rôle déterminant d'Arlequin dans le nouvel enjeu dramatique : le valet semble avoir mieux
compris l'entreprise de Trivelin.
Il ne s'agit plus d'endosser l'habit des maîtres pour en reproduire les
défauts, mais bien de les soigner par l'épreuve.
b) L'occupation de l'espace :
L'effet le plus notable à cet égard est la relégation d'Iphicrate et d’Euphrosine à dix pas des
protagonistes.
La didascalie sait, à cette occasion, noter les regards croisés des domestiques
sur leurs maîtres, signes d'une convoitise amoureuse que le projet final d'Arlequin concrétisera, et du
choix, pour chacun des valets, du vrai spectateur à conquérir.
Ainsi, la place des maîtres renforce la
« mise en abyme », d'autant qu'il est loisible d'imaginer les gestes, les mimiques par lesquels les deux
maîtres accompagnent sans doute l'entretien de leurs valets.
Déjà, obéissant à l'ordre d'Arlequin, la
didascalie indique leur expression d'"étonnement" (au sens fort) et de "douleur".
Leur position prend
valeur de symbole : spectateurs de leurs doubles, ils se trouvent en situation de domestiques (Arlequin
ordonne à Iphicrate d'apporter des sièges, ce qui donne à ce dernier l'occasion de s'en indigner dans son
unique réplique), mais cette distance leur offre surtout l'occasion de jeter sur leurs affectations un regard
extérieur qui devrait favoriser l'autocritique.
Si rien dans la scène n'en donne encore de signe, on peut
penser que l'évolution des deux maîtres devra beaucoup à cette épreuve comme à celle des portraits.
Du côté des valets, les effets scéniques appartiennent à la comédie de caractères.
La didascalie signale
le regard appuyé de Cléanthis sur Iphicrate et d'Arlequin sur Euphrosine, anticipant sur le nouvel enjeu
que posera la fin de la scène.
Dans leur parodie galante, si Cléanthis a souhaité « prendre l'air assis »,
Arlequin donne tous les signes d'une distanciation burlesque : ravi de ses trouvailles, il saute de joie,
s'applaudit, accentue sa déclaration en se mettant à genoux.
C'est le zanni de la commedia dell'arte,
lâché dans la rhétorique amoureuse, et cette rupture perpétuelle entre le discours et les gestes,
soulignée par les reproches de Cléanthis, rend cette scène franchement comique.
Le rire d'Arlequin a
une autre vertu : il renvoie aux maîtres l'image de leur ridicule et signale au valet la fausseté de
l'entreprise.
C'est au nom de la vérité qu'il propose d'ailleurs à Cléanthis un autre jeu : "vous ne m'aimez.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FEMMES SAVANTES (Les). de Molière (Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673) (résumé)
- Arthur Geillon 2nd1 Introduction du commentaire sur les scènes 6 et 7 des Précieuses Ridicules de Molière Les Précieuses Ridicules est une œuvre de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.
- ÉCOLE DES FEMMES (L’) de Molière (Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673) (résumé)
- ÉCOLE DES MARIS (L'). de Molière (Jean-Baptiste Poquelin, 1822-1673) (résumé)
- FOURBERIES DE SCAPIN (Les). de Molière (Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673).