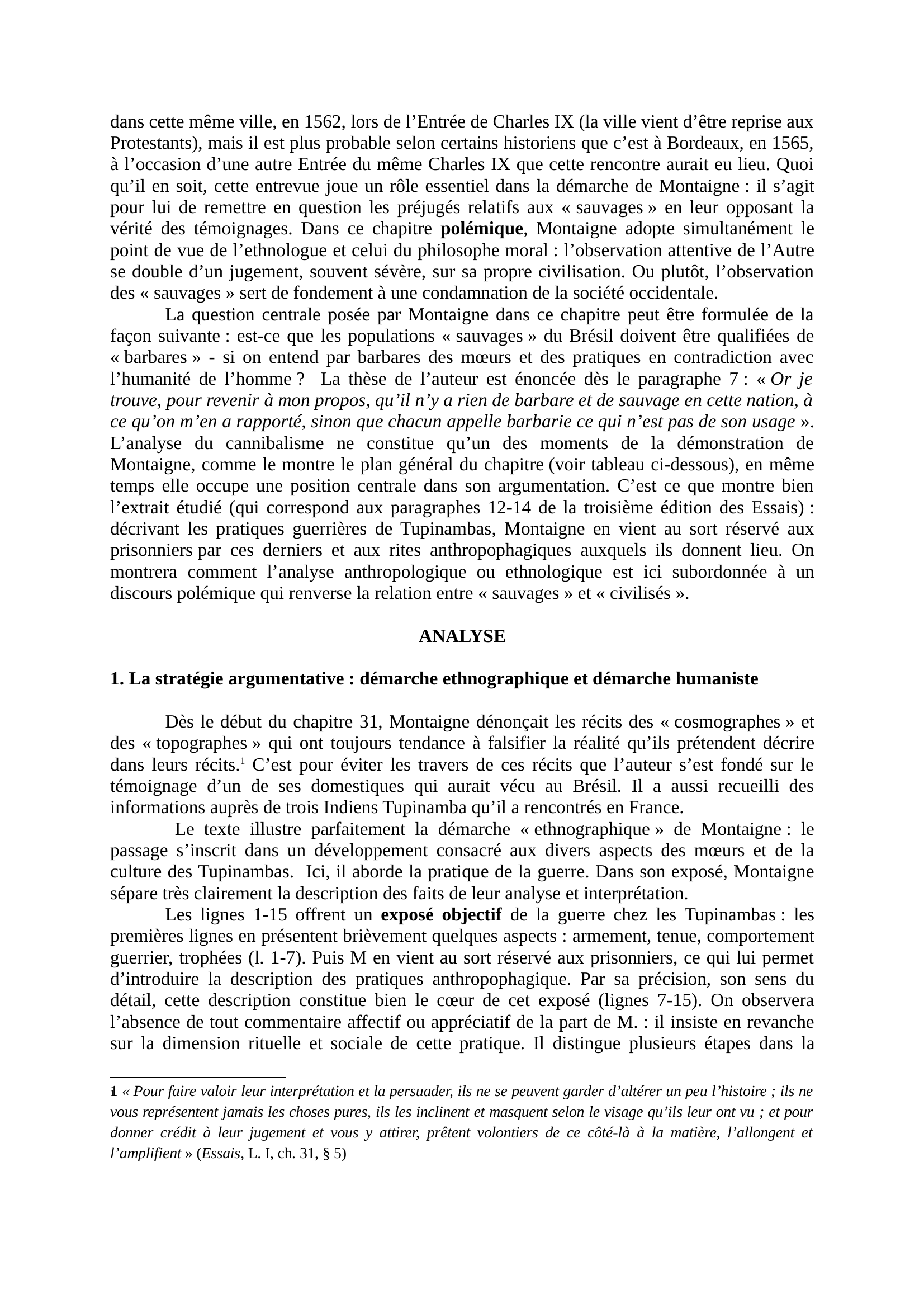Montaigne, Des cannibales
Publié le 20/11/2012

Extrait du document


«
dans cette même ville, en 1562, lors de l’Entrée de Charles IX (la ville vient d’être reprise aux
Protestants), mais il est plus probable selon certains historiens que c’est à Bordeaux, en 1565,
à l’occasion d’une autre Entrée du même Charles IX que cette rencontre aurait eu lieu.
Quoi
qu’il en soit, cette entrevue joue un rôle essentiel dans la démarche de Montaigne : il s’agit
pour lui de remettre en question les préjugés relatifs aux « sauvages » en leur opposant la
vérité des témoignages.
Dans ce chapitre polémique , Montaigne adopte simultanément le
point de vue de l’ethnologue et celui du philosophe moral : l’observation attentive de l’Autre
se double d’un jugement, souvent sévère, sur sa propre civilisation.
Ou plutôt, l’observation
des « sauvages » sert de fondement à une condamnation de la société occidentale.
La question centrale posée par Montaigne dans ce chapitre peut être formulée de la
façon suivante : est-ce que les populations « sauvages » du Brésil doivent être qualifiées de
« barbares » - si on entend par barbares des mœurs et des pratiques en contradiction avec
l’humanité de l’homme ? La thèse de l’auteur est énoncée dès le paragraphe 7 : « Or je
trouve, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à
ce qu’on m’en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage ».
L’analyse du cannibalisme ne constitue qu’un des moments de la démonstration de
Montaigne, comme le montre le plan général du chapitre (voir tableau ci-dessous), en même
temps elle occupe une position centrale dans son argumentation.
C’est ce que montre bien
l’extrait étudié (qui correspond aux paragraphes 12-14 de la troisième édition des Essais) :
décrivant les pratiques guerrières de Tupinambas, Montaigne en vient au sort réservé aux
prisonniers par ces derniers et aux rites anthropophagiques auxquels ils donnent lieu.
On
montrera comment l’analyse anthropologique ou ethnologique est ici subordonnée à un
discours polémique qui renverse la relation entre « sauvages » et « civilisés ».
ANALYSE
1.
La stratégie argumentative : démarche ethnographique et démarche humaniste
Dès le début du chapitre 31, Montaigne dénonçait les récits des « cosmographes » et
des « topographes » qui ont toujours tendance à falsifier la réalité qu’ils prétendent décrire
dans leurs récits.
1
C’est pour éviter les travers de ces récits que l’auteur s’est fondé sur le
témoignage d’un de ses domestiques qui aurait vécu au Brésil.
Il a aussi recueilli des
informations auprès de trois Indiens Tupinamba qu’il a rencontrés en France.
Le texte illustre parfaitement la démarche « ethnographique » de Montaigne : le
passage s’inscrit dans un développement consacré aux divers aspects des mœurs et de la
culture des Tupinambas.
Ici, il aborde la pratique de la guerre.
Dans son exposé, Montaigne
sépare très clairement la description des faits de leur analyse et interprétation.
Les lignes 1-15 offrent un exposé objectif de la guerre chez les Tupinambas : les
premières lignes en présentent brièvement quelques aspects : armement, tenue, comportement
guerrier, trophées (l.
1-7).
Puis M en vient au sort réservé aux prisonniers, ce qui lui permet
d’introduire la description des pratiques anthropophagique.
Par sa précision, son sens du
détail, cette description constitue bien le cœur de cet exposé (lignes 7-15).
On observera
l’absence de tout commentaire affectif ou appréciatif de la part de M.
: il insiste en revanche
sur la dimension rituelle et sociale de cette pratique.
Il distingue plusieurs étapes dans la
11 « Pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d’altérer un peu l’histoire ; ils ne
vous représentent jamais les choses pures, ils les inclinent et masquent selon le visage qu’ils leur ont vu ; et pour
donner crédit à leur jugement et vous y attirer, prêtent volontiers de ce côté-là à la matière, l’allongent et
l’amplifient » ( Essais , L.
I, ch.
31, § 5).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse de l'essai Des Cannibales, Montaigne.
- Montaigne, des cannibales, I,31
- Des cannibales (1), Montaigne
- Montaigne : Des cannibales, Des coches
- Montaigne, "Cannibales"