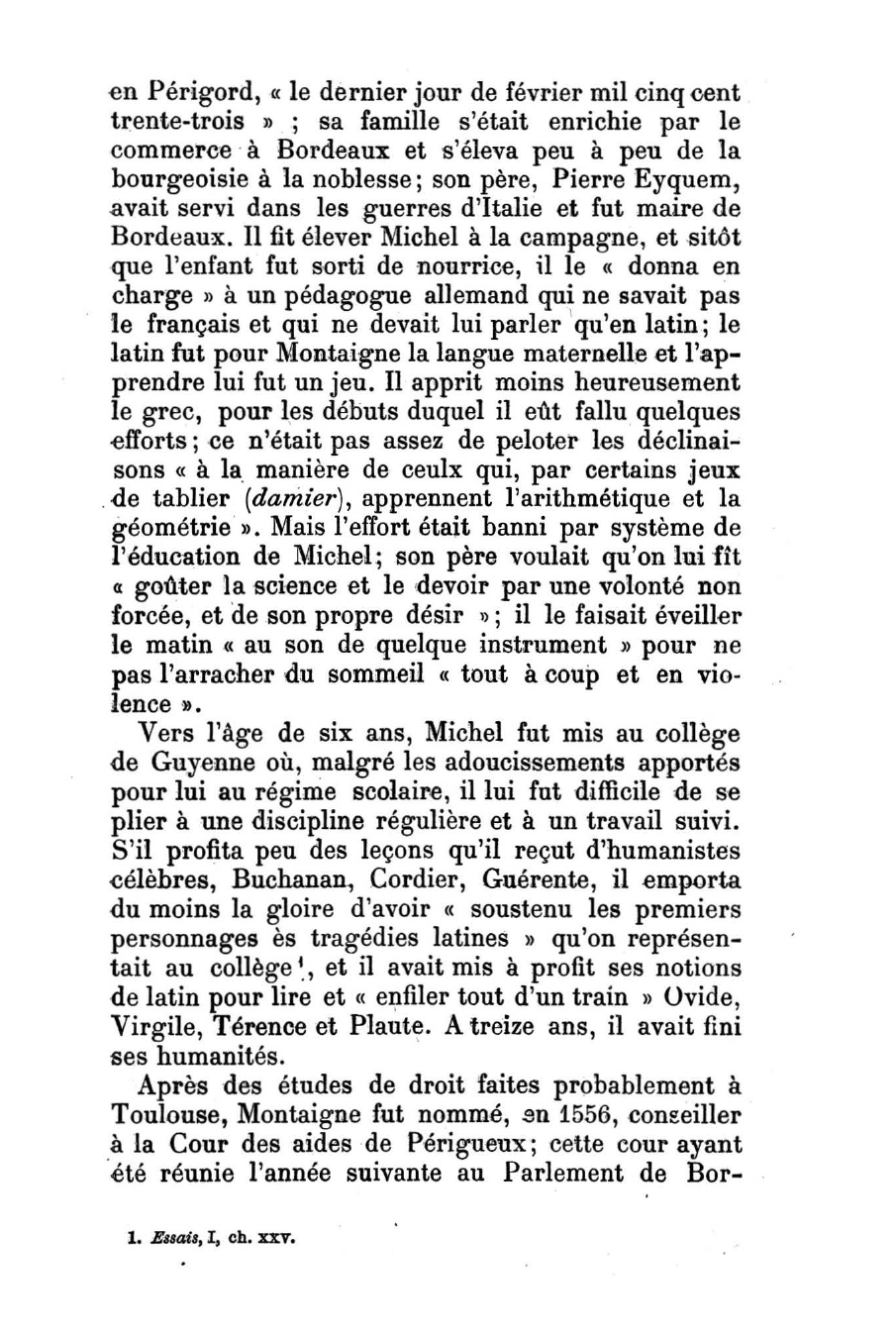MONTAIGNE ET LES MORALISTES
Publié le 11/12/2011

Extrait du document

Montaigne se mêla peu aux affaires et aux luttes de son temps; d'abord magistrat au Parlement de Bordeaux, il quitta la robe pour l'épée; il ne fit que quelques campagnes, et en 1571 se retira dans sa librairie ; un voyage de dix-huit mois, deux passages à la mairie de Bordeaux, quelques apparitions à la cour marquent seuls dans sa vie de moraliste solitaire, appliqué à s'étudier soi-même pour connaître l'homme. Il mourut chrétiennement. La connaissance qu'il acquit de l'humaine misère le rendit indulgent et modéré, mais la contemplation habituelle de son âme, dont il a peint les contrariétés, le rendit égoïste. Il ne se plait pas aux spéculations métaphysiques et ce philosophe n'est qu'un observatl'ur de faits psychologiques. Il croit peu à la puissance du raisonnement et il prend un malin plaisir à humilier la raison, si bien qu'on peut le croire sceptique. Sa morale tend à jouir de lui-même dans une douce quiétude et sa sagesse est un épicurisme bien entendu. En éducation, il estime qu'il faut avant tout former le jugement; il sacrifie la mémoire, les connaissances positives, et il ne fait point de place dans l'éducation à l'idée du. devoir. Ses lectures nous lé montrent passionné pour les moralistes et les historiens, sévère aux orateurs et grand ami des poètes élégants. Il est lui-même un artiste écrivain : sans plan, sans ordre, mais très appliqué à surveiller sa plume. Il a beaucoup d'imagination et, s'il manque un peu de sobriété, il est admirable de vivacité et de naturel. Son influence a été considérable jusque vers le milieu du xviie siècle.

«
en Périgord, « le dernier jour de février mil cinq cent
trente-trois » ; sa famille s'était enrichie par le
commerce à Bordeaux et s'éleva peu à peu de la
bourgeoisie à la noblesse; son père, Pierre Eyquem,
avait servi dans les guerres d'Italie et fut maire de
Bordeau:x:.
Il fit élever Michel à la campagne , et sit ôt
que l'enfant fut sorti de nourrice,
il le ; il le faisait éveiller
le matin (< au son de quelque instrument » pour ne
pas l'arracher du sommeil « tout à coup et en vio
lence*· Vers l'âge de six ans, Michel fut mis au collège
de Gu yenne où, malgré les adoucissements apport és
pour lui au régime scolaire, il lui fut difficile de se
plier à une discipline régulière et à un travail suivi.
S'il profita peu des leçons qu'il reçut d'humanistes
célèbres, Buchanan, Cordier, Guérente, il emporta
du moins la gloire d'avoir « soustenu les premiers
personnages ès tragédies latines » qu'on représen
tait au collège 1
_ , et il avait mis à profit ses notions
de latin pour lire et « e~filer tout d'un train » Ovide ,
Virgile, Térence et Plauty.
A treize ans, il avait fini
ses humanités .
Après des études de droit faites probablement à
Toulouse, Montaigne fut nommé, en 1556, com:eiller
à la Cour des aides de Périgueux; cette cour ayant
·été réunie l'année suivante au Parlement de Bor-
1.
E11at1, I, ch.
xxv..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Nietzsche, qui fut grand lecteur des moralistes français, aimait, disait-il, leur loyauté. On évoque ainsi Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Joubert... A travers la diversité de leurs génies et de leurs tempéraments, on peut de fait connaître chez de tels écrivains des voies, et, pour ainsi dire, des méthodes qui les associent. Il y a chez tous un soin de pénétration, de définition à l'endroit des hommes et des mœurs. Sans pour autant méconnaître les élémen
- Montaigne et les Moralistes
- MONTAIGNE ET LES MORALISTES
- Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Montaigne
- Analyse de l'essai Des Cannibales, Montaigne.