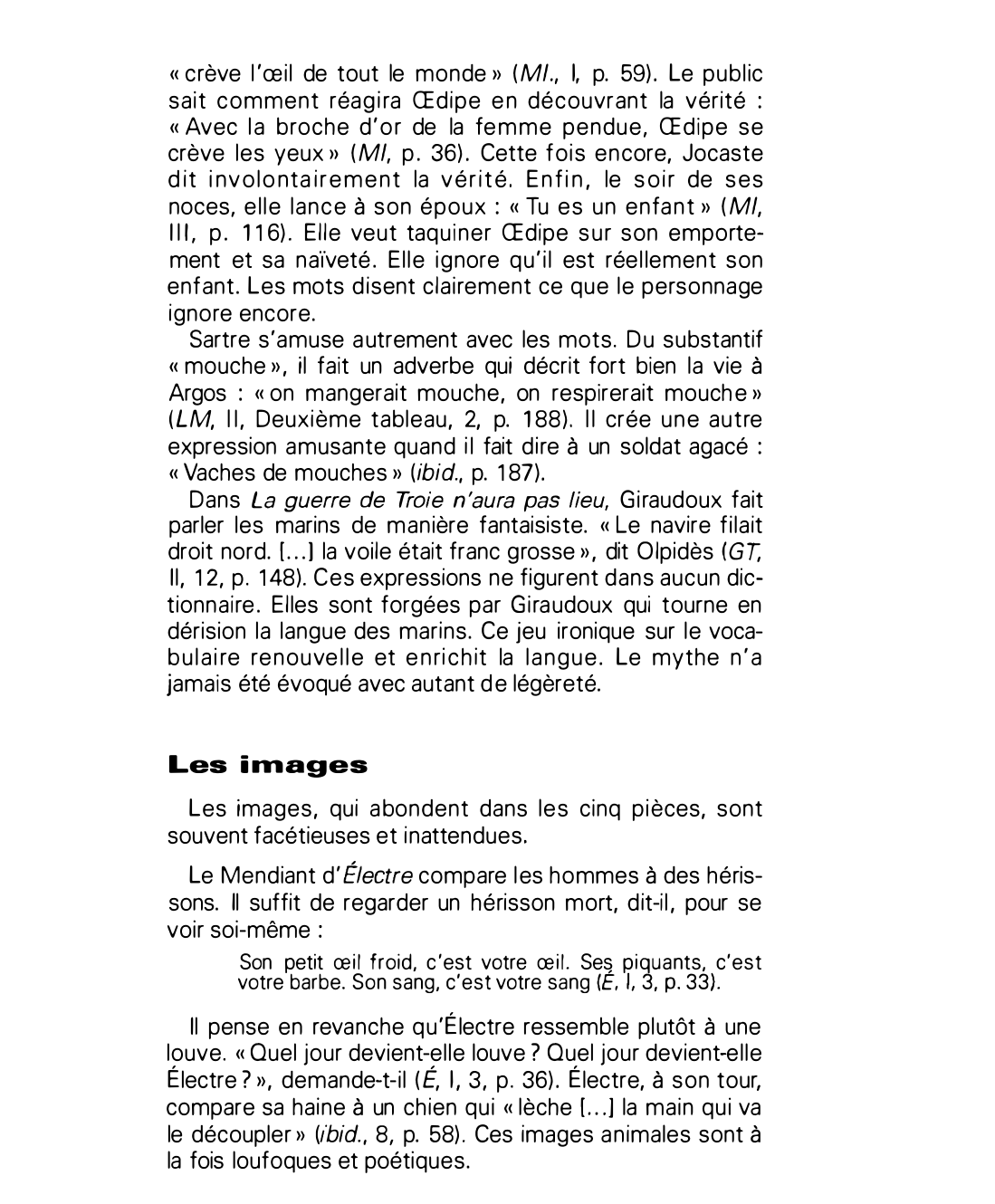Mythe et langage
Publié le 18/09/2018

Extrait du document

La valeur des mots
C'est pourquoi les personnages remettent le langage en question. Ils regrettent que celui-ci traduise si mal émotions et sentiments. «Ah! Les hommes ont bien de la chance d'arriver à dire ce qu'ils veulent dire ! », soupire Troïlus (GT Il, 1, p. 105). La phrase rappelle l'aveu du Jardinier : « L'inconvénient est que je dis toujours un peu le contraire de ce que je veux dire» (É, Entracte, p. 71 ). Les mots mentent, apparemment. C'est du moins ce que suggère Créon quand il dit à Antigone : « Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Étéocle. Ce ne sera pas vrai» (A, p. 91 ).
À l'image de Créon, bien des personnages préfèrent le silence à la parole. Dans Électre, les mots sont constamment dénoncés : « Moi, ç'a toujours été les silences qui me convainquent», affirme le Jardinier dans son «lamento» (É, p.74). C'est d'ailleurs en se taisant qu'Oreste et sa sœur expriment leur tendresse mutuelle. Quand Oreste annonce : «J'ai tout à te dire», Bectre l'interrompt : « Tu me dis tout par ta présence. Tais-toi.»
Par d'innombrables comparaisons, le Sphinx de Cocteau nous introduit dans un espace régi par le rêve et l'imagination. Les images qu'il enchaîne nous surprennent et nous charment. Il se dit en effet :
plus subtil que la foudre, plus raide qu'un cocher, plus lourd qu'une vache, plus sage qu'un élève tirant la langue sur des chiffres [ ... 1 (Mi, Il, p. 83).
Mais tandis que la phrase se déroule ainsi, le sujet grammatical n'a toujours pas été exprimé. Le spectateur se demande donc à quoi se rapportent ces comparaisons. Il ne sait pas encore ce qui est «plus nocturne que l'œuf, plus ingénieux que les bourreaux d'Asie, plus fourbe que le cœur, plus désinvolte qu'une main qui triche» (ibid)... Le Sphinx - qui s'en étonnerait? - parle par énigmes. Grâce à cette phrase à la construction habile, Cocteau nous fait partager l'embarras d'Œdipe.
Giraudoux, Sartre, Cocteau usent ainsi d'une langue poétique, plus vivante et plus amusante que celle dont on se sert traditionnellement pour évoquer les mythes.

«
«c
rève l'œil de tout le mond e » (Ml., 1, p.
59) .
Le publi c
sait comment réagira Œdipe en découv rant la vérité :
«A vec la broche d'or de la femm e pendue, Œdipe se
crève les yeux >> (M l, p.
36) .
Cette fois enc ore, Jocaste
di t involo ntairement la vérité.
Enfin, le soir de ses
noces, elle lance à son époux : «T u es un enf ant » (M l,
Ill , p.
116 ).
Elle veut taqui ner Œdipe sur son empor te
ment et sa naïveté .
Elle ignore qu'il est réellement son
enfant.
Les mots disent clairement ce que le personnag e
ignor e encore.
Sartre s'amus e au trement avec les mots.
Du substantif
«m ouche », il fait un adverbe qui décrit fort bien la vie à
Argos : «on mang erait mouche, on respirerait mouche»
(LM.
Il, Deuxième tableau, 2, p.
188).
Il crée une autre
expression amusante quand il fait dire à un soldat agacé :
«V aches de mouches » (ibid., p.
187).
Dans La guer re de Troie n'aur a pas lieu, Gir audoux fait
parler les marins de mani ère fantaisiste.
« Le navire filait
droit nord.
[ ...
]la voile était franc grosse », dit Olpidès (GT.
Il, 12, p.
148).
Ces expressions ne figurent dans aucun dic
tion naire.
Elles sont forgées par Giraudoux qui tourne en
dérision la langue des marins.
Ce jeu ironique sur le voca
bula ire renouv elle et enr ichi t la langue.
Le mythe n'a
jamais été évoqué avec autant de légèreté.
Les images
Les images, qui abondent dans les cinq pièces, sont
souvent facétieuses et inatt endues.
Le Mendi ant d'Électre compar e les ho mmes à des héris
sons.
Il suffit de regarder un hérisson mort, dit-i l, pour se
voir soi-même :
Son petit œil froid, c'est votre œil.
Ses piquan ts, c'est
votre barbe.
Son sang, c'est votre sang (É, 1, 3, p.
33}.
Il pense en reva nche qu'Électre ressemble plutôt à une
louve.
«Quel jour devient -elle louve ? Quel jour devient -elle
É lectre ?», demand e-t-il (É, 1, 3, p.
36) .
É lectre, à son tour,
compare sa haine à un chien qui «lèche [ ...
]l a main qui va
le découpl er» (ibid.
, 8, p.
58) .
Ces images animales sont à
la fois loufoques et poéti ques..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LES BALISAGES DU LANGAGE HTML
- Le langage – cours
- HdA au Brevet 3e1 Objet d’étude : Arts et progrès techniques Thématique Domaine Période Arts, rupture et continuité Art du langage XXe siècle
- dissertation juste la fin du monde: En quoi l’œuvre Juste la Fin du Monde relève-telle une crise personnelle et familiale à travers une crise du langage ?
- Qu’est-ce qui rend le langage humain ? (cours de philo)