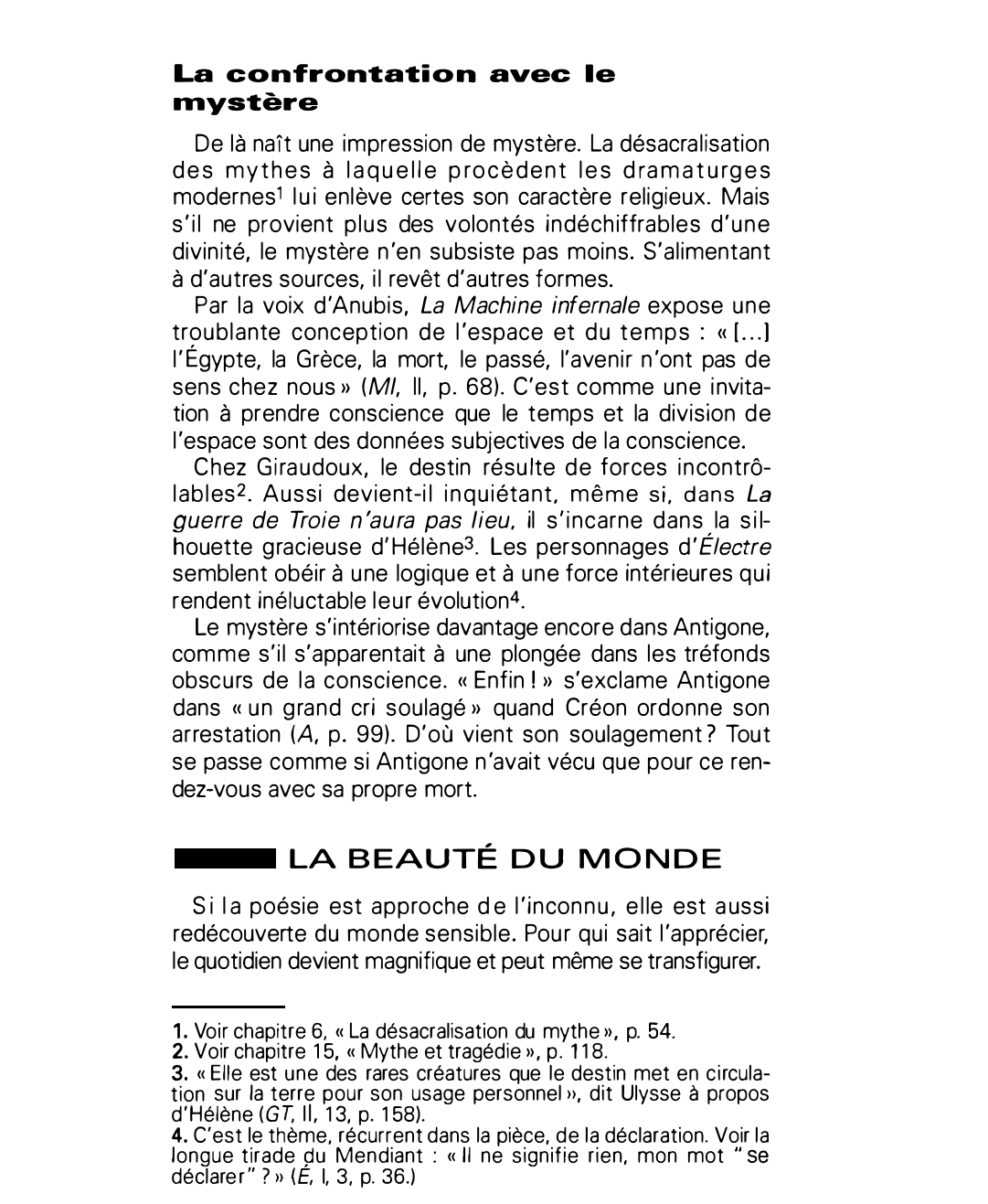Mythe et poésie
Publié le 18/09/2018

Extrait du document
• Une poésie bucolique et champêtre
Dans ces sombres histoires que sont par définition les mythes, la nature est souvent décrite comme un paradis, même s'il sera bientôt perdu.
Antigone se lève dès l'aube pour admirer le jardin royal : «C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes [ ...] J'ai cru au jour pour la première fois aujourd'hui» (A, p. 16). Le Jardinier d'Electre introduit des notes colorées dans la tragédie familiale des Atrides. Contre Clytemnestre il défend son jardin avec passion :
Aux pentes, la vigne et les pêchers de plein vent. Dans le plan, les légumes, les fraises et les framboises. Au creux de chaque éboulis un figuier qui épaule le mur et y tiédit la figue (E, 1, 4, p. 46).
Andromaque recourt au vocabulaire de la peinture et de la musique pour invoquer les environs de Troie :
Vois ce soleil. Il s'amasse plus de nacre sur les faubourgs de Troie qu'au fond des mers. De toute maison de pêcheur, de tout arbre sort le murmure des coquillages. Si jamais il y a eu une chance de voir les hommes trouver un moyen pour vivre en paix, c'est aujourd'hui ... (GT. 1, 1, p. 57).
• L'hymne au bonheur
Soit qu'ils en aient la nostalgie, soit qu'ils découvrent trop tard qu'ils étaient nés pour aimer, les personnages entonnent fréquemment un hymne plus ou moins bref au bonheur.
Bien que l'écriture des Mouches soit souvent crue et directe, elle n'est pas exempte d'envolées passionnées. □ectre sait chanter le bonheur qui règne ailleurs :
«
La
conf' rontat ion avec le
mystère
De là naît une impression de mystère.
La désacr alisation
des mythes à laquelle pr ocèdent les dramatur ges
modernes1 lui enlè ve certes son caractère religieux.
Mais
s'il ne provient plus des volontés indéch iffrables d'une
divin ité, le mystère n'en sub siste pas moins.
S'alimentant
à d'autr es sour ces, il revêt d'autres formes.
Par la voix d'Anubis, La Machin e infernale expose une
tr oublan te conception de l'espace et du temps : « [ ...
]
l' É gypte, la Grèce, la mort, le passé, l'avenir n'ont pas de
sens chez nous» (M l, Il, p.
68).
C'est comme une invita
tion à prendr e conscience que le temps et la division de
l' espace sont des données subjectives de la conscience.
Ch ez Girau doux, le destin résu lte de forces incontr ô
lable s2.
Aussi devient-il inqui étant.
même si, dans La
guer re de Troie n'aur a pas lieu.
il s'incarne dans la sil
ho uette gracieuse d' Hélène 3.
Les personnages d'Électre
semblent obéir à un e logique et à une force intérieures qui
rendent inéluctable leur évolution4.
Le mystère s'intériorise davantage encore dans Antigone,
co mme s'il s'ap parentait à une plongée dans les tréfo nds
obs curs de la conscience.
«Enfin !» s'ex clame Antigone
dans «un grand cri soul agé» quand Créon ordonne son
arr estation (A.
p.
99).
D'où vient son soulagem ent? To ut
se passe comme si Antigone n'avait vécu que pour ce ren
dez-vo us avec sa propre mort.
LA BEAUT É DU MONDE
Si la poésie est appr oche de l'inc onnu, elle est aussi
redécouverte du monde sensible.
Pour qui sait l'appr écier ,
le quotidien devient magnifique et peut même se transfigu rer.
1.
Vo ir chapitre 6, «La désacralisation du myt he», p.
54.
2.
Voir chapitre 15, «M ythe et tragé die», p.
118 .
3.
«Elle est une des rares créatures que le destin met en circula
tion sur la terre pour son usage personnel >>, dit Ulysse à propos
d'H élène (GT, Il, 13 , p.
158).
4.
C'est le thème, récurrent dans la pièce, de la déclaration.
Voir la
longue tirade çJu Mendiant : «I l ne signifie rien, mon mot "se
déclar er" ? >> (E, 1, 3, p.
36.).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Vérité, mythe et poésie
- Mythe et poésie contiennent-ils une part de vérité ?
- La beauté dans la laideur en poésie _ Séance 14 : Du Parnasse ... au Symbolisme
- Une étude de la poésie à la lumière de l'esthétique phénoménologique : l'exemple de Francis Ponge
- Fiche sur la poésie