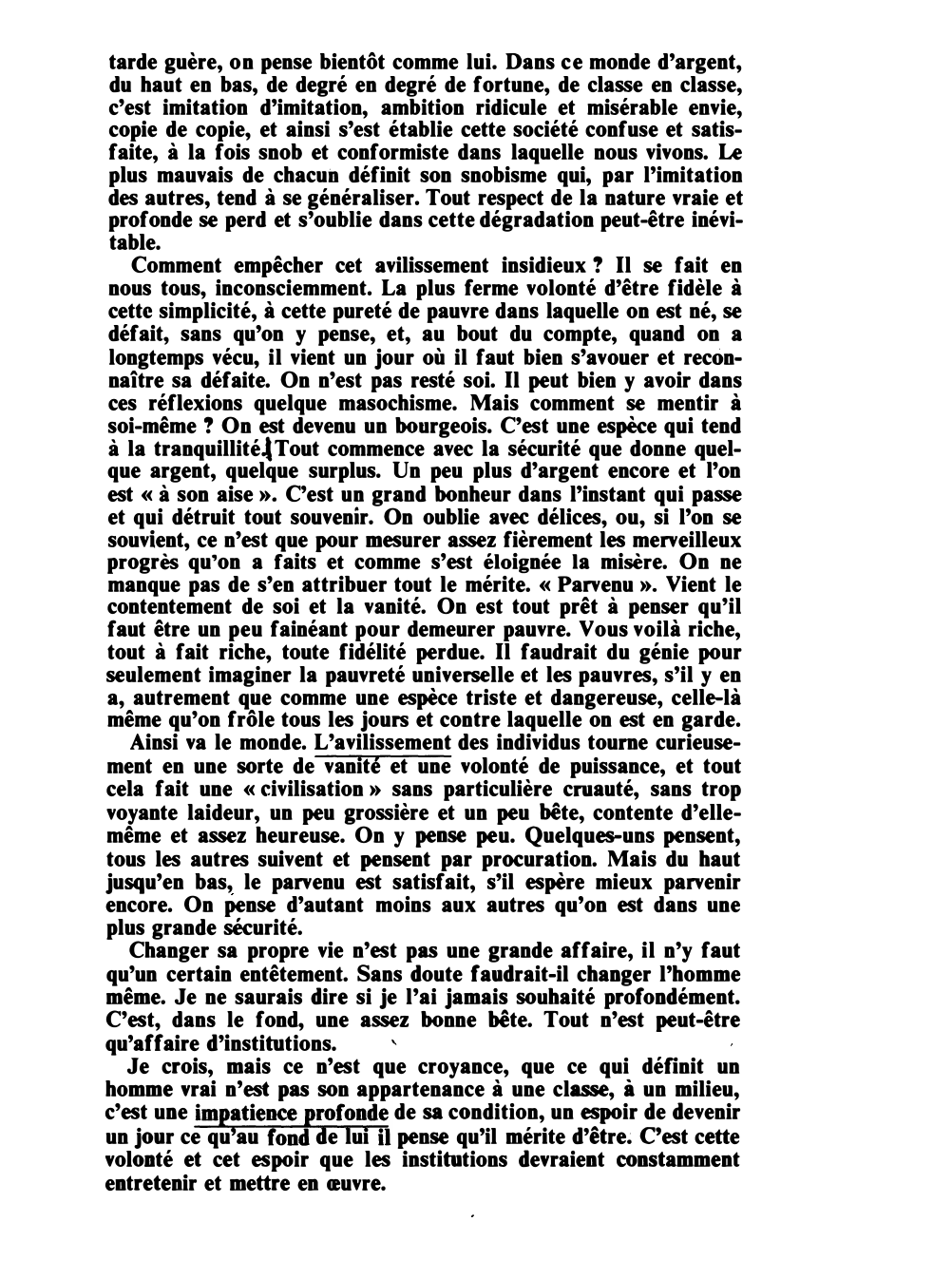« On n’est pas resté soi » écrit Jean GUÉHENNO. Discutez.
Publié le 03/11/2016

Extrait du document
Les prolétaires, depuis cinquante ans, ont rêvé de devenir des bourgeois, comme les bourgeois d’il y a deux cents ans de devenir nobles. Leur imagination n’est pas allée plus loin que celle du premier bourgeois qui passe. On affecte de le mépriser, mais on ne cesse pas de l’imiter. L’imitation est d’abord tout extérieure. Cela commence par le costume, la cravate, le chapeau, mais, et cela ne tarde guère, on pense bientôt comme lui. Dans ce monde d’argent, du haut en bas, de degré en degré de fortune, de classe en classe, c’est imitation d’imitation, ambition ridicule et misérable envie, copie de copie, et ainsi s’est établie cette société confuse et satisfaite, à la fois snob et conformiste dans laquelle nous vivons. Le plus mauvais de chacun définit son snobisme qui, par l’imitation des autres, tend à se généraliser. Tout respect de la nature vraie et profonde se perd et s’oublie dans cette dégradation peut-être inévitable.
Comment empêcher cet avilissement insidieux ? Il se fait en nous tous, inconsciemment. La plus ferme volonté d’être fidèle à cette simplicité, à cette pureté de pauvre dans laquelle on est né, se défait, sans qu’on y pense, et, au bout du compte, quand on a longtemps vécu, il vient un jour où il faut bien s’avouer et reconnaître sa défaite. On n’est pas resté soi. Il peut bien y avoir dans ces réflexions quelque masochisme. Mais comment se mentir à soi-même ? On est devenu un bourgeois. C’est une espèce qui tend à la tranquillité^ Tout commence avec la sécurité que donne quelque argent, quelque surplus. Un peu plus d’argent encore et l’on est « à son aise ». C’est un grand bonheur dans l’instant qui passe et qui détruit tout souvenir. On oublie avec délices, ou, si l’on se souvient, ce n’est que pour mesurer assez fièrement les merveilleux progrès qu'on a faits et comme s’est éloignée la misère. On ne manque pas de s’en attribuer tout le mérite. « Parvenu ». Vient le contentement de soi et la vanité. On est tout prêt à penser qu’il faut être un peu fainéant pour demeurer pauvre. Vous voilà riche, tout à fait riche, toute fidélité perdue. Il faudrait du génie pour seulement imaginer la pauvreté universelle et les pauvres, s’il y en a, autrement que comme une espèce triste et dangereuse, celle-là même qu’on frôle tous les jours et contre laquelle on est en garde.
Jean GUÉHENNO, Carnet du vieil écrivain, 1971.
• Mais J. Guéhenno a l’honnêteté de faire le point sur lui-même et de se rendre compte qu’il a « perdu » sa « fidélité » à son ancien moi, au petit garçon ou adolescent qui se débattait avec courage, enthousiasme, croyance en toutes les grandeurs de l’homme.
• Une prise de conscience de ce type permet de remédier aux changements qui ont pu être fâcheux.
• Il faut de temps en temps se remettre en question, ne pas se contenter d’une réussite matérielle ou sociale, car la vraie réussite c’est celle que l’on fait de son être, donc réussite morale.
Alors, faut-il modifier l’homme ? Mais est-ce souhaitable ? est-il si mauvais ? Un homme véritable ne doit pas accepter béatement son destin, mais tendre au perfectionnement de l’être, ce que nos institutions devraient enseigner. Il faut réagir - croyance optimiste [en la bonté humaine]1 ! - contre les erreurs de vie.
«
tarde guère, on pense bientôt comme lui.
Dans ce monde d'argent,
du haut en bas, de degré en degré de fortune, de classe en classe,
c'est imitation d'imitation, ambition ridicule et misérable envie,
copie de copie, et ainsi s'est établie cette société confuse et satis
faite, à la fois snob et conformiste dans laquelle nous vivons.
Le
plus mauvais de chacun définit son snobisme qui, par l'imitation
des autres, tend à se généraliser.
Tout respect de la nature vraie et
profonde se perd et s'oublie dans cette dégradation peut-être inévi
table.
Comment empêcher cet avilissement insidieux! ll se fait en
nous tous, inconsciemment.
La plus ferme volonté d'être fidèle à
cette simplicité, à cette pureté de pauvre dans laquelle on est né, se
défait, sans qu'on y pense, et, au bout du compte, quand on a
longtemps vécu, il vient un jour où il faut bien s'avouer et recOn
naître sa défaite.
On n'est pas resté soi.
Il peut bien y avoir dans
ces réflexions quelque masochisme.
Mais comment se mentir à
soi-même ! On est devenu un bourgeois.
C'est une espèce qui tend
à la tranquillité �Tout commence avec la sécurité que donne quel
que argent, quelque surplus.
Un peu plus d'argent encore et l'on
est « à son aise » .
C'est un grand bonheur dans l'instant qui passe
et qui détruit tout souvenir.
On oublie avec délices, ou, si l'on se
souvient, ce n'est que pour mesurer assez fièrement les merveilleux
progrès qu'on a faits et comme s'est éloignée la misère.
On ne
manque pas de s'en attribuer tout le mérite.
« Parvenu ».
Vient le
contentement de soi et la vanité.
On est tout prêt à penser qu'il
faut être un peu fainéant pour demeurer pauvre.
Vous voilà riche,
tout à fait riche, toute fidélité perdue.
Il faudrait du génie pour
seulement imaginer la pauvreté universelle et les pauvres, s'il y en
a, autrement que comme une espèce triste et dangereuse, celle-là
même qu'on frôle tous les jours et contre laquelle on est en garde.
Ainsi va le monde.
L'avilissement des individus tourne curieuse
ment en une sorte de vanite et une volonté de puissance, et tout
cela fait une « civilisation » sans particulière cmauté, sans trop
voyante laideur, un peu grossière et un peu bête, contente d'elle
même et assez heureuse.
On y pense peu.
Quelques-uns pensent,
tous les autres suivent et pensent par procuration.
Mais du haut
jusqu'en bas, le parvenu est satisfait, s'il espère mieux parvenir
encore.
On pense d'autant moins aux autres qu'on est dans une
plus grande sécurité.
Changer sa propre vie n'est pas une grande affaire, il n'y faut
qu'un certain entêtement.
Sans doute faudrait-il changer l'homme
même.
Je ne saurais dire si je l'ai jamais souhaité profondément.
C'est, dans le fond, une assez bonne bête.
Tout n'est peut-être
qu'affaire d'institutions.
Je crois, mais ce n'est que croyance, que ce qui définit un
homme vrai n'est pas son appartenance à une clas, à un milieu,
c'est une
de
sa condition, un espoir de devenir
un jour ce qu'au
de
lui
pense
qu'il mérite d'être; C'est cete
voloaté et cet espoir que les iastitutions devraieot coostammeat
eotreteair et mettre ea œuvre..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans ses Carnet du vieil écrivain, Jean Guéhenno écrit « un livre est un outil de liberté » Discutez cette affirmation en vous limitant à la lecture de romans. Votre réflexion s'appuiera sur les textes du corpus et sur les romans que vous avez lus auparavant.
- « On n'est pas resté soi », écrit Jean Guéhenno. Dans quelle mesure peut-on partager, nuancer ou discuter cette réflexion et les éléments du texte qui l'illustrent ? Vous organiserez votre argumentation en vous référant à votre expérience et à vos lectures.
- Expliquez, et s'il y a lieu discutez, cette pensée de Jean Guéhenno : «On ne juge jamais mieux qu'à vingt ans l'univers : on l'aime tel qu'il devrait être. Toute la sagesse, après, est à maintenir vivant en soi un tel amour. » (Journal d'un homme de quarante ans.) ?
- « Les hommes d'aujourd'hui ne peuvent pas attendre de la culture qu'elle leur fournisse les agréments de leur solitude et de leurs loisirs. Il faut qu'elle fasse d'eux des hommes efficaces, chacun à sa place dans la solidarité d'un monde qui combat ». Jean Guéhenno. En vous appuyant sur vos connaissances littéraires et de manière plus large sur votre culture personnelle, expliquez et discutez cette position exprimée par l'écrivain contemporain Jean Guéhenno dans un article intitulé «
- « Les vrais écrivains, tous, écrivent pour notre salut... L'un sauve en nous l'esprit de légèreté. L'autre nous enseigne l'insécurité et le risque nécessaires. Un autre la loyauté difficile... » Jean Guéhenno, Journal des années noires, 1947. Expliquez et, éventuellement, discutez ces affirmations de Jean Guéhenno, en vous appuyant de façon précise sur votre expérience de lecteur.