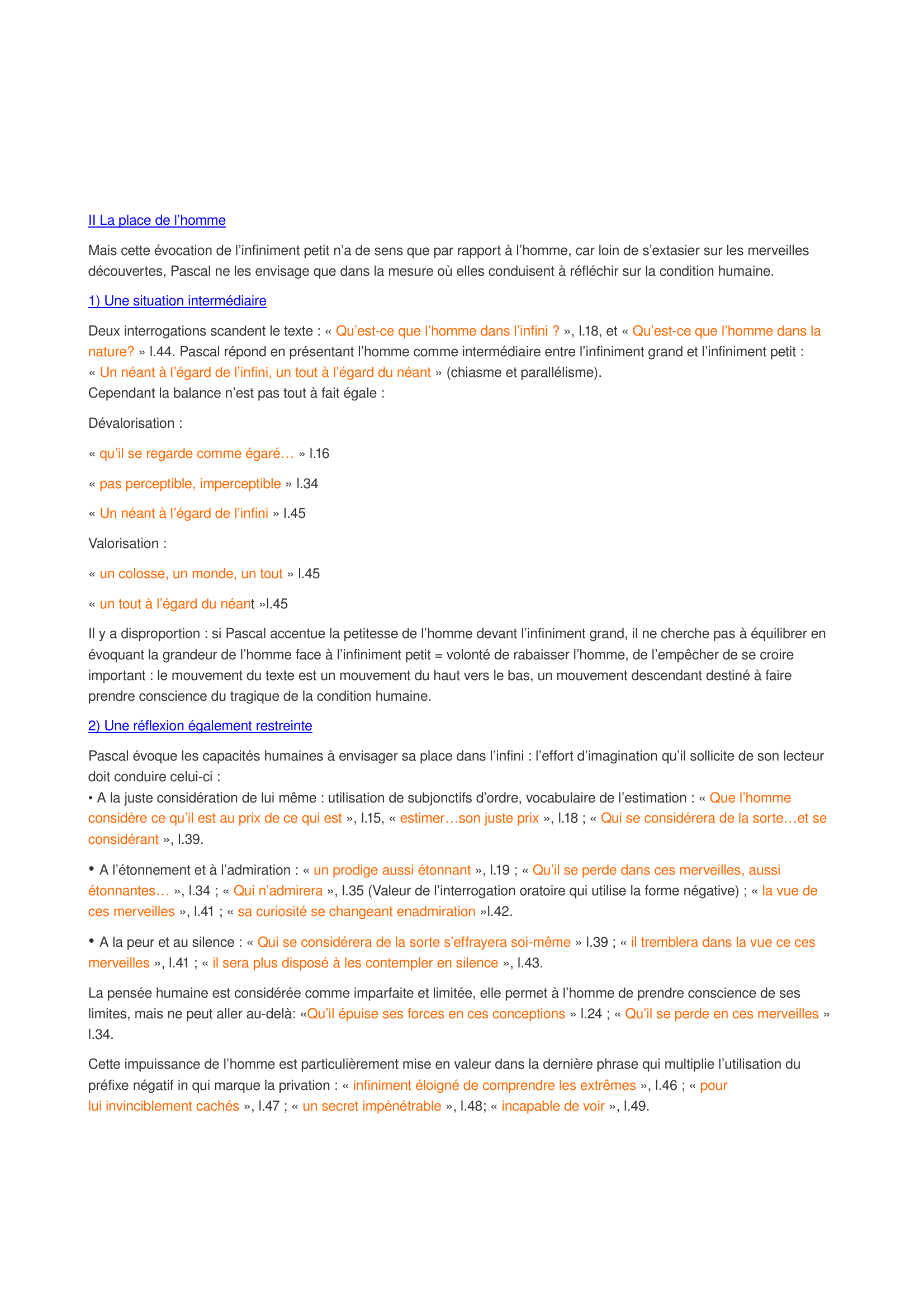Pascal
Publié le 14/10/2013

Extrait du document


« II La place de l’homme Mais cette évocation de l’infiniment petit n’a de sens que par rapport à l’homme, car loin de s’extasier sur les merveilles d écouvertes, Pascal ne les envisage que dans la mesure o ù elles conduisent à réfléchir sur la condition humaine. 1) Une situation interm édiaire Deux interrogations scandent le texte : « Qu’estce que l’homme dans l’infini ? », l.18, et « Qu’estce que l’homme dans la nature? » l.44. Pascal r épond en pr ésentant l’homme comme interm édiaire entre l’infiniment grand et l’infiniment petit : « Un n éant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du n éant » (chiasme et parall élisme). Cependant la balance n’est pas tout à fait égale : D évalorisation : « qu’il se regarde comme égar é… » l.16 « pas perceptible, imperceptible » l.34 « Un n éant à l’égard de l’infini » l.45 Valorisation : « un colosse, un monde, un tout » l.45 « un tout à l’égard du n éan t »l.45 Il y a disproportion : si Pascal accentue la petitesse de l’homme devant l’infiniment grand, il ne cherche pas à équilibrer en é voquant la grandeur de l’homme face à l’infiniment petit = volont é de rabaisser l’homme, de l’emp êcher de se croire important : le mouvement du texte est un mouvement du haut vers le bas, un mouvement descendant destin é à faire prendre conscience du tragique de la condition humaine. 2) Une r éflexion également restreinte Pascal évoque les capacit és humaines à envisager sa place dans l’infini : l’effort d’imagination qu’il sollicite de son lecteur doit conduire celuici : • A la juste consid ération de lui m ême : utilisation de subjonctifs d’ordre, vocabulaire de l’estimation : « Que l’homme consid ère ce qu’il est au prix de ce qui est », l.15, « estimer…son juste prix », l.18 ; « Qui se consid érera de la sorte…et se consid érant », l.39. • A l’ étonnement et à l’admiration : « un prodige aussi étonnant », l.19 ; « Qu’il se perde dans ces merveilles , aussi é tonnantes… », l.34 ; « Qui n’ admirera », l.35 (Valeur de l’interrogation oratoire qui utilise la forme n égative) ; « la vue de ces merveilles », l.41 ; « sa curiosit é se changeant en admiration »l.42. • A la peur et au silence : « Qui se consid érera de la sorte s’effrayera soim ême » l.39 ; « i l tremblera dans la vue ce ces merveilles », l.41 ; « il sera plus dispos é à les contempler en silence », l.43. La pens ée humaine est consid érée comme imparfaite et limit ée, elle permet à l’homme de prendre conscience de ses limites, mais ne peut aller audel à: « Qu’il épuise ses forces en ces conceptions » l.24 ; « Qu’il se perde en ces merveilles » l.34. Cette impuissance de l’homme est particuli èrement mise en valeur dans la derni ère phrase qui multiplie l’utilisation du pr éfixe n égatif in qui marque la privation : « infiniment é loign é de comprendre les extr êmes », l.46 ; « pour lui invinciblement cach és », l.47 ; « un secret imp énétrable », l.48; « incapable de voir », l.49.. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Quelle vanité que la peinture, qui attire l’admiration par la ressemblance des choses dont on n’admire point les originaux ! Pascal
- blaise pascal ET LE NEZDE Cléopâtre
- Explication de texte : « Qu’est-ce que le Moi » Pascal
- pascal: discours sur l’origine des grands
- “ Deux excès : exclure la raison, n'admettre que la raison" écrit Pascal dans ses Pensées