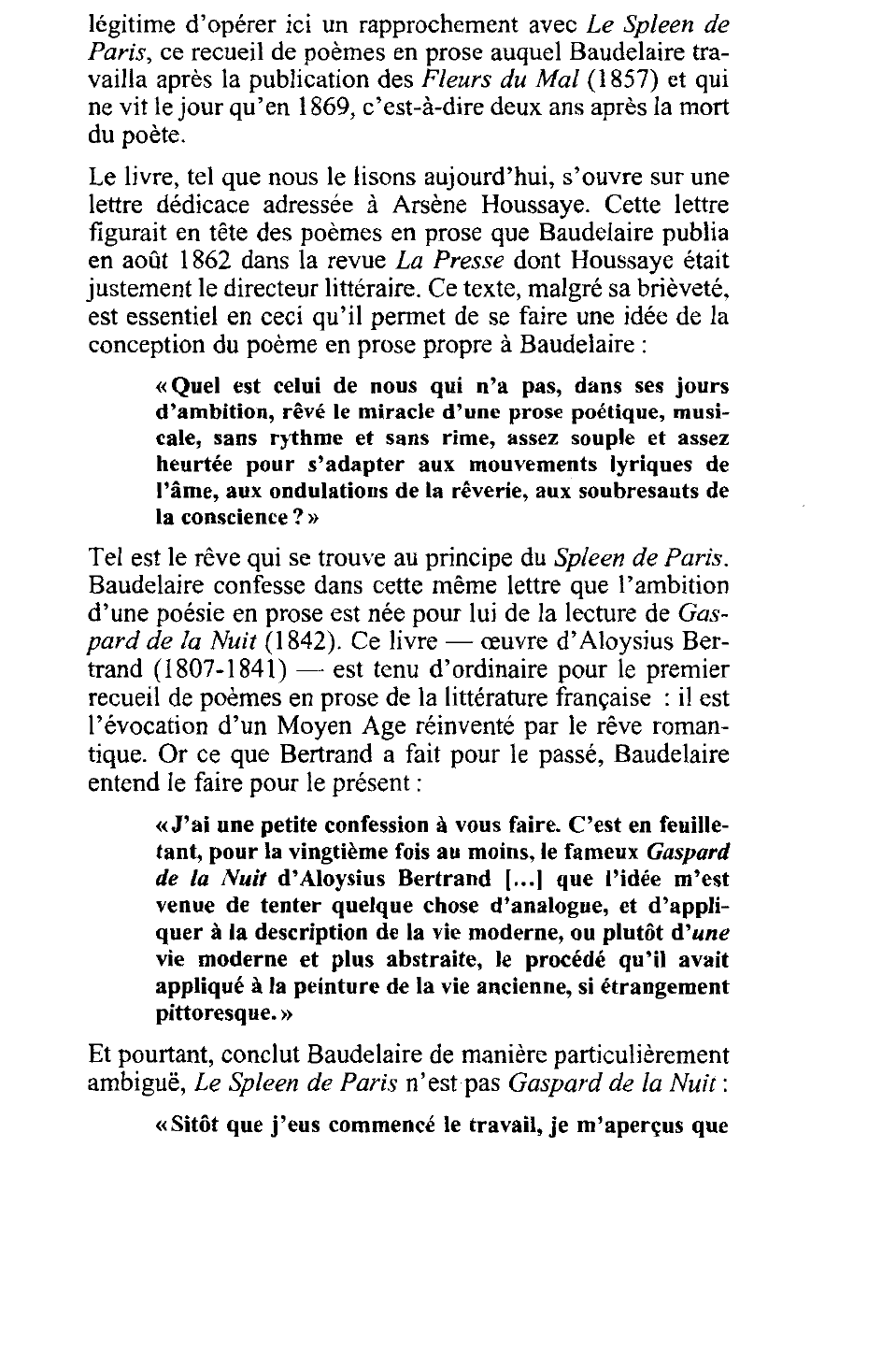POÉSIE EN PROSE
Publié le 28/03/2015

Extrait du document
On est libre bien entendu de ne pas partager l'avis de Suzanne Bernard et de reconnaître au contraire dans Le Spleen de Paris le digne pendant des Fleurs du Mal. Le passage de Baudelaire à la prose est-il véritablement l'effet de la lassitude, de la vieillesse, la conséquence d'un manque d'inspiration? Est-il légitime de comparer poèmes en vers et poèmes en prose pour conclure à la supériorité des premiers? Est-il juste enfin de juger la prose baudelairienne à l'aune de sa poésie antérieure? On risque alors de méconnaître la force et la beauté propres des textes qui composent Le Spleen de Paris et qui parviennent dans le registre de la dérision, de l'ironie, de l'intelligence paradoxale à une incontestable réussite.
Quelle que soit la valeur qu'on lui reconnaît, Le Spleen de Paris manifeste en tout cas la diversité et le caractère contradictoire du poème en prose qui hésite toujours entre le poème et le récit, le lyrisme et le banal. Genre « ouvert « entre tous avec tout ce que cela comporte de possibilités mais aussi de risques. Comme l'écrit Suzanne Bernard :
«
250 / Situation du poète .
§1
légitime d'opérer ici un rapprochement avec Le Spleen de
Paris, ce recueil de poèmes en prose auquel Baudelaire tra
vailla après la publication des
Fleurs du Mal (1857) et qui
ne vit le jour qu'en 1869, c'est-à-dire deux ans après la mort
du poète.
Le livre, tel que nous le lisons aujourd'hui, s'ouvre sur une
lettre dédicace adressée à Arsène Houssaye.
Cette lettre
figurait en tête des poèmes en prose que Baudelaire publia
en août 1862 dans la revue
La Presse dont Houssaye était
justement le directeur littéraire.
Ce texte, malgré sa brièveté,
est essentiel en ceci qu'il permet de se faire une idée de la
conception du poème en prose propre à Baudelaire :
«Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musi
cale, sans
rythme et sans rime, assez souple et assez
heurtée
pour s'adapter aux mouvements lyriques de
l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de
la conscience
? »
Tel est le rêve qui se trouve au principe du Spleen de Paris.
Baudelaire confesse dans cette même lettre que l'ambition
d'une poésie en prose est née pour lui de la lecture de
Gas
pard de la Nuit (1842).
Ce livre -œuvre d'Aloysius Ber
trand (1807-1841) -est tenu d'ordinaire pour le premier
recueil de poèmes en prose de la littérature française :
il est
l'évocation
d'un Moyen Age réinventé par le rêve roman
tique.
Or ce que Bertrand a fait pour le passé, Baudelaire
entend le faire pour le présent :
«J'ai une petite confession à vous faire.
C'est en feuille
tant, pour la vingtième fois au moins, le fameux Gaspard
de la Nuit d'Aloysius Bertrand [ ...
) que l'idée m'est
venue de tenter quelque chose d'analogue, et d'appli
quer à la description de la vie moderne, ou plutôt d'une
vie moderne et plus abstraite, le procédé qu'il avait
appliqué
à la peinture de la vie ancienne, si étrangement
pittoresque.»
Et pourtant, conclut Baudelaire de manière particulièrement
ambiguë,
Le Spleen de Paris n'est pas Gaspard de la Nuit:
«Sitôt que j'eus commencé le travail, je m'aperçus que.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Voltaire a écrit : « Tout vers qui n'a pas la précision exacte de la. prose ne vaut rien.» Que pensez-vous de cette définition de la poésie Discutez-la en vous appuyant sur des textes.
- On a dit que la poésie est de bronze; la prose, d'argile. Qu'en pensez-vous ?
- Les véritables différences entre la poésie et la prose
- Que pensez-vous de cette réflexion de d’Alembert (Réflexions sur la poésie) : « Quand on prend la peine de lire des vers, on cherche et on espère un plaisir de plus que si on lisait de la prose » ?
- Baudelaire : la poésie et la prose