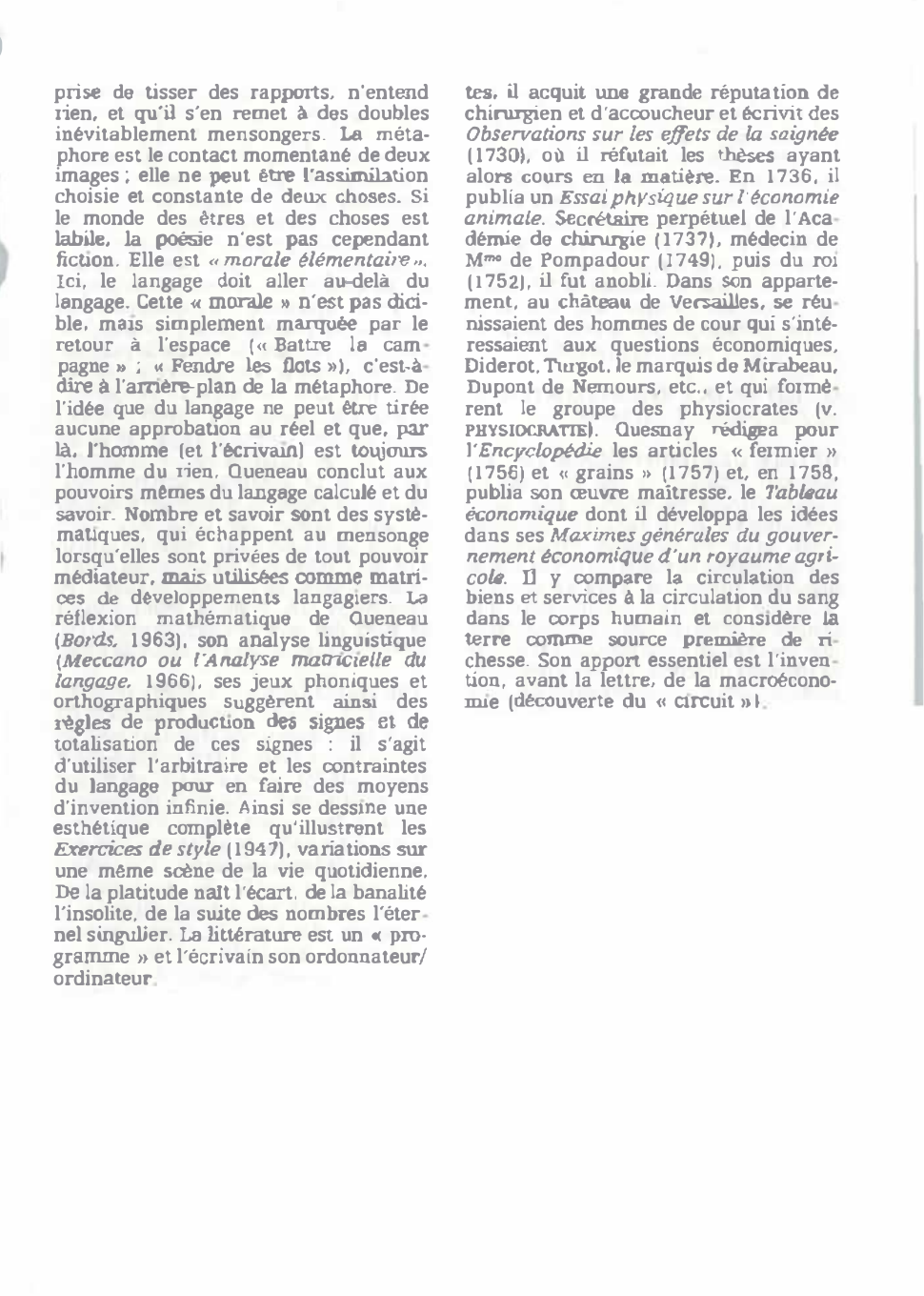QUENEAU (Raymond)
Publié le 17/03/2019

Extrait du document
QUENEAU (Raymond), écrivain français (Le Havre 1903-Paris 1976). Ro mancier, poète, essayiste, il fut aussi mathématicien : s'inspirant des « suites de Fibonacci », il proposa les « suites de Queneau » — successions d'entiers dont chacun est supérieur au précédent et inférieur au suivant et telles qu'à partir d'un certain rang chaque terme est la somme d'exactement s façons différentes de 2 termes antérieurs — et étudia les propriétés combinatoires de la sexti-ne. Queneau fut encore éditeur de l'encyclopédie de la Pléiade, traducteur, fondateur de l'Oulipo, membre du Collège de pataphysique, élu (1951) au sixième couvert de l'Académie Goncourt. Son œuvre, à l'image de cette activité multiple, est cependant parfaitement unitaire. Elle est marquée initialement
par la rupture avec le surréalisme, dont Odile est l'expression romanesque (1937). Elle ne distingue pas réflexion linguistique, poétique et approche psychanalytique [Chêne et Chien, 1937) ; elle réforme le roman suivant des références esthétiques et épistémologiques précises (rapport de la mimêsis littéraire et de l'image-cinéma, construction narrative et combinatoire mathématique), en même temps qu elle use de données philosophiques (rapports du temps et de l'espace) pour suggérer une théorie originale de la fiction [le Chiendent, 1933) : « exposition » de choses et d'êtres à la fois existants et non existants, suivant la fable même du Vol d'Icare (1968), et qui identifie tout roman à la fois à un montage réaliste et à un jeu utopique, à une manière de vaste métaphore (les « vies parallèles » du duc d'Auge et de Cidrolin dans les Fleurs bleues, 1965). Ainsi le roman (les Derniers Jours, 1936 ; Un rude hiver, 1939 ; Pierrot mon ami, 1942 ; Loin de Rueil, 1944 ; On est toujours trop bon avec les femmes, par Sally Mara, 1947 ; Saint-Glinglin, 1948 ; le Dimanche de la vie, 1952 ; Zazie dans le métro, 1959) est-il toujours à la fois exactement quotidien et image d'une organisation systématique dont on ne peut dire si elle a une pertinence. Il n'y a là ni réalisme ni antiréalisme, suivant leurs significations habituelles, mais le constat que tout ce qui est pris dans le langage commande un conventionnalisme dont rien ne peut invalider ni confirmer le bien-fondé. Il y a une machine à montrer et à dire, dont la mécanique est proche, dans son arbitraire, de la démarche même des fous littéraires (les Enfants du limon, 1938). Les mêmes équivoques sont lisibles dans la poésie de Queneau (les Ziaux, 1943 ; Bucoliques, 1947 ; l'instant fatal, 1948 ; Petite Cosmogonie portative, 1950 ; Si tu t'imagines, 1952 ; Cent Mille Milliards de poèmes, 1961 ; le Chien à la mandoline, 1965 ; Courir les rues, 1967 ; Battre la campagne, 1968 ; Fendre les flots, 1969 ; Morale élémentaire, 1975). Toute cette poésie renvoie à un poème, « l'Explication des métaphores », où il est note que le langage, dons son entre
«
' prise
de tisser des rapports, n'entend
rien, et qu'il s'en remet à des doubles
inévitablement mensongers.
La méta
phore est le contact momentané de deux
images; elle ne peut être l'assimilation
choisie et constante do deux choses.
Si
le monde des êtres et des choses est
labile, la poésie n'est pas cependant
ficuon.
Elle est "morale �l�mentaire "·
Ici, le langage doit aller au delà du
langage.
Cette «morale » n'est pas dici
ble, mrus simplement marquée par le
retour à l'espace (.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les Fleurs bleues de Raymond Queneau: HISTOIRE DE L’œUVRE
- ZAZIE DANS LE MÉTRO de Raymond Queneau
- ZAZIE DANS LE MÉTRO de Raymond Queneau (résumé & analyse)
- PIERROT MON AMI de Raymond Queneau : Fiche de lecture
- ZAZIE DANS LE MÉTRO. Raymond Queneau (résumé & analyse)