« Qu'est-ce qu'il faut au poète? Est-ce une nature brute ou cultivée, paisible ou troublée? Préférera-t-il la beauté d'un jour pur et serein à l'horreur d'une nuit obscure, où le sifflement interrompu des vents se mêle par intervalles au murmure sourd et continu d'un tonnerre éloigné, et où il voit l'éclair allumer le ciel sur sa tête? Préférera-t-il le spectacle d'une mer tranquille à celui des flots agités? le muet et froid aspect d'un palais, à la promenade parmi des ruines? un édif
Publié le 13/03/2011

Extrait du document
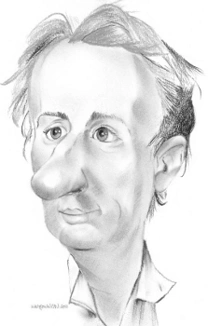
« Qu'est-ce qu'il faut au poète? Est-ce une nature brute ou cultivée, paisible ou troublée? Préférera-t-il la beauté d'un jour pur et serein à l'horreur d'une nuit obscure, où le sifflement interrompu des vents se mêle par intervalles au murmure sourd et continu d'un tonnerre éloigné, et où il voit l'éclair allumer le ciel sur sa tête? Préférera-t-il le spectacle d'une mer tranquille à celui des flots agités? le muet et froid aspect d'un palais, à la promenade parmi des ruines? un édifice construit, un espace planté de la main des hommes, au touffu d'une antique forêt, au creux ignoré d'une roche déserte? des nappes d? eau, des bassins, des cascades, à la vue d'une cataracte qui se brise en tombant à travers des rochers, et dont le bruit se fait entendre au loin du berger qui a conduit son troupeau dans la montagne et qui l'écoute avec effroi? « Commentez ce passage de Diderot. Que pensez-vous de son style? Caractérisez les deux sortes de poésie que l'auteur oppose, et recherchez dans quelle mesure elles peuvent correspondre respectivement au classicisme et au romantisme.
Liens utiles
- J.-J. Rousseau écrit dans sa troisième « Lettre à M. de Malesherbes » : « L'or des genêts et la pourpre des bruyères frappaient mes yeux d'un luxe qui touchait mon coeur; la majesté des arbres qui me couvraient de leur ombre, la délicatesse des arbustes qui m'environnaient, l'étonnante variété des herbes et des fleurs que je foulais sous mes pieds tenaient mon esprit dans une alternative continuelle d'observation et d'admiration : le concours de tant d'objets intéressants qui se disput
- Victor Hugo écrit : «La nature procède par contrastes. C'est par les oppositions qu'elle fait saillir les objets. C'est par leurs contraires qu'elle fait sentir les choses, le jour par la nuit, le chaud par le froid, etc.; toute clarté fait ombre. De là le relief, le contour, la proportion, le rapport, la réalité. La création, la vie, le destin, ne sont pour l'homme qu'un immense clair-obscur. Le poète, ce philosophe du concret et ce peintre de l'abstrait, le poète, ce penseur suprême,
- Vous analyserez la page suivante, en vous demandant si elle n'illustre pas la doctrine poétique de Paul Valéry : Je passais il y a quelque temps sur le Pont de Londres, et m'arrêtai pour regarder ce que j'aime : le spectacle d'une eau riche et lourde et complexe parée de nappes de nacre, troublée de nuages de fange... Je fus arrêté par les yeux; je m'accoudai contraint comme par un vice. La volupté de voir me tenait, de toute la force d'une soif, fixé à la lumière délicieusement compos
- Expliquez et discutez ce jugement de Montaigne sur la poésie : « Voici merveille : il y a bien plus de poètes que de juges et interprètes de poésie. Il est plus aisé de la faire que de la connaître. A certaine mesure basse, on peut la juger par les préceptes et par art. Mais la bonne, l'excessive, la divine est au-dessus des règles et de la raison. Quiconque en discerne la beauté d'une vue ferme et rassise, il ne la voit pas, non plus que la splendeur d'un éclair. » (Essais, I, 37.)
- Commentez ces lignes d'André Maurois : «La plupart des écrivains, consciemment ou non, fardent la vie ou la déforment ; les uns parce qu'ils n'osent pas montrer la vanité de tout ce à quoi s'attachent les hommes et eux-mêmes ; les autres parce que leurs propres griefs leur cachent ce qu'il y a, dans le monde, de grandeur et de poésie ; presque tous parce qu'ils n'ont pas la force d'aller au-delà des apparences et de délivrer la beauté captive. Observer ne suffit pas ; il faut pénétrer































