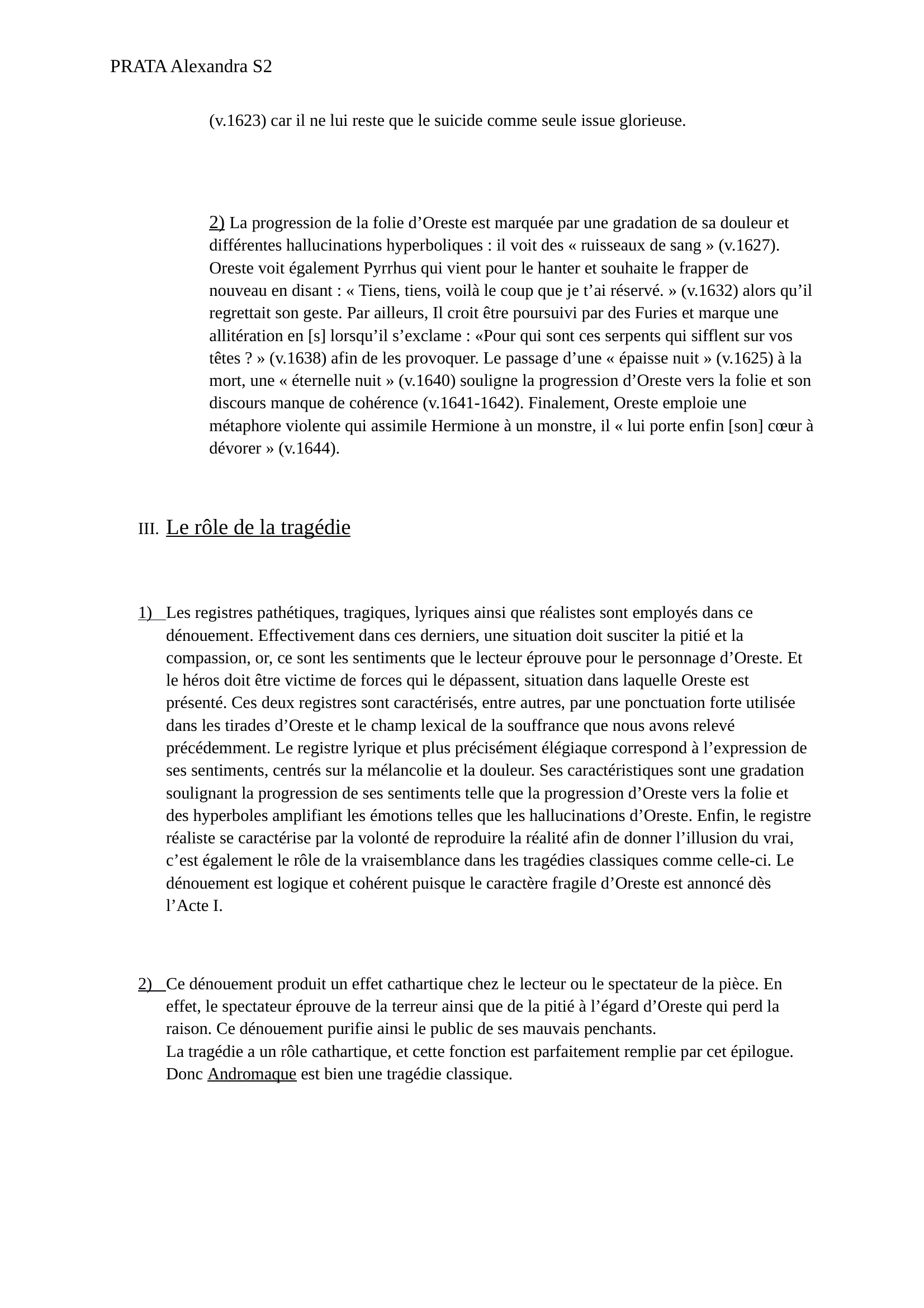racine andromaque
Publié le 10/04/2013

Extrait du document


«
PRATA Alexandra S2
(v.1623) car il ne lui reste que le suicide comme seule issue glorieuse.
2) La progression de la folie d’Oreste est marquée par une gradation de sa douleur et
différentes hallucinations hyperboliques : il voit des « ruisseaux de sang » (v.1627).
Oreste voit également Pyrrhus qui vient pour le hanter et souhaite le frapper de
nouveau en disant : « Tiens, tiens, voilà le coup que je t’ai réservé.
» (v.1632) alors qu’il
regrettait son geste.
Par ailleurs, Il croit être poursuivi par des Furies et marque une
allitération en [s] lorsqu’il s’exclame : «Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos
têtes ? » (v.1638) afin de les provoquer.
Le passage d’une « épaisse nuit » (v.1625) à la
mort, une « éternelle nuit » (v.1640) souligne la progression d’Oreste vers la folie et son
discours manque de cohérence (v.1641-1642).
Finalement, Oreste emploie une
métaphore violente qui assimile Hermione à un monstre, il « lui porte enfin [son] cœur à
dévorer » (v.1644).
III.
Le rôle de la tragédie
1) Les registres pathétiques, tragiques, lyriques ainsi que réalistes sont employés dans ce
dénouement.
Effectivement dans ces derniers, une situation doit susciter la pitié et la
compassion, or, ce sont les sentiments que le lecteur éprouve pour le personnage d’Oreste.
Et
le héros doit être victime de forces qui le dépassent, situation dans laquelle Oreste est
présenté.
Ces deux registres sont caractérisés, entre autres, par une ponctuation forte utilisée
dans les tirades d’Oreste et le champ lexical de la souffrance que nous avons relevé
précédemment.
Le registre lyrique et plus précisément élégiaque correspond à l’expression de
ses sentiments, centrés sur la mélancolie et la douleur.
Ses caractéristiques sont une gradation
soulignant la progression de ses sentiments telle que la progression d’Oreste vers la folie et
des hyperboles amplifiant les émotions telles que les hallucinations d’Oreste.
Enfin, le registre
réaliste se caractérise par la volonté de reproduire la réalité afin de donner l’illusion du vrai,
c’est également le rôle de la vraisemblance dans les tragédies classiques comme celle-ci.
Le
dénouement est logique et cohérent puisque le caractère fragile d’Oreste est annoncé dès
l’Acte I.
2) Ce dénouement produit un effet cathartique chez le lecteur ou le spectateur de la pièce.
En
effet, le spectateur éprouve de la terreur ainsi que de la pitié à l’égard d’Oreste qui perd la
raison.
Ce dénouement purifie ainsi le public de ses mauvais penchants.
La tragédie a un rôle cathartique, et cette fonction est parfaitement remplie par cet épilogue.
Donc Andromaque est bien une tragédie classique..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Andromaque de Racine, III, 7
- Le personnage de CÉPHISE de Jean Racine Andromaque
- Racine, dramaturge majeur du XVII, auteur de nombreuses tragédies dites classiques comme Bérénice, Britannicus, Andromaque.
- Andromaque (résumé & analyse) Racine
- Le personnage de CLÉONE de Jean Racine Andromaque