RADIGUET Raymond
Publié le 29/11/2018

Extrait du document
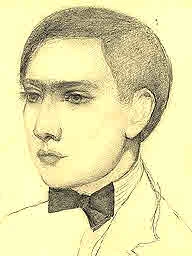
RADIGUET Raymond (1903-1923). Sa carrière météorique et la perpétuation de son culte par Jean Cocteau ont valu à Raymond Radiguet une légende d’enfant prodige que, dans sa volonté constante de démythification, il aurait sans doute désavouée car elle a trop souvent occulté ses qualités profondes de créateur. Chantre d’un nouveau classicisme dans le chaos de l’après-guerre, il a su concilier l’organisation parfaite d’un récit où la psychologie se fait romanesque et l’« esprit de légèreté » qui émane de ses premiers poèmes, à la thématique discrètement libertine et au ton de préciosité ironique.
L'homme aux semelles de feu
« Je flambais, je me hâtais, comme les gens qui doivent mourir jeunes et qui mettent les bouchées doubles » : on pourrait appliquer à Radiguet cette phrase qu’il prête au narrateur du Diable au corps. Il passe son enfance à Saint-Maur, sur les bords de Marne. A ses études, interrompues assez tôt, suppléent moins les leçons paternelles que les débauches de lecture que lui permettent ses nombreux loisirs. Il se forme à l’école des grands maîtres, sans négliger les poètes contemporains : Apollinaire, Max Jacob, Cocteau deviennent les classiques qu’il rêve de contredire. Dès 1918, il a l’occasion de les rencontrer, par l’intermédiaire d’André Salmon, collaborateur de l'intransigeant, où son père, Maurice Radiguet, publiait des caricatures. Raymond signe lui-même des dessins, sous le pseudonyme de Rajki. A quinze ans il débute dans le journalisme, et des revues d’avant-garde (Sic, Littérature) font paraître certains de ses poèmes; il s’impose rapidement dans les milieux artistiques : inséparable de Cocteau — avec qui il entretient des rapports dialectiques de maître à disciple et
compose, sur une musique de Satie, l’opéra-comique Paul et Virginie (1920) —, il hante «le Bœuf sur le toit », fréquente le groupe des Six, les peintres cubistes et participe à des manifestations mystificatrices — le Gendarme incompris, parodie de Mallarmé — ou loufoques — avec son unique pièce, les Pélicans (1921). Bien qu’il compte Tzara et Breton parmi ses correspondants, Radiguet ne se réclame d’aucune chapelle et sait, avec Cocteau, s’abstraire de l’effervescence parisienne pour écrire. En 1920, ses poèmes paraissent sous le titre les Joues en feu. Dans ce carnet de vacances, les procédés modernes de collage de thèmes et de rapprochements insolites, par le biais des comparaisons — « la route nationale mollement se déroule, comme [une] bande molletière » — ou des rimes — « menthe » et « amante », « glace à la framboise » et « aube narquoise » —, servent un refus du débordement lyrique et une apologie du quotidien, voire de l’insignifiant (les poèmes «Tombola», « Carte postale »), sans exclure l’usage de l’appareil narratif de la poésie traditionnelle et précieuse, où le poète dialogue avec Vénus, Narcisse, Léda et entraîne les nymphes de la Marne dans des jeux qui n’ont de l’innocence que le nom. Après la publication de cette plaquette, les œuvres de Radiguet empruntent désormais la forme romanesque qui fait valoir ses talents d’analyste. Entrepris dès 1919, son premier roman, le Diable au corps, obtient, en mars 1923, un succès dû autant aux méthodes de lancement employées par Bernard Grasset qu’à ses qualités intrinsèques. « Fausse autobiographie », l’œuvre est centrée sur l’anatomie d’une liaison entre un adolescent et une jeune femme, Marthe, dont le mari combat au front. Radiguet insiste lui-même sur le rôle des circonstances dans ce « drame de F avant-saison du cœur » qui participe du roman d’éducation et du poème tragique : « On y voit la liberté, le désœuvrement dus à la guerre façonner un jeune garçon et tuer une jeune femme ». Quelques mois plus tard, une fièvre typhoïde s’empare de Radiguet; en décembre, ange Heurtebise, il est « fusillé par les soldats de Dieu », avant d’avoir pu corriger les épreuves de son second roman, le Bal du comte d'Orgel (posth., 1924), qui a souvent été assimilé à une version moderne de la Princesse de Clèves.
« Du Laclos sans s'en douter »?
L’œuvre de Radiguet s’inscrit sous le signe de la lucidité et, concrètement, de l’ange déchu qui en est l’incarnation : Lucifer. Ses textes, porteurs de lumière dans leur traitement de l’investigation psychologique, revêtent aussi une dimension satanique à travers le libertinage et l’immoralisme tranquilles qui s’y diffusent. Max Jacob, en rapprochant le Diable des Liaisons dangereuses, mit l’accent sur son dix-huitiémisme ambiant, plus concerté qu’il n’y paraît. On y retrouve l’érotisme en filigrane des Joues en feu
Les petits pois de son corsage S'éparpillèrent sous les doigts D'un amant cueilli au passage
« l'Autre Bouche » et de la nouvelle maniériste Denise (posth., 1926), que transcende le tragique de la partie d’escarpolette relatée dans un épisode des Carnets (posth., 1924), véritable préfiguration métaphorique du Diable. Le libertinage, qui se désigne comme tel à trois reprises dans ce roman, est pratiqué par les héros — lettres écrites au mari sous la dictée de l’amant — ou retourné contre les prétendus garants de la morale — voyeurisme des voisins. Mais dans le Diable et surtout dans le Bal — selon son auteur, « aussi scabreux que le roman le moins chaste » —, le satanisme réside plutôt dans son application à la psychologie, où la lucidité devient voyance. Le narrateur, malin génie, diable ingambe, s’ingénie à soulever les masques,
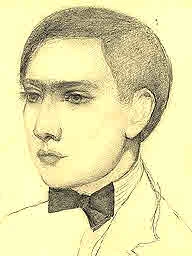
«
à
meure à nu, voire à vif les cœurs de ses personnages
afin de désigner comme illusion les sentiments qu'ils
affichent ou dont ils se jouent à eux-mêmes la comédie.
Radiguet traduit en une langue lumineuse et démonstra
tive les mouvements imperceptibles, les ébauches de
désirs, les sous-conversations qui logent dans les arcanes
des consciences et président aux rapports humains, irré
médiablement voués au malentendu.
On a pu voir, ainsi,
la peinture d'un «enfer de l'amour» (Claude-Edmonde
Magny) dans ces romans fondés sur 1' analyse pénétrante
des intermittences du cœur.
Celle-ci débouche sur la
mise en lumière de travers universels : 1 'égoïsme, la
bonne conscience ...
Le narrateur du Diable déclare, à
propos de la mère de Marthe : « Afin qu'elle eût tous les
motifs de me déplaire sans que je me reprochasse d'être
injuste, je souhaitais qu'elle employât des façons de par
ler assez communes.
Sur ce point elle me déçut >>.
L'ana
lyse suit généralement une démarche qui la conduit de
1 'acte -verbal ou non -au sens que le sujet lui attri
bue, puis, avant 1' ascension possible vers la maxime, au
rétablissement du sens par le narrateur ou à la proposi
tion d'un échantillonnage d'interprétations; témoin
l'énumération méthodique des lecture d'un sourire dans
le Bal : «C'était soit : "Mais non, je vous assure, je suis
très bien, il ne fait pas froid du tout", soit le sourire qui
pardonne [ ...
] Peut-être ne reflétait-i 1 que le plaisir d'un
enfant qui fait une promenade».
Le plus souvent, le
narrateur impose une valeur de vérité, univoque,
transcendante.
Le texte de fiction devient alors le lieu où
le discours du paraître vole en éclats et où le vrai éclate
dans le laconisme des mots qui s'abauent sur le clavier
de la phrase.
Dans le Diable.
« faus.
e
confessions»,
l'échelonnement des sens trouve son autojustification
dans la fiction, où il est imputable au regard que le
narrateur adulte porte sur son moi passé.
Par contre.
dans le Bal, i 1 risque de mettre 1 'accent sur 1' artifice
romanesque en insistant de façon redondante sur l'om
niscience du narrateur extérieur au récit.
D'où le statisme
et le moralisme systématique et suranné qui sont parfois
reprochés au Bal.
Mais ce roman néoclassique ne déve
loppe-t-il pas, au contraire, chez le lecteur une attitude
moderne en dt!plaçant le champ de son activité critique,
qui n'a plus à s'exercer sur les personnages comme
« êtres de chair », mais comme «êtres de lettres >>?
Une banalité précieuse
>.
Radiguet, lui.
a l'insolence d'écrire comme tout le
monde à une époque où chacun entend écrire comme
personne, et il atteint l'originalité en cultivant la perfec
tion classique du récit.
Ses romans, dont Valéry appré
ciait- surtort à propos du Diable- > (fin du Diable).
Dans le Bal, la circularité
est telle que la conclusion du récit est à rechercher dans
la longue introduction historique.
Récit clos, le Bail' est
aussi par sa relation à lïntertexte de la littérature médié
vale (quête, philtre d'amour) et classique (Mme de La
Fayette).
De plus, autour du centre solaire défini par
le couple ou la triade des protagonistes, gravitent des
personnages secondaires qui ne sont autres que les ava
tars de ces derniers, des lieux très symboliques (Robin-son,
Médrano) et des motifs hautement signifiants (le
> ).
Par le biais du mythe et des incur
sions insensibles dans l'irréel, le roman rejoint la poésie,
cette qui, bien plus que leur pitto
resque, frappait le narrateur du Diable.
Il s'agit d'une
poésie « qui tient plus de la précision que du vague >> (le
Bal), une poésie que Radiguet qualifiait de précieuse.
comme le diamant avec lequel il entaille la surface de
verre des apparences.
Il approche 1' idéal de la poésie de
roman que Jean Cocteau a poursuivi dans ses propres
récits Thomas l'Imposteur et le Grand Écart, contempo
rains du Bal.
Sagacité de l'analyse, concision du style,
maîtrise d'un appareil narratif qui se ressource aux clas
siques tout en renouvelant le roman psychologique
confèrent à Raymond Radiguet le statut de phénomène
des lettres françaises.
BIBLIOGRAPHIE Éditions.
-Le Diable au corps, tiré à qu ara nte mille exemplai
res en mars 1923.
de best-seller est devenu un classi que et est
r é g ulièr eme nt réédité, ainsi que le Bal du comre d'Org e/ , dans la
c ol l.
«Folio>>.
Par contre, il était difficile de se procurer les
Joues enfeu avant la p aru ti o n des Œuvres comp/ères deR.
Radi
guet chez Grasset en 1952 (ré éd.
coll.
>, Slatk in e ,
1978): sign alo ns aussi r édition tr ès com plète pub lié e en 1959
par le «Club des Libraires de France» ct surtout celle publiée
chez Stock en 1993 par C .
Radiguet et J.
Cendres.
Les adapta
tions cinématographiques du Diab le au corps par Claude Autant
La ra ( 1947) et celle du Bal du comte d'Orge/ par Marc Allégre t
(1970) n'ont pu qu'a tti re r à Radiguet de nouveaux le c te u rs .
A consulter.
-A la passionnante et syn th étique étude de
C.
Borgal.
Raymond Radiguet.
Paris, Édi ti o ns universitaires,
1969.
on aj o uter a : D.
Noak es, Raymond Radiguet, Paris,
Seghers, 1968: N.
Odouard.
les Années folles de Raymond Radi
guet, Par is, Seghers.
1973, et Radiguer et l'amour.
th è se , Paris
VIl (dactyl.): M.C.
Berto let ti , «le Diable au corps ..
de Radi·
guer, Flo re n ce , la Nuova ltalia, 1981.
P.
BOISSEAU.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La morale et l'amour, un mariage impossible avec le roman le diable au corps de raymond radiguet
- Le Diable au corps de Raymond Radiguet (analyse détaillée)
- Incipit - Diable au corps - Raymond Radiguet
- Diable au corps (le). Roman de Raymond Radiguet (analyse détaillée)
- Le personnage de FRANÇOIS de Raymond Radiguet

































