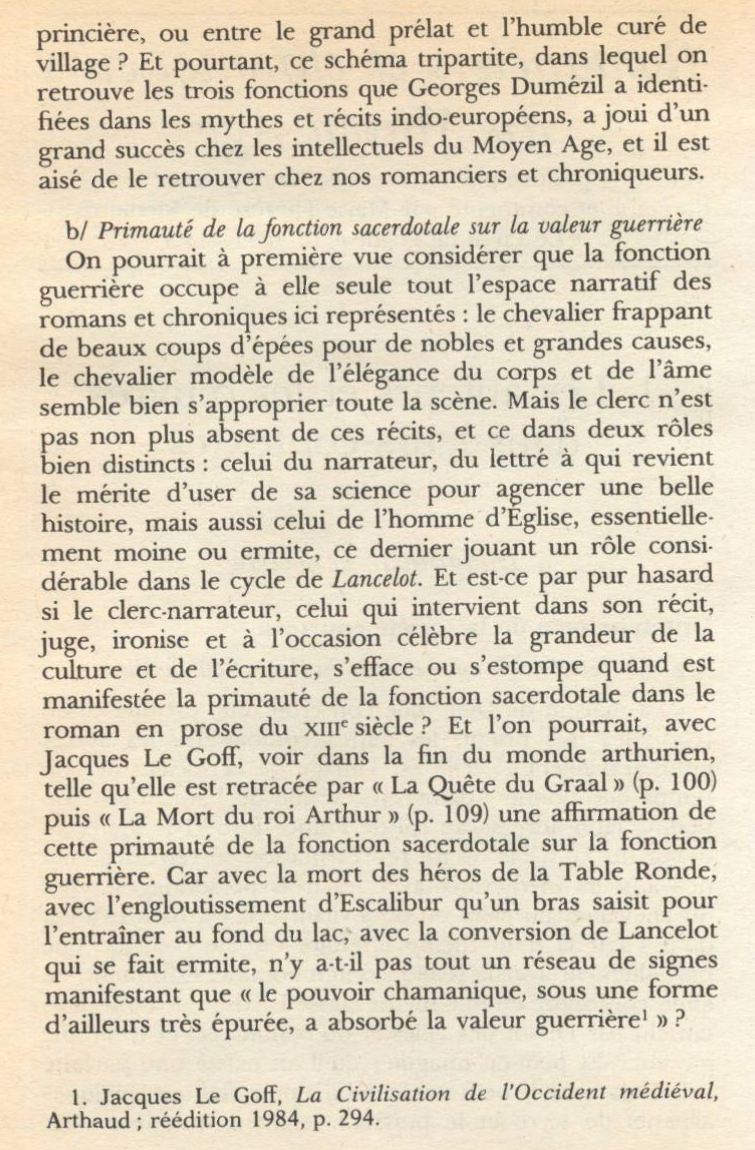Romanciers et Chroniqueurs au Moyen-Age
Publié le 15/07/2011

Extrait du document
« La maison de Dieu, que l'on croit une, est divisée en trois : les uns prient, les autres combattent, les autres enfin travaillent « : telle est l'image de la société de son temps que donne Adalbéron, évêque de Laon, dans son poème latin adressé au roi de France Robert le Pieux au début du xie siècle. Cette représentation se retrouve chez nos auteurs médiévaux avec les trois personnages types du chevalier, du clerc ou du « vilain «. Il est bien évident qu'il s'agit là d'un thème littéraire qui ne coïncide que partiellement avec la réalité contemporaine. Comment, en effet, confondre en une même classe l'artisan, le bourgeois enrichi par l'essor des villes et du commerce, et le simple paysan ? Et peut-on imaginer qu'il ait existé une parfaite cohésion entre le petit noble qui n'a pour fief que quelques arpents de terre et le puissant seigneur qui tient cour...
«
princière, ou entre le grand prélat et l'humble curé de
village ?Et pourtant, ce schéma tripartite, dans lequel on
retrouve les trois fonctions que Georges Dumézil a identi
fiées dans les mythes et récits indo-européens, ajoui d'un
grand succès chez les intellectuels du Moyen Age, et ilest
aisé de leretrouverchez nosromanciers etchroniqueurs.
b/ Primauté de lafonction sacerdotale sur la valeur guerrière
On pourrait àpremière vue considérer que la fonction
guerrière occupe à elle seule tout l'espace narratif des
romans et chroniques ici représentés : le chevalier frappant
de beaux coups d'épées pour de nobles et grandes causes,
le chevalier modèle de l'élégance du corps et de l'âme
semble bien s'approprier toute la scène. Mais le clerc n^est
pas non plus absent de ces récits, et ce dans deux rôles
bien distincts : celui du narrateur,dulettré à qui revient
le mérite d'user de sa science pour agencer une belle
histoire, mais aussi celui de l'homme d'Eglise, essentielle
ment moine ou ermite, ce dernier jouant un rôle consi
dérable dans le cycle de Lancelot. Et est-ce par pur hasard
si leclerc-narrateur, celui quiintervient dans son récit,
juge, ironise et à l'occasion célèbre la grandeur de la
cukureet de l'écriture, s'efface ou s'estompe quand est
manifestée la primauté de la fonction sacerdotale dans le
roman en prose du xme siècle ? Et l'on pourrait, avec
Jacques Le Goff, voir dans la fin du monde arthurien,
telle qu'elle est retracée par «La Quête du Graal »(p. 100)
puis «La Mort du roi Arthur »(p. 109) une affirmation de
cette primauté de la fonction sacerdotale sur la fonction
guerrière. Car avec la mort des héros de la Table Ronde,
avec l'engloutissement d'Escalibur qu'un bras saisit pour
l'entraîner au fond du lac, avec la conversiondeLancelot
qui se fait ermite, n'y a-t-il pas tout un réseau de signes
manifestant que «le pouvoir chamanique, sous une forme
d'ailleurs très épurée, aabsorbé la valeur guerrière1 » ?
1. Jacques Le Goff, La Civilisation de l'Occident médiéval, Arthaud ;réédition 1984, p.
294.. »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LES CHRONIQUEURS DU MOYEN AGE: VILLEHARDOUIN
- LA MUSIQUE AU MOYEN AGE
- L’Europe à la fin du Moyen-Age (fin du XIIIème – fin XVème siècle)
- Le Moyen Age : tendances générales en philosophie
- Texte n°1: Ferdinand Lot, « La fin du monde antique et le début du Moyen Age »