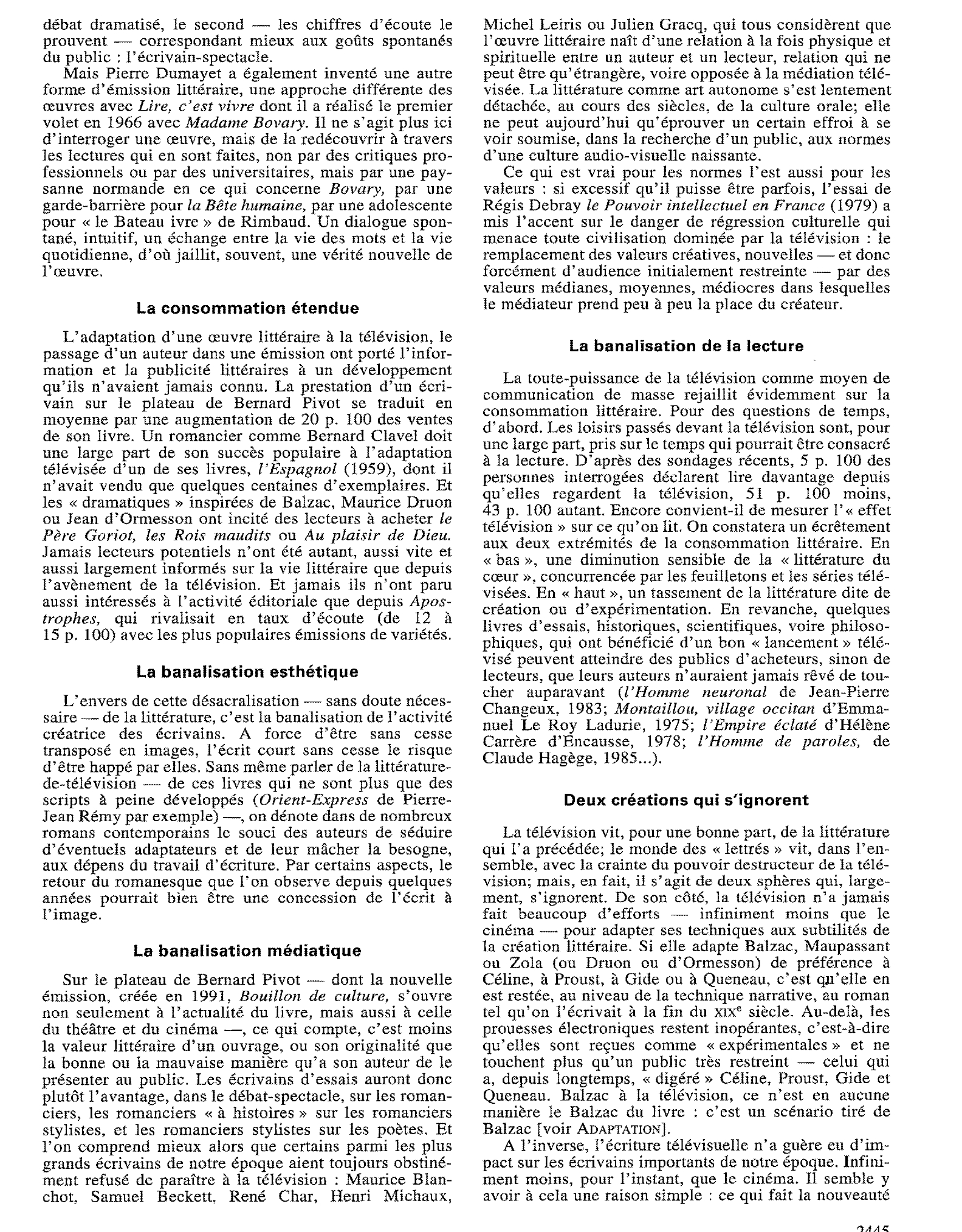TÉLÉVISION ET LITTÉRATURE
Publié le 15/10/2018

Extrait du document
«
débat dramatisé, le second les chiffres d'écoute le prouvent - correspondant mieux aux goûts spontanés du public : l'écrivain-spectacle.
Mais Pierre Dumayet a également inventé une autre forme d'émission littéraire, une approche différente des œuvres avec Lire, c'est vivre dont il a réalisé le premier volet en 1966 avec Madame Bovary.
Il ne s'agit plus ici d'interroger une œuvre, mais de la redécouvrir à travers les lectures qui en sont faites, non par des critiques pro fessionnels ou par des universitaires, mais par une pay sanne normande en ce qui concerne Bovary, par une garde-barrière pour la Bête humaine, par une adolescente pour « le Bateau ivre » de Rimbaud.
Un dialogue spon tané, intuitif, un échange entre la vie des mots et la vie quotidienne, d'où jaillit, souvent, une vérité nouvelle de l'œuvre.
La consommation étendue
L'adaptation d'une œuvre littéraire à la télévision, le passage d'un auteur dans une émission ont porté l'infor mation et la publicité littéraires à un développement qu'ils n'avaient jamais connu.
La prestation d'un écri vain sur le plateau de Bernard Pivot se traduit en moyenne par une augmentation de 20 p.
100 des ventes de son livre.
Un romancier comme Bernard Clavel doit une large part de son succès populaire à l'adaptation télévisée d'un de ses livres, l'Espagnol (1959), dont il n'avait vendu que quelques centaines d'exemplaires.
Et les «dramatiques» inspirées de Balzac, Maurice Druon ou Jean d'Ormesson ont incité des lecteurs à acheter le Père Goriot, les Rois maudits ou Au plaisir de Dieu.
Jamais lecteurs potentiels n'ont été autant, aussi vite et aussi largement informés sur la vie littéraire que depuis l'avènement de la télévision.
Et jamais ils n'ont paru aussi intéressés à l'activité éditoriale que depuis Apos trophes, qui rivalisait en taux d'écoute (de 12 à
15 p.
100) avec les plus populaires émissions de variétés.
La banalisation esthétique
L'envers de cette désacralisation - sans doute néces saire de la littérature, c'est la banalisation de l'activité créatrice des écrivains.
A force d'être sans cesse transposé en images, l'écrit court sans cesse le risque d'être happé par elles.
Sans même parler de la littérature de-télévision de ces livres qui ne sont plus que des scripts à peine développés (Orient-Express de Pierre Jean Rémy par exemple)-, on dénote dans de nombreux romans contemporains le souci des auteurs de séduire d'éventuels adaptateurs et de leur mâcher la besogne, aux dépens du travail d'écriture.
Par certains aspects, le retour du romanesque que l'on observe depuis quelques années pourrait bien être une concession de l'écrit à l'image.
La banalisation médiatique
Sur le plateau de Bernard Pivot dont la nouvelle émission, créée en 1991, Bouillon de culture, s'ouvre non seulement à l'actualité du livre, mais aussi à celle du théâtre et du cinéma-, ce qui compte, c'est moins la valeur littéraire d'un ouvrage, ou son originalité que la bonne ou la mauvaise manière qu'a son auteur de le présenter au public.
Les écrivains d'essais auront donc plutôt l'avantage, dans le débat-spectacle, sur les roman ciers, les romanciers « à histoires » sur les romanciers stylistes, et les romanciers stylistes sur les poètes.
Et l'on comprend mieux alors que certains parmi les plus
grands écrivains de notre époque aient toujours obstiné ment refusé de paraître à la télévision : Maurice Blan chot, Samuel Beckett, René Char, Henri Michaux,
Michel Leiris ou Julien Gracq, qui tous considèrent que l'œuvre littéraire naît d'une relation à la fois physique et
spirituelle entre un auteur et un lecteur, relation qui ne peut être qu'étrangère, voire opposée à la médiation télé
visée.
La littérature comme art autonome s'est lentement détachée, au cours des siècles, de la culture orale; elle ne peut aujourd'hui qu'éprouver un certain effroi à se voir soumise, dans la recherche d'un public, aux normes d'une culture audio-visuelle naissante.
Ce qui est vrai pour les normes l'est aussi pour les
valeurs : si excessif qu'il puisse être parfois, l'essai de Régis Debray le Pouvoir intellectuel en France (1979) a
mis 1' accent sur le danger de régression culturelle qui menace toute civilisation dominée par la télévision : le remplacement des valeurs créatives, nouvelles- et donc forcément d'audience initialement restreinte par des
valeurs médianes, moyennes, médiocres dans lesquelles le médiateur prend peu à peu la place du créateur.
La banalisation de la lecture
La toute-puissance de la télévision comme moyen de communication de masse rejaillit évidemment sur la consommation littéraire.
Pour des questions de temps, d'abord.
Les loisirs passés devant la télévision sont, pour une large part, pris sur le temps qui pourrait être consacré à la lecture.
D'après des sondages récents, 5 p.
100 des personnes interrogées déclarent lire davantage depuis qu'elles regardent la télévision, 51 p.
100 moins,
43 p.
100 autant.
Encore convient-il de mesurer l'« effet télévision » sur ce qu'on lit.
On constatera un écrêtement aux deux extrémités de la consommation littéraire.
En « bas », une diminution sensible de la « littérature du cœur», concurrencée par les feuilletons et les séries télé
visées.
En «haut», un tassement de la littérature dite de création ou d'expérimentation.
En revanche, quelques livres d'essais, historiques, scientifiques, voire philoso phiques, qui ont bénéficié d'un bon « lancement» télé visé peuvent atteindre des publics d'acheteurs, sinon de lecteurs, que leurs auteurs n'auraient jamais rêvé de tou cher auparavant (l'Homme neuronal de Jean-Pierre Changeux, 1983; Montaillou, village occitan d'Emma nuel Le Roy Ladurie, 1975; l'Empire éclaté d'Hélène Carrère d'Encausse, 1978; l'Homme de paroles, de Claude Hagège, 1985 ...
).
Deux créations qui s'ignorent
La télévision vit, pour une bonne part, de la littérature qui l'a précédée; le monde des « lettrés » vit, dans l'en semble, avec la crainte du pouvoir destructeur de la télé
vision; mais, en fait, il s'agit de deux sphères qui, large
ment, s'ignorent.
De son côté, la télévision n'a jamais fait beaucoup d'efforts - infiniment moins que le cinéma pour adapter ses techniques aux subtilités de la création littéraire.
Si elle adapte Balzac, Maupassant ou Zola (ou Druon ou d'Ormesson) de préférence à Céline, à Proust, à Gide ou à Queneau, c'est qn'elle en est restée, au niveau de la technique narrative, au roman tel qu'on l'écrivait à la fin du xrxe siècle.
Au-delà, les prouesses électroniques restent inopérantes, c'est-à-dire qu'elles sont reçues comme « expérimentales » et ne touchent plus qu'un public très restreint -celui qui a, depuis longtemps, « digéré » Céline, Proust, Gide et Queneau.
Balzac à la télévision, ce n'est en aucune manière le Balzac du livre : c'est un scénario tiré de Balzac [voir ADAPTATION].
A l'inverse, l'écriture télévisuelle n'a guère eu d'im
pact sur les écrivains importants de notre époque.
Infini ment moins, pour l'instant, que le cinéma.
Il semble y avoir à cela une raison simple : ce qui fait la nouveauté.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La littérature a-t-elle quelque chose à attendre de la télévision ?
- Anatole France a écrit : « J'aime la vérité : je crois que l'humanité en a besoin; mais elle a un plus grand besoin encore du mensonge qui la flatte, la console, lui donne des espérances infinies. Sans le mensonge, elle périrait de désespoir et d'ennui. » Vous semble-t-il que dans la production actuelle — qu'il s'agisse de littérature, de cinéma, de télévision — ce qui assure le succès soit justement ce mensonge ? (Vous pouvez choisir entre la littérature, le cinéma, la télévision. Vou
- Anatole France a écrit : « J'aime la vérité : je crois que l'humanité en a besoin ; mais elle a un plus grand besoin encore du mensonge qui la flatte, la console, lui donne des espérances infinies. Sans le mensonge, elle périrait de désespoir et d'ennui ». Vous semble-t-il que dans la production actuelle — qu'il s'agisse de littérature, de cinéma, de télévision — ce qui assure le succès soit justement le mensonge ?
- Giraudoux, Kleber Haedens ont écrit chacun une histoire de la littérature française, le président Pompidou fut l'auteur 6'une Anthologie de la Poésie française, l'actuel Président de la République paraît à la télévision pour parler de Maupassant... Ainsi chacun, spécialiste ou non, tient à nous faire connaître et partager ses goûts littéraires. Si une telle occasion vous était donnée, quelle œuvre ou quelles œuvres choisiriez-vous de présenter et de mettre en valeur? Justifiez votre ch
- Êtes-vous de ceux à qui la littérature a encore quelque chose à dire en face des nouvelles formes d'expression (cinéma, télévision, bandes dessinées) qui la concurrencent aujourd'hui ?