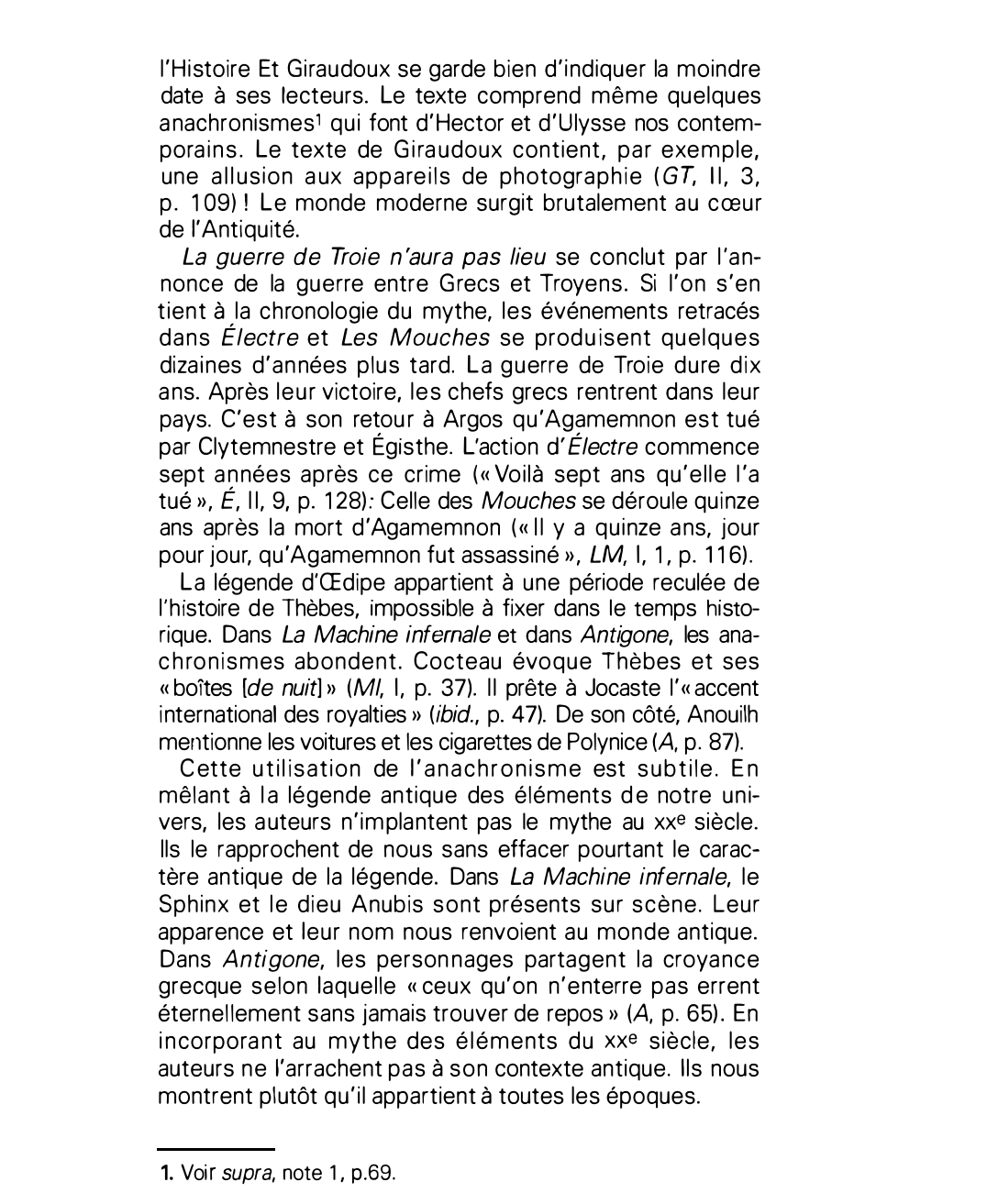Temps et mythe
Publié le 18/09/2018

Extrait du document

■ LE TEMPS MYTHIQUE
Le mythe se situe dans un passé lointain, à une date qu'on ne peut fixer de manière très rigoureuse. Giraudoux le place «au début des ères humaines1 ». Ce n'est donc pas une histoire qui se déroule sous nos yeux et dont l'issue est encore incertaine. C'est un récit bien connu dont on sait d'emblée que sa fin est inévitable.
À quelle époque sommes-nous 7
Il est difficile de situer dans le temps l'action de ces cinq pièces.
La guerre de Troie n'aura pas lieu précède immédiatement la guerre de Troie qui eut lieu au deuxième millénaire av. J.-C. Mais le temps du mythe n'est pas le temps de

«
l'His
toire Et Gir aud oux se garde bien d'indiquer la moindr e
date à ses lecteurs.
Le texte comprend même quelque s
an achronismes, qui font d'Hector et d'U lysse nos contem
por ains.
Le texte de Giraudoux contient, par exemp le,
une allusion aux appar eils de photogra phie (GT.
Il, 3,
p.
1 09) ! Le monde moderne surgit brutalement au cœur
de l'An tiqui té.
La guer re de Troie n'aura pas lieu se conclut par l'an
nonce de la guerre entre Grecs et Troy ens.
Si l'on s'en
tient à la chr onologie du mythe, les événements retracés
dans Électre et Les Mouches se produisent quelques
diz aine s d'an nées plus tard.
La guerre de Troie dur e dix
an s.
Après leur victoire, les chefs grecs rentrent dans leur
pays.
C'est à son retour à Argos qu'Agamemnon est tué
par Clytemne stre et Égisthe.
L'action d'Électre commence
sept années après ce crime («Voilà sept ans qu'elle l'a
tué », É, Il, 9, p.
128): Celle des Mouches se déroule quinze
ans après la mort d'Ag amemnon («Il y a quin ze ans, jour
pour jour, qu' Agamemnon fut assas siné», LM.
1, 1, p.
116 ).
La légende d'Œdipe appartient à une période reculée de
l'hi stoire de Thèbes, impossible à fixer dans le temps histo
rique.
Dans La Machine infernale et dans Antigone, les ana
chr onisme s abondent.
Cocteau évoque Thèbes et ses
«b oîtes [de nuit] » (M l, 1, p.
37).
Il prête à Jocaste l'« accent
in ternational des royalti es» (ibid.
, p.
47).
De son côté, Anouilh
mentionne les voitures et les cigar ettes de Polynice (A.
p.
87).
Ce tte utilisation de l'an achronisme est subtile.
En
mêlant à la légende antique des élém ents de notre uni
vers, les auteurs n'implantent pas le mythe au xxe siècle.
Ils le rapprochent de nous sans effacer pour tant le carac
tère antique de la légende.
Dans La Machine infernale, le
Sphinx et le dieu Anubis sont présents sur scène.
Leur
apparence et leur nom nous renvoient au monde antique.
Dans Antigone, les person nages parta gent la croya nce
grecque selon laquelle «ceux qu'on n'enterre pas errent
éter nellement sans jamais trouver de repos » (A.
p.
65 ).
En
in corpor ant au mythe des élémen ts du xxe siècle, les
auteurs ne l'arrachent pas à son contexte antique.
Ils nous
montrent plutôt qu'il appartient à toutes les époques.
1.
Voi r supra, note 1, p.69..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Mythe de Sisyphe (1942) Albert Camus Extrait : définition de l'absurde Pour tous les jours d'une vie sans éclat, le temps nous porte.
- Le Moyen Âge : le mythe des << temps obscurs >>
- En quoi le mythe a t-il permis a l'homme d'échapper au temps et par la même occasion a la mort ?
- On pouvait lire dans Les Lettres françaises du 25 février 1954 (Gallimard) ces lignes de Thomas Mann : «Le classicisme, ce n'est pas quelque chose d'exemplaire ; en général, et hors du temps, même s'il a beaucoup et tout à faire avec les deux idées implicites ici, celle d'une forme, et celle de la précellence de cette forme. Bien loin de là, le classicisme est plutôt cet exemple tel qu'il a été réalisé, la première création d'une forme de vie spirituelle se manifestant dans la vie indi
- Il (l'individu) appartient au temps et, à cette horreur qui le saisit, il y reconnaît son pire ennemi. Demain, il souhaitait demain, quand tout lui même aurait dû s'y refuser. Cette révolte de la chair, c'est l'absurde. Camus, Le mythe de Sisyphe, Gallimard, p.28. Commentez cette citation.