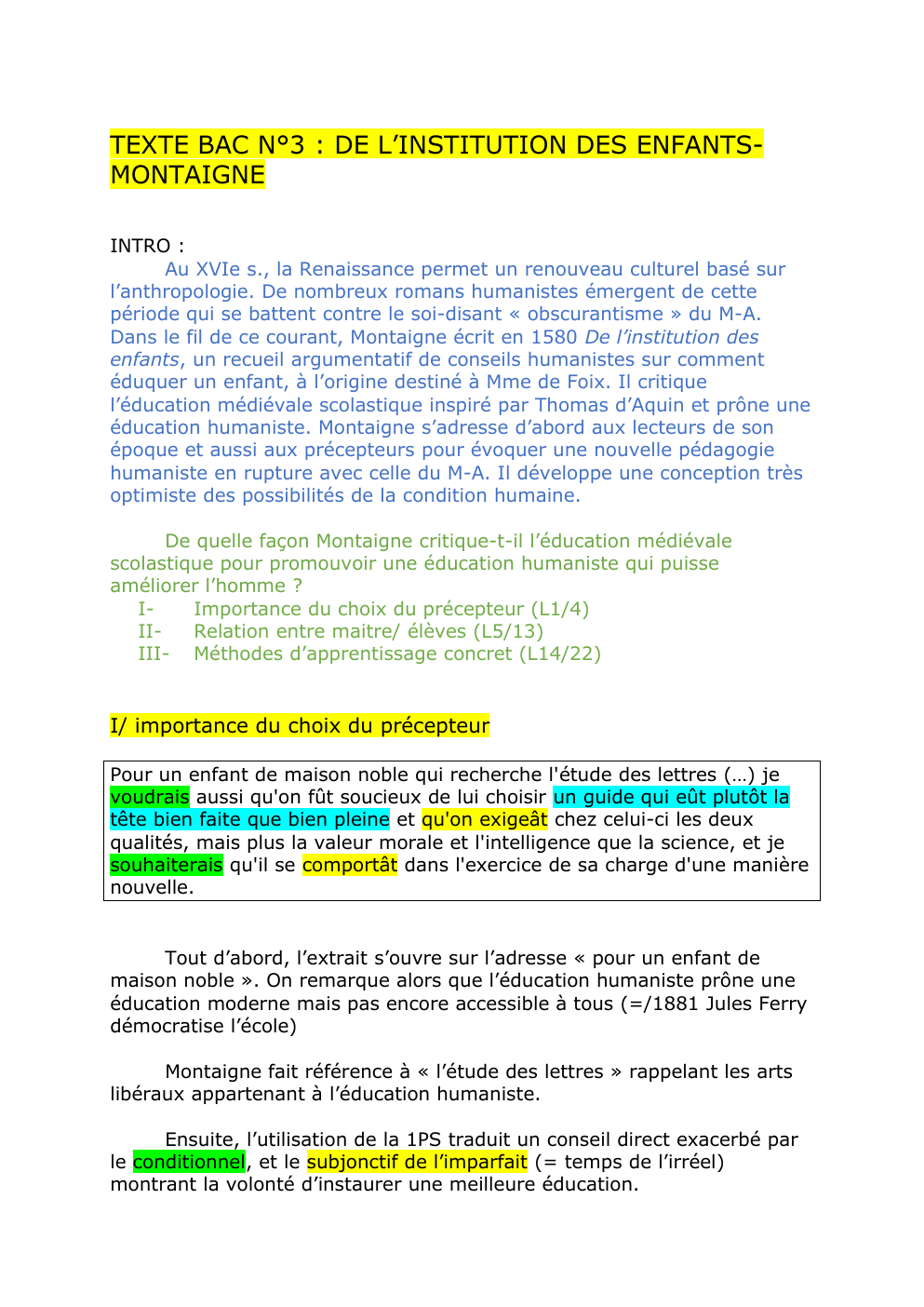TEXTE BAC N°3 : DE L’INSTITUTION DES ENFANTSMONTAIGNE
Publié le 07/11/2023
Extrait du document
«
TEXTE BAC N°3 : DE L’INSTITUTION DES ENFANTSMONTAIGNE
INTRO :
Au XVIe s., la Renaissance permet un renouveau culturel basé sur
l’anthropologie.
De nombreux romans humanistes émergent de cette
période qui se battent contre le soi-disant « obscurantisme » du M-A.
Dans le fil de ce courant, Montaigne écrit en 1580 De l’institution des
enfants, un recueil argumentatif de conseils humanistes sur comment
éduquer un enfant, à l’origine destiné à Mme de Foix.
Il critique
l’éducation médiévale scolastique inspiré par Thomas d’Aquin et prône une
éducation humaniste.
Montaigne s’adresse d’abord aux lecteurs de son
époque et aussi aux précepteurs pour évoquer une nouvelle pédagogie
humaniste en rupture avec celle du M-A.
Il développe une conception très
optimiste des possibilités de la condition humaine.
De quelle façon Montaigne critique-t-il l’éducation médiévale
scolastique pour promouvoir une éducation humaniste qui puisse
améliorer l’homme ?
IImportance du choix du précepteur (L1/4)
IIRelation entre maitre/ élèves (L5/13)
III- Méthodes d’apprentissage concret (L14/22)
I/ importance du choix du précepteur
Pour un enfant de maison noble qui recherche l'étude des lettres (…) je
voudrais aussi qu'on fût soucieux de lui choisir un guide qui eût plutôt la
tête bien faite que bien pleine et qu'on exigeât chez celui-ci les deux
qualités, mais plus la valeur morale et l'intelligence que la science, et je
souhaiterais qu'il se comportât dans l'exercice de sa charge d'une manière
nouvelle.
Tout d’abord, l’extrait s’ouvre sur l’adresse « pour un enfant de
maison noble ».
On remarque alors que l’éducation humaniste prône une
éducation moderne mais pas encore accessible à tous (=/1881 Jules Ferry
démocratise l’école)
Montaigne fait référence à « l’étude des lettres » rappelant les arts
libéraux appartenant à l’éducation humaniste.
Ensuite, l’utilisation de la 1PS traduit un conseil direct exacerbé par
le conditionnel, et le subjonctif de l’imparfait (= temps de l’irréel)
montrant la volonté d’instaurer une meilleure éducation.
Le // de construction oppose deux types de précepteurs : ceux ayant
une pédagogie humaniste et ceux ayant une pédagogie scolastique.
=> Il
montre l’importance du choix du précepteurs qui montre le chemin à
l’enfant.
Montaigne prône la compréhension des connaissances à l’instar
de celles apprises par cœur.
&&&&&&&&&&
Montaigne oppose l’éducation médiévale à une nouvelle pédagogie
plus moderne grâce à l’adjectif « nouvelle » caractérisant la « manière »
d’éduquer.
II/ Relation entre maitre/ élèves
On ne cesse de criailler à nos oreilles d'enfants, comme si l'on versait
dans un entonnoir, et notre rôle, ce n'est que de redire ce qu'on nous a
dit.
Je voudrais que le précepteur corrigeât ce point de la méthode usuelle
et que, d'entrée, selon la portée de l'âme qu'il a en main, il commençât à
la mettre sur la piste, en lui faisant goûter les choses, les choisir et les
discerner d'elle- même, en lui ouvrant quelquefois le chemin, quelquefois
en le lui faisant ouvrir.
Je ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux
qu'il écoute son disciple parler à son tour.
Socrate et, depuis, Arcésilas
faisaient d'abord parler leurs disciples, et puis ils leur parlaient.
« Obest
plerumque iis qui discere volunt auctoritas eorum qui docent.
»(l’autorité
de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent
apprenddre)
Montaigne réduit l’éducation scolastique à un bruit sonore
dérangeant.
En effet, la métaphore hyperbolique du verbe « criailler »
construit à partir du suffixe péjoratif « ailler » rappelle un bruit nuisant et
animalise le précepteur à un simple oiseaux.
De plus, l’utilisation du pronom de la 1PP permet à l’auteur d’inclure le
lecteur et de se sentir impliqué.
La comparaison de l’éducation avec un gavage de cerveau, un simple
entonnoir que l’on remplit, apporte au texte une image concrète, sans
abstraction comme la pédagogie que condamne Montaigne.
Ces différentes images et métaphore animalière donne au texte un
ton pédagogue donnant goût au savoir
Le suffixe « re » du verbe dire permet à Montaigne de condamner
l’apprentissage par cœur, et l’apprentissage uniquement fondé sur la
mémoire des élèves qui ne font que répéter ce qu’ils apprennent jugé
comme la « méthode usuelle » ie référence à la pédagogie scolastique.
« selon la portée de l'âme qu'il....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Zone d'Apollinaire texte bac: modernité
- Analyse linéaire "le soleil" de Baudelaire (façon texte du bac)
- Séquence 1 BAC – Texte 1 : Dom Juan (1665), Molière, Acte V, scènes 4 à 6.
- Explication de texte bac 2012 S
- BAC 2016 : Texte de Merleau-Ponty : Une œuvre d’art a-t-elle pour but de représenter la réalité ?