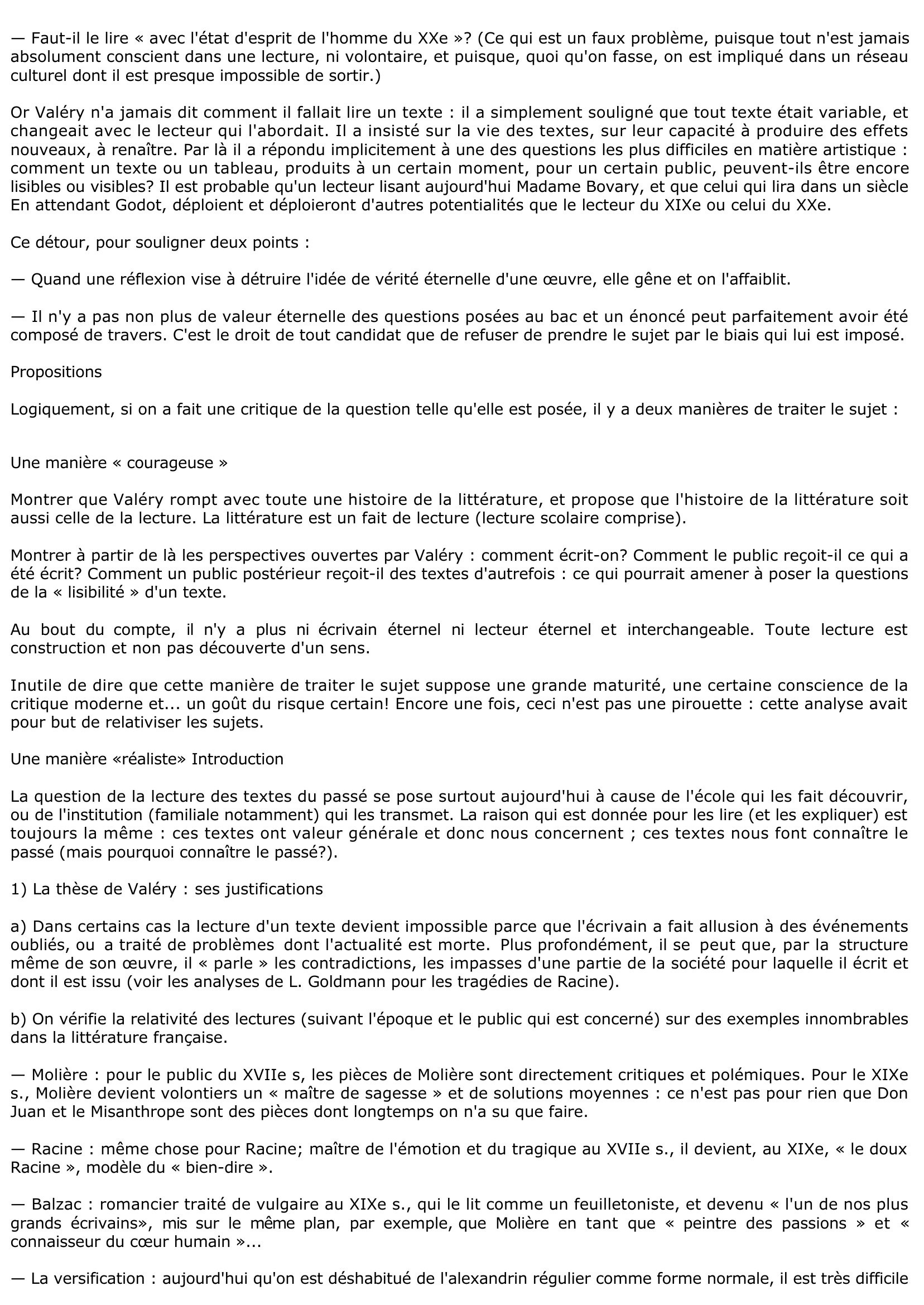Textes et lecteurs
Publié le 29/03/2011

Extrait du document
Partant de la création littéraire, Paul Valéry écrit : « ... l'esprit de l'auteur, qu'il le veuille, qu'il le sache, ou non, est comme accordé sur l'idée qu'il se fait nécessairement de son lecteur ; et donc le changement d'époque, qui est un changement de lecteur, est comparable à un changement dans le texte même, changement toujours imprévu et incalculable. « Variété I, « A propos d'Adonis «
Pensez-vous, comme Valéry, que les œuvres littéraires des siècles passés ne sont plus, de nos jours, lues dans le même esprit, et comprises de la même façon qu'au moment de leur parution? Dans l'affirmative, est-il, selon vous, préférable d'essayer de se replacer dans le contexte spirituel de l'époque correspondante pour apprécier véritablement une œuvre classique, romantique, etc., ou bien doit-on appréhender cette même œuvre avec l'état d'esprit d'un lecteur du vingtième siècle? Justifiez votre réponse en vous référant à des exemples précis empruntés aux œuvres que vous connaissez.
«
— Faut-il le lire « avec l'état d'esprit de l'homme du XXe »? (Ce qui est un faux problème, puisque tout n'est jamaisabsolument conscient dans une lecture, ni volontaire, et puisque, quoi qu'on fasse, on est impliqué dans un réseauculturel dont il est presque impossible de sortir.)
Or Valéry n'a jamais dit comment il fallait lire un texte : il a simplement souligné que tout texte était variable, etchangeait avec le lecteur qui l'abordait.
Il a insisté sur la vie des textes, sur leur capacité à produire des effetsnouveaux, à renaître.
Par là il a répondu implicitement à une des questions les plus difficiles en matière artistique :comment un texte ou un tableau, produits à un certain moment, pour un certain public, peuvent-ils être encorelisibles ou visibles? Il est probable qu'un lecteur lisant aujourd'hui Madame Bovary, et que celui qui lira dans un siècleEn attendant Godot, déploient et déploieront d'autres potentialités que le lecteur du XIXe ou celui du XXe.
Ce détour, pour souligner deux points :
— Quand une réflexion vise à détruire l'idée de vérité éternelle d'une œuvre, elle gêne et on l'affaiblit.
— Il n'y a pas non plus de valeur éternelle des questions posées au bac et un énoncé peut parfaitement avoir étécomposé de travers.
C'est le droit de tout candidat que de refuser de prendre le sujet par le biais qui lui est imposé.
Propositions
Logiquement, si on a fait une critique de la question telle qu'elle est posée, il y a deux manières de traiter le sujet :
Une manière « courageuse »
Montrer que Valéry rompt avec toute une histoire de la littérature, et propose que l'histoire de la littérature soitaussi celle de la lecture.
La littérature est un fait de lecture (lecture scolaire comprise).
Montrer à partir de là les perspectives ouvertes par Valéry : comment écrit-on? Comment le public reçoit-il ce qui aété écrit? Comment un public postérieur reçoit-il des textes d'autrefois : ce qui pourrait amener à poser la questionsde la « lisibilité » d'un texte.
Au bout du compte, il n'y a plus ni écrivain éternel ni lecteur éternel et interchangeable.
Toute lecture estconstruction et non pas découverte d'un sens.
Inutile de dire que cette manière de traiter le sujet suppose une grande maturité, une certaine conscience de lacritique moderne et...
un goût du risque certain! Encore une fois, ceci n'est pas une pirouette : cette analyse avaitpour but de relativiser les sujets.
Une manière «réaliste» Introduction
La question de la lecture des textes du passé se pose surtout aujourd'hui à cause de l'école qui les fait découvrir,ou de l'institution (familiale notamment) qui les transmet.
La raison qui est donnée pour les lire (et les expliquer) esttoujours la même : ces textes ont valeur générale et donc nous concernent ; ces textes nous font connaître lepassé (mais pourquoi connaître le passé?).
1) La thèse de Valéry : ses justifications
a) Dans certains cas la lecture d'un texte devient impossible parce que l'écrivain a fait allusion à des événementsoubliés, ou a traité de problèmes dont l'actualité est morte.
Plus profondément, il se peut que, par la structuremême de son œuvre, il « parle » les contradictions, les impasses d'une partie de la société pour laquelle il écrit etdont il est issu (voir les analyses de L.
Goldmann pour les tragédies de Racine).
b) On vérifie la relativité des lectures (suivant l'époque et le public qui est concerné) sur des exemples innombrablesdans la littérature française.
— Molière : pour le public du XVIIe s, les pièces de Molière sont directement critiques et polémiques.
Pour le XIXes., Molière devient volontiers un « maître de sagesse » et de solutions moyennes : ce n'est pas pour rien que DonJuan et le Misanthrope sont des pièces dont longtemps on n'a su que faire.
— Racine : même chose pour Racine; maître de l'émotion et du tragique au XVIIe s., il devient, au XIXe, « le douxRacine », modèle du « bien-dire ».
— Balzac : romancier traité de vulgaire au XIXe s., qui le lit comme un feuilletoniste, et devenu « l'un de nos plusgrands écrivains», mis sur le même plan, par exemple, que Molière en tant que « peintre des passions » et «connaisseur du cœur humain »...
— La versification : aujourd'hui qu'on est déshabitué de l'alexandrin régulier comme forme normale, il est très difficile.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouées. » Molière, L'Amour médecin, Avertissement aux lecteurs Que pensez-vous de cette affirmation ? Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur les textes du corpus, les œuvres étudiées en classe, vos lectures personnelles et votre expérience du spectacle.
- Recueil de textes météo
- Les textes et les images de l'art de la Renaissance
- Les 4 types de textes
- En vous appuyant sur une lecture attentive de "La Princesse de Clèves" et des autres textes du parcours associé, vous direz si, selon vous, l'intérêt d'un roman réside dans le caractère tragique de son intrigue.