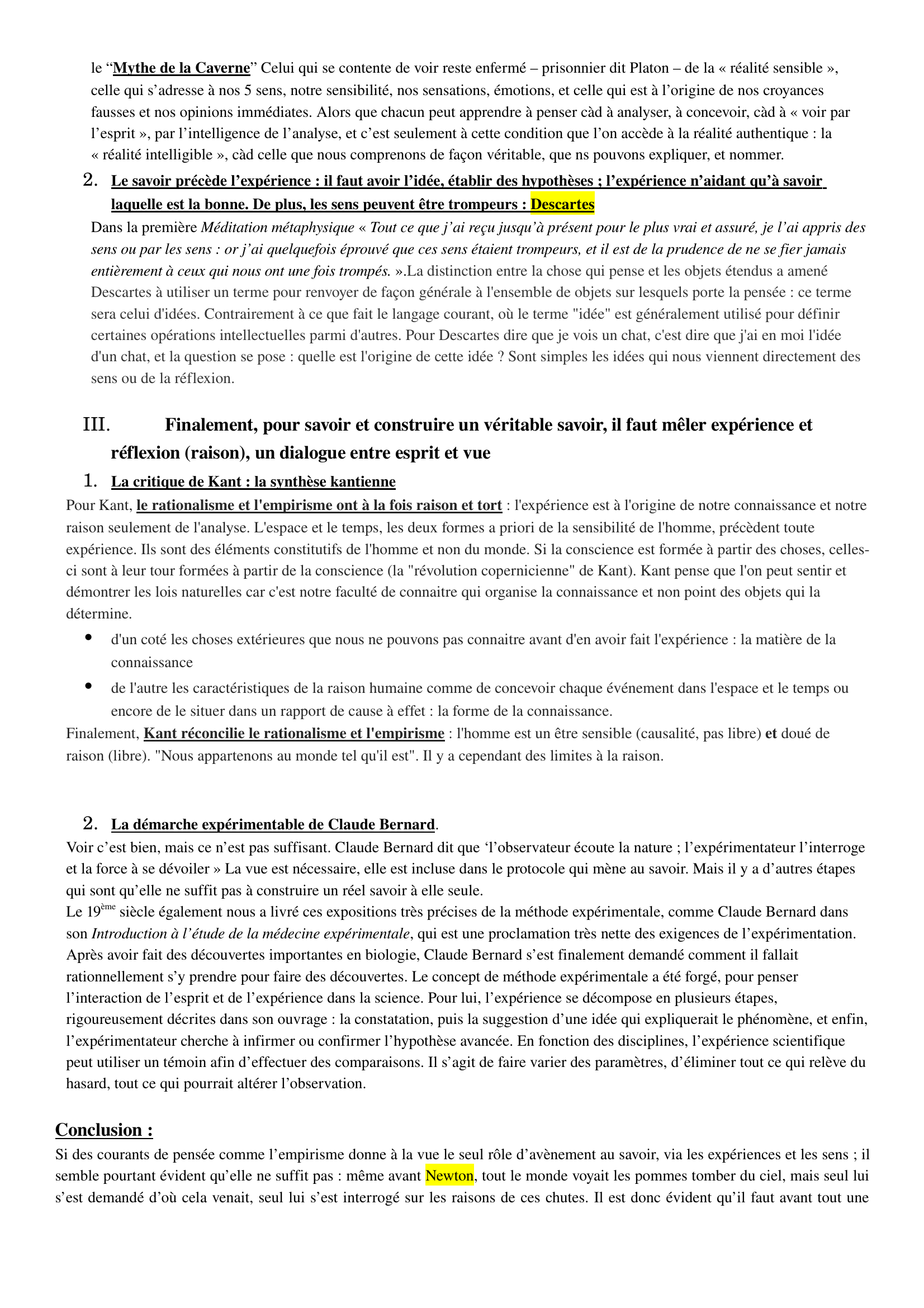theatre
Publié le 31/03/2014

Extrait du document
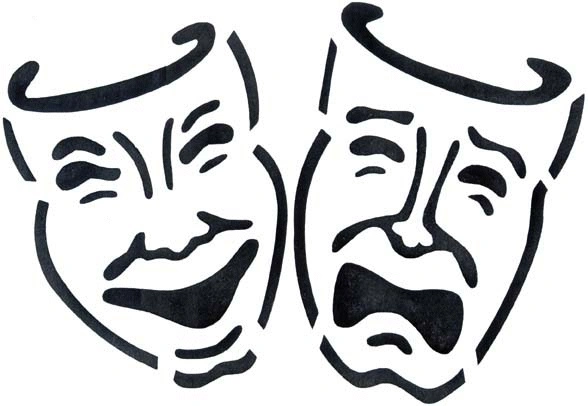
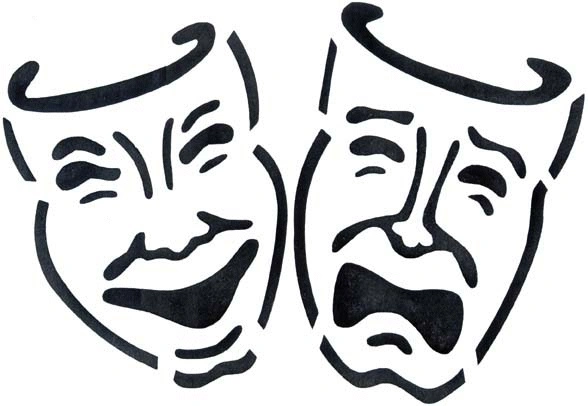
«
le “ Mythe de la Caverne ” Celui qui se contente de voir reste enfermé – prisonnier dit Platon – de la « r éalit é sensible »,
celle qui s’adresse
à nos 5 sens, notre sensibilit é, nos sensations, émotions, et celle qui est à l’origine de nos croyances
fausses et nos opinions imm
édiates. Alors que chacun peut apprendre à penser c àd à analyser, à concevoir, c àd à « voir par
l’esprit », par l’intelligence de l’analyse, et c’est seulement
à cette condition que l’on acc ède à la r éalit é authentique : la
« r
éalit é intelligible », c àd celle que nous comprenons de fa çon v éritable, que ns pouvons expliquer, et nommer.
2.
Le savoir pr
écède l’exp érience : il faut avoir l’id ée, établir des hypoth èses ; l’exp érience n’aidant qu’ à savoir
laquelle est la bonne. De plus, les sens peuvent
être trompeurs : Descartes
D ans la premi
ère M éditation m étaphysique « Tout ce que j’ai re çu jusqu’ à pr ésent pour le plus vrai et assur é, je l’ai appris des
sens ou par les sens : or j’ai quelquefois
éprouv é que ces sens étaient trompeurs, et il est de la prudence de ne se fier jamais
enti
èrement à ceux qui nous ont une fois tromp és.
» .
La distinction entre la chose qui pense et les objets étendus a amen é
Descartes
à utiliser un terme pour renvoyer de fa çon g énérale à l'ensemble de objets sur lesquels porte la pens ée : ce terme
sera celui d'id
ées. Contrairement à ce que fait le langage courant, o ù le terme "id ée" est g énéralement utilis é pour d éfinir
certaines op
érations intellectuelles parmi d'autres. Pour Descartes dire que je vois un chat, c'est dire que j'ai en moi l'id ée
d'un chat, et la question se pose : quelle est l'origine de cette id
ée ? Sont simples les id ées qui nous viennent directement des
sens ou de la r
éflexion.
III.
Finalement, pour savoir et construire un v
éritable savoir, il faut m êler exp érience et
r
éflexion (raison), un dialogue entre esprit et vue
1.
La critique de Kant : la synth
èse kantienne
Pour Kant, le rationalisme et l'empirisme ont
à la fois raison et tort : l'exp érience est à l'origine de notre connaissance et notre
raison seulement de l'analyse. L'espace et le temps, les deux formes a priori de la sensibilit
é de l'homme, pr écèdent toute
exp
érience. Ils sont des éléments constitutifs de l'homme et non du monde. Si la conscience est form ée à partir des choses, celles
ci sont
à leur tour form ées à partir de la conscience (la "r évolution copernicienne" de Kant). Kant pense que l'on peut sentir et
d
émontrer les lois naturelles car c'est notre facult é de connaitre qui organise la connaissance et non point des objets qui la
d
étermine.
• d'un cot
é les choses ext érieures que nous ne pouvons pas connaitre avant d'en avoir fait l'exp érience : la mati ère de la
connaissance
• de l'autre les caract
éristiques de la raison humaine comme de concevoir chaque événement dans l'espace et le temps ou
encore de le situer dans un rapport de cause
à effet : la forme de la connaissance.
Finalement, Kant r
éconcilie le rationalisme et l'empirisme : l'homme est un être sensible (causalit é, pas libre) et dou é de
raison (libre). "Nous appartenons au monde tel qu'il est". Il y a cependant des limites
à la raison.
2.
La d
émarche exp érimentable de Claude Bernard .
Voir c’est bien, mais ce n’est pas suffisant.
Claude Bernard dit que ‘l’observateur
écoute la nature ; l’exp érimentateur l’interroge
et la force
à se d évoiler » La vue est n écessaire, elle est incluse dans le protocole qui m ène au savoir. Mais il y a d’autres étapes
qui sont qu’elle ne suffit pas
à construire un r éel savoir à elle seule.
Le 19 è me
si ècle également nous a livr é ces expositions tr ès pr écises de la m éthode exp érimentale, comme Claude Bernard dans
son Introduction
à l’étude de la m édecine exp érimentale , qui est une proclamation tr ès nette des exigences de l’exp érimentation.
Apr
ès avoir fait des d écouvertes importantes en biologie, Claude Bernard s’est finalement demand é comment il fallait
rationnellement s’y prendre pour faire des d
écouvertes. Le concept de m éthode exp érimentale a été forg é, pour penser
l’interaction de l’esprit et de l’exp
érience dans la science. Pour lui, l’exp érience se d écompose en plusieurs étapes,
rigoureusement d
écrites dans son ouvrage : la constatation, puis la suggestion d’une id ée qui expliquerait le ph énom ène, et enfin,
l’exp
érimentateur cherche à infirmer ou confirmer l’hypoth èse avanc ée. En fonction des disciplines, l’exp érience scientifique
peut utiliser un t
émoin afin d’effectuer des comparaisons. Il s’agit de faire varier des param ètres, d’ éliminer tout ce qui rel ève du
hasard, tout ce qui pourrait alt
érer l’observation.
Conclusion :
Si des courants de pens
ée comme l’empirisme donne à la vue le seul r ôle d’av ènement au savoir, via les exp ériences et les sens ; il
semble pourtant
évident qu’elle ne suffit pas : m ême avant Newton , tout le monde voyait les pommes tomber du ciel, mais seul lui
s’est demand
é d’o ù cela venait, seul lui s’est interrog é sur les raisons de ces chutes. Il est donc évident qu’il faut avant tout une .
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Theatre
- corpus theatre
- - FICHE BILAN SUR LE THEATRE – 1/6 Le théâtre est un genre littéraire particulier.
- theatre bac 1ere
- theatre compte rendu