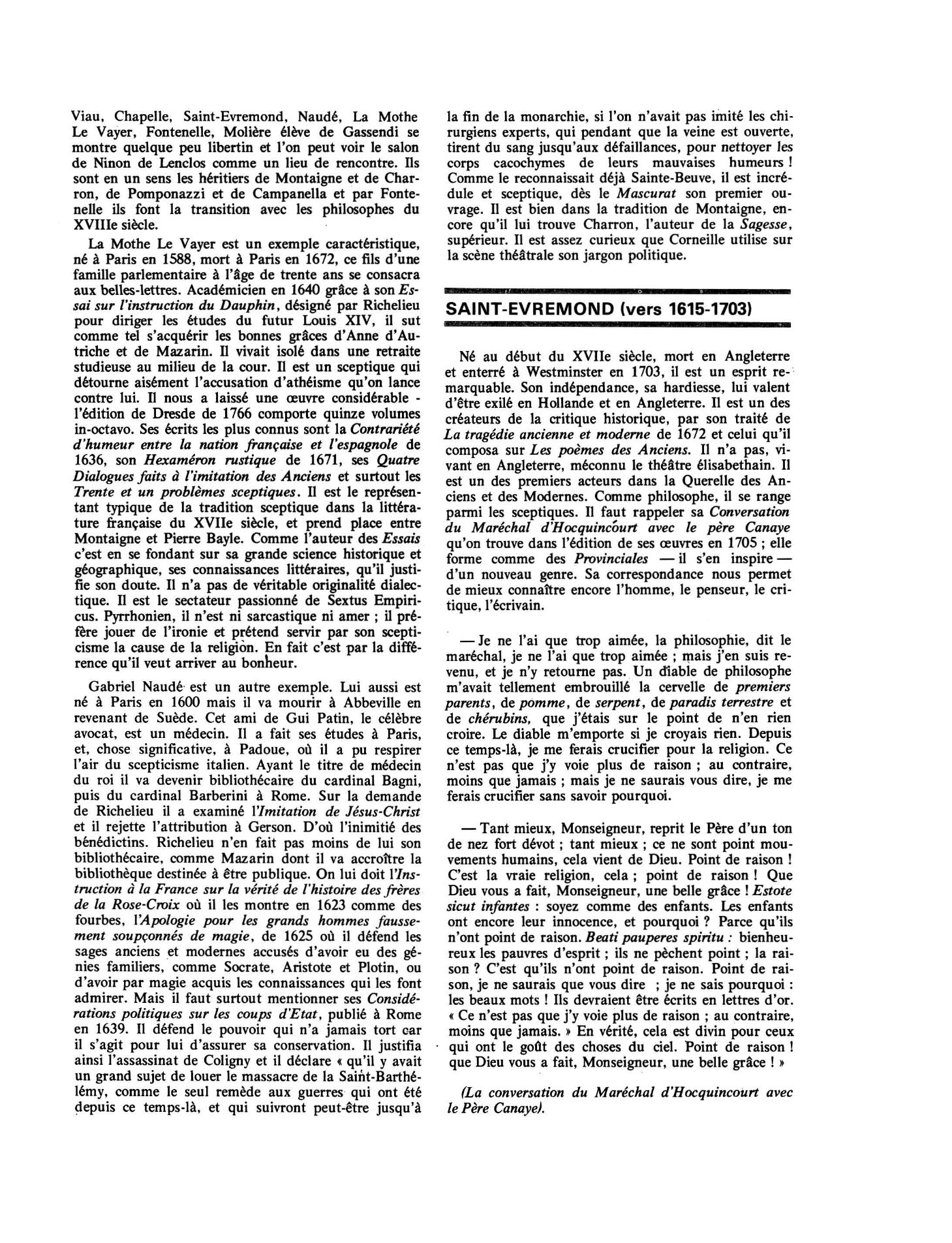Tradition et esprit nouveau au XVIIe siècle
Publié le 18/10/2011

Extrait du document

L'Abbaye de Port-Royal, réformée en 1608 par Angélique Arnauld a, en 1633, comme directeur spirituel l'abbé de Saint-Cyran disciple de Jansénius. Des laïques pieux vont vivre dans le voisinage. Ces messieurs de Port-Royal, qui ont noms le Grand Arnauld ou Antoine Arnauld, Antoine Lemaistre, Nicole, Lancelot vont avoir une influence décisive sur les idées religieuses, morales, littéraires du XVIIe siècle. Racine sera l'élève des Petites Ecoles, malgré la condamnation de l'Augustinus de Jansénius par la Sorbonne et par Rome. Malgré la destruction de l'abbaye, sur l'ordre de Louis XIV au début du XVIIe siècle, Port-Royal rayonne et continue à rayonner jusqu'au XIXe siècle.

«
Viau, Chapelle, Saint-Evremond, Naudé, La Mothe Le Vayer, Fontenelle, Molière élève de Gassendi se montre quelque peu libertin et l'on peut voir le salon
de Ninon de Lenclos comme un lieu de rencontre .
Ils
sont en un sens les héritiers de Montaigne et de Char ron, de Pomponazzi et de Campanella et par Fonte nelle ils font la transition avec les philosophes du XVIIIe siècle.
La Mothe Le Vayer est un exemple caractéristique, né à Paris en 1588, mort à Paris en 1672, ce fils d'une
famille parlementaire à l'âge de trente ans se consacra
aux belles -lettres.
Académicien en 1640 grâce à son Es sai sur l'instruction du Dauphin, désigné par Richelieu
pour diriger les études du futur Louis XIV, il sut
comme tel s'acquérir les bonnes grâces d'Anne d'Au triche et de Mazarin .
Il vivait isolé dans une retraite
studieuse au milieu de la cour.
Il est un sceptique qui
détourne aisément l'accusation d'athéisme qu'on lance
contre lui.
Il nous a laissé une œuvre considérable -
l'édition de Dresde de 1766 comporte quinze volumes
in-octavo.
Ses écrits les plus connus sont la Contrariété
d'humeur entre la nation française et l'espagnole de
1636, son Hexaméron rustique de 1671, ses Quatre
Dialogues faits à l'imitation des Anciens et surtout les Trente et un problèmes sceptiques.
Il est le représen tant typique de la tradition sceptique dans la littéra ture française du XVIIe siècle, et prend place entre
Montaigne et Pierre Bayle.
Comme l'auteur des Essais c'est en se fondant sur sa grande science historique et
géographique, ses connaissances littéraires, qu'il justi fie son doute.
Il n'a pas de véritable originalité dialec tique.
Il est le sectateur passionné de Sextus Empiri cus.
Pyrrhonien, il n'est ni sarcastique ni amer; il pré fère jouer de l'ironie et prétend servir par son scepti cisme la cause de la religion .
En fait c'est par la diffé rence qu'il veut arriver au bonheur.
Gabriel
Naudé · est un autre exemple .
Lui aussi est né à Paris en 1600 mais il va mourir à Abbeville en
revenant de Suède.
Cet ami de Gui Patin, le célèbre
avocat, est un médecin.
Il a fait ses études à Paris, et, chose significative, à Padoue, où il a pu respirer
l'air du scepticisme italien.
Ayant le titre de médecin
du roi il va devenir bibliothécaire du cardinal Bagni,
puis du cardinal Barberini à Rome.
Sur la demande de Richelieu il a examiné l'Imitation de Jésus-Christ et il rejette l'attribution à Gerson.
D'où l'inimitié des bénédictins.
Richelieu n'en fait pas moins de lui son
bibliothécaire , comme Mazarin dont il va accroître la
bibliothèque destinée à être publique.
On lui doit l'Ins truction à la France sur la vérité de l'histoire des frères
de la Rose-Croix où il les montre en 1623 comme des
fourbes , l'Apologie pour les grands hommes fausse ment soupçonnés de magie, de 1625 où il défend les sages anciens .et modernes accusés d'avoir eu des gé nies familiers, comme Socrate, Aristote et Plotin, ou d'avoir par magie acquis les connaissances qui les font
admirer.
Mais il faut surtout mentionner ses Considé rations politiques sur les coups d'Etat, publié à Rome
en 1639.
Il défend le pouvoir qui n'a jamais tort car il s'agit pour lui d'assurer sa conservation.
Il justifia
ainsi l'assassinat de Coligny et il déclare «qu'il y avait
un grand sujet de louer le massacre de la Saint-Barthé lémy, comme le seul remède aux guerres qui ont été
depuis ce temps-là, et qui suivront peut-être jusqu'à la
fin
de la monarchie, si l'on n'avait pas imité les chi rurgiens experts, qui pendant que la veine est ouverte,
tirent du sang jusqu'aux défaillances, pour nettoyer les corps cacochymes de leurs mauvaises humeurs ! Comme le reconnaissait déjà Sainte-Beuve , il est incré dule et sceptique , dès le Mascurat son premier ou vrage.
Il est bien dans la tradition de Montaigne, en core qu'il lui trouve Charron, l'auteur de la Sagesse, supérieur.
Il est assez curieux que Corneille utilise sur
la scène théâtrale son jargon politique.
SAINT-EVREMOND (vers 1615-1703)
Né au début du XVIIe siècle, mort en Angleterre
et enterré à Westminster en 1703, il est un esprit re marquable.
Son indépendance, sa hardiesse, lui valent
d'être exilé en Hollande et en Angleterre.
Il est un des
créateurs
de la critique historique, par son traité de La tragédie ancienne et moderne de 1672 et celui qu'il
composa sur Les poèmes des Anciens .
Il n'a pas, vi vant en Angleterre, méconnu le théâtre élisabethain .
Il est un des premiers acteurs dans la Querelle des An ciens et des Modernes.
Comme philosophe, il se range
parmi les sceptiques .
Il faut rappeler sa Conversation
du Maréchal d'Hocquincourt avec le père Canaye qu'on trouve dans l'édition de ses œuvres en 1705; elle
forme comme des Provinciales - il s'en inspire - d'un nouveau genre.
Sa correspondance nous permet
de mieux connaître encore l'homme, le penseur, le cri tique, l'écrivain.
-Je ne l'ai que trop aimée , la philosophie, dit le maréchal, je ne l'ai que trop aimée ; qlais j'en suis re venu , et je n'y retourne pas ..
Un d1able de philosophe
m'avait tellement embrouillé la cervelle de premiers
parents, de pomme, de serpent , de paradis te"estre et de chérubins, que j'étais sur le point de n'en rien
croire.
Le diable m'emporte si je croyais rien.
Depuis ce temps-là, je me ferais crucifier pour la religion.
Ce n'est pas que j'y voie plus de raison ; au contraire,
moins que jamais ; mais je ne saurais vous dire, je me
ferais crucifier sans savoir pourquoi.
-Tant mieux, Monseigneur, reprit le Père d'un ton
de nez fort dévot; tant mieux ; ce ne sont point mou vements humains, cela vient de Dieu.
Point de raison ! C'est la vraie religion, cela ; point de raison ! Que
Dieu vous a fait, Monseigneur, une belle grâce ! Estote
sicut infantes : soyez comme des enfants.
Les enfants
ont encore leur innocence, et pourquoi? Parce qu'ils
n'ont point de raison.
Beati pouperes spiritu: bienheu reux les pauvres d'esprit; ils ne pèchent point; la rai son ? C'est qu'ils n'ont point de raison .
Point de rai son, je ne saurais que vous dire ; je ne sais pourquoi : les beaux mots ! Ils devraient être écrits en lettres d'or.
« Ce n'est pas que j'y voie plus de raison ; au contraire,
moins que jamais .
• En vérité, cela est divin pour ceux
qui ont le goQt des choses du ciel.
Point de raison ! que Dieu vous a fait, Monseigneur, une belle grâce ! »
(La conversation du Maréchal d'Hocquincourt avec
le Père Canaye) ..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- «Un long avenir se préparait pour (la culture française) du XVIIe (siècle). Même encore au temps du romantisme, les œuvres classiques continuent à bénéficier d'une audience considérable ; l'époque qui les a vu naître bénéficie au premier chef du progrès des études historiques ; l'esprit qui anime ses écrivains, curiosité pour l'homme, goût d'une beauté harmonieuse et rationnelle, continue à inspirer les créatures. Avec cette esthétique une autre ne pourra véritablement entrer en concur
- Vous expliquerez et apprécierez ce parallèle entre le XVIIe siècle classique et le moyen âge : «Le XVIIe siècle - en ce qu'il a de classique - bien plus que l'introduction à la pensée scientifique, moderne et athée du XVIIIe siècle, est l'épanouissement de la pensée du moyen âge, dont il donne, sous des habits empruntés et dans une langue magnifique, une nouvelle et somptueuse image. Un homme prévenu, qui oublierait tant de poncifs et de jugements consacrés, comment ne serait-il pas fr
- Faire, en les unissant par des transitions convenables; trois tableaux de Paris ligueur (fin du xvie siècle), Paris frondeur (milieu du xviie siècle) et Paris philosophe (milieu du xviiie siècle); ce faisant, chercher à caractériser l'esprit de Paris et son influence sur le reste de la France.
- Opposition d'esprit entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et conséquences littéraires de cette opposition. - Les salons au XVIIIe siècle : la duchesse du Maine, la marquise de Lambert, Mme de Tencin, Mme Geoffrin, Mme de Deffand, Mme de Lespinasse, Mme Necker. - Les trois périodes du développement de la littérature. - Les précurseurs du XVIIIe siècle : Pierre Bayle et Fontenelle. - Les continuateurs de l'esprit classique : Daguesseau et Rollin.
- On définit quelquefois l'esprit classique en disant qu'il est avant tout un « effort pour mettre partout un ordre raisonnable ». Rendre sensible cet effort par quelques exemples pris dans la littérature et dans l'art du XVIIe siècle.