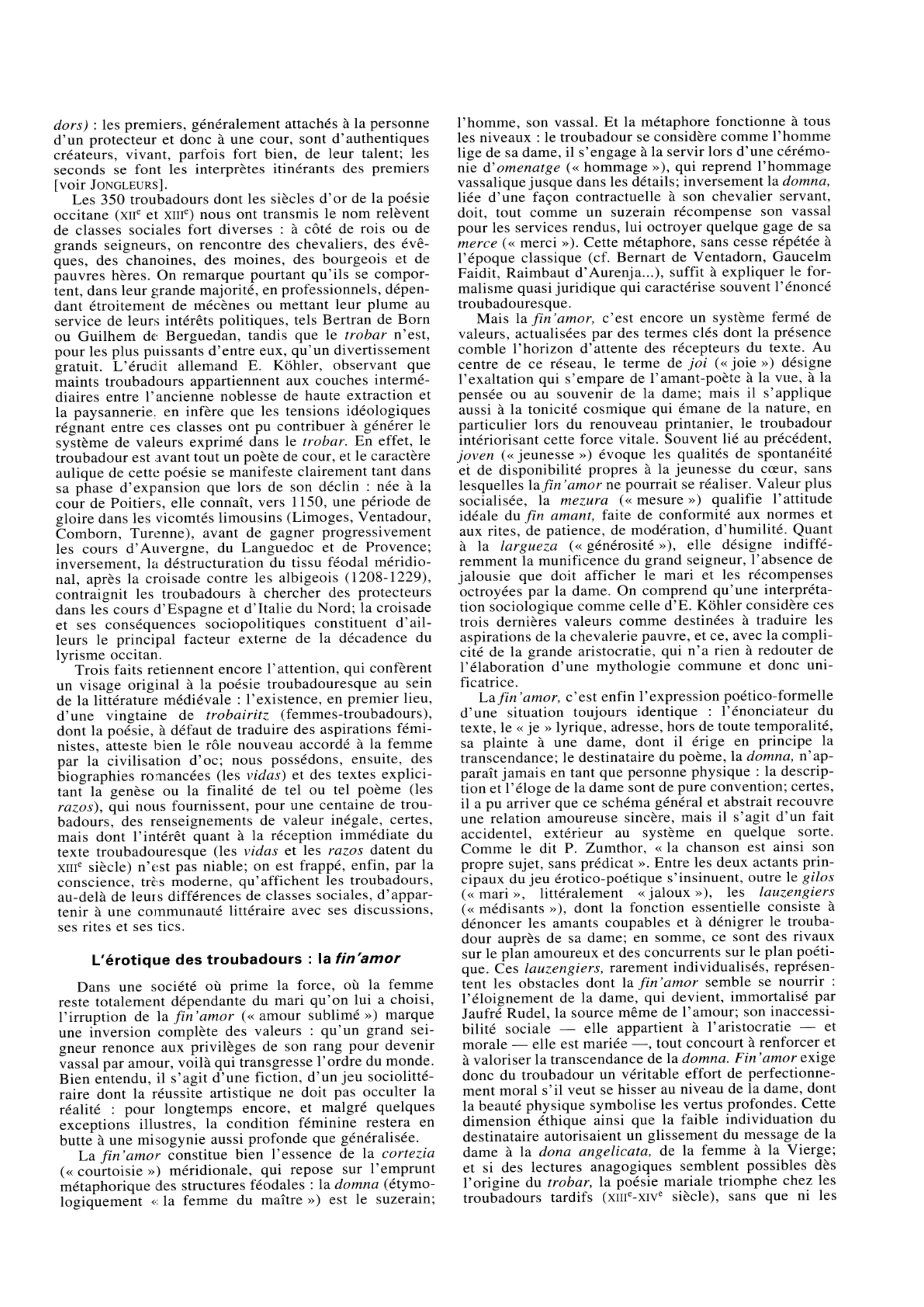TROUBADOURS (les)
Publié le 08/11/2018

Extrait du document
TROUBADOURS (les). Le terme occitan trobador s’applique, dès le XIIe siècle, à celui qui troba (« trouve »), c’est-à-dire crée et compose le texte et la mélodie de pièces destinées à être chantées devant un public, par lui-même ou par d’autres. L’étymologie couramment admise de nos jours, tant pour le verbe trobar que pour son dérivé trobador (respectivement tropare et tropatore, formes médiolatines elles-mêmes dérivées de tropus, « trope »), nous fournit une indication précieuse quant aux origines possibles de la lyrique occitane : les tropes, qui consistent en l'intercalation dans une mélodie liturgique de compositions versifiées et chantées, ont été intensément développés à partir du IXe siècle par l'école musicale d'Aquitaine, et particulièrement à l’abbaye Saint-Martial de Limoges, soit sur les lieux mêmes de la première floraison troubadouresque.
Les données socio-historiques
Avec le premier troubadour connu, Guilhem IX, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers (1071-1126), l’émergence du trobar marque une double rupture : rupture linguistique d'abord, par l’abandon du latin au profit d’une langue vulgaire — l’occitan, en l’occurrence; rupture idéologique ensuite, par l’apparition d’une poésie lyrique d’inspiration profane, consacrée pour l’essentiel à l’amour, et qui n’en ignore pas les réalités les plus crues (Guilhem IX fut excommunié à cause de la légèreté de ses mœurs), alors qu’auparavant il n'existait guère de littérature, en dehors de l’épopée, qu’à fonction hagiographique ou édifiante.
Guilhem IX a-t-il eu des prédécesseurs, moins illustres et donc oubliés par la postérité? Quelle est la part de son génie personnel dans l’élaboration d’un système poético-formel qui, dès sa première apparition, semble d’une totale maturité? Ces questions ont d’autant plus passionné la critique qu’elles sont vraisemblablement insolubles... De même, les recherches génétiques, qui ont conduit pendant des années tenants d’une origine arabo-andalouse et partisans d’une origine médiolatine à s’affronter, ne suscitent plus guère d'intérêt. Une seule chose est sûre en effet : cette lyrique naît au nord du domaine occitan, y prend le relais de formes médiolatines et se diffuse ensuite sur une vaste région comprise entre le seuil du Poitou, l'Ebre et la Méditerranée; que des influences arabes aient joué, en particulier sur le plan musical, voilà qui ne saurait surprendre, puisqu’elles existent dans d'autres domaines artistiques et que les rencontres entre les deux cultures, tant dans la péninsule Ibérique qu’en Orient, ne manquèrent pas. Cela dit, l’existence d'une civilisation originale occupant l’espace précédemment défini n’est pas contestable, même si elle ne s’accompagne pas d’une unification politique : maintien de la latinité, faiblesse du superstrat germanique, féodalité moins strictement hiérarchisée qu’au nord, aristocratie volontiers fastueuse, importance des villes et de la bourgeoisie, réestimation du rôle de la femme, sens de la tolérance, ouverture culturelle et commerciale sur le monde méditerranéen, contestation, au XIIe siècle, de l’Église en tant que puissance temporelle et spirituelle, tels sont les traits distinctifs de l’infrastructure socioculturelle sur laquelle s’est élaborée la poésie des troubadours.
Mais ces poètes, qui sont-ils? Une erreur fréquente consiste à confondre troubadours et jongleurs (jogladors) : les premiers, généralement attachés à la personne d’un protecteur et donc à une cour, sont d'authentiques créateurs, vivant, parfois fort bien, de leur talent; les seconds se font les interprètes itinérants des premiers [voir Jongleurs].
Les 350 troubadours dont les siècles d'or de la poésie occitane (xiie et XIIIe) nous ont transmis le nom relèvent de classes sociales fort diverses : à côté de rois ou de grands seigneurs, on rencontre des chevaliers, des évêques, des chanoines, des moines, des bourgeois et de pauvres hères. On remarque pourtant qu'ils se comportent, dans leur grande majorité, en professionnels, dépendant étroitement de mécènes ou mettant leur plume au service de leurs intérêts politiques, tels Bertran de Born ou Guilhem de Berguedan, tandis que le trobar n’est, pour les plus puissants d'entre eux, qu’un divertissement gratuit. L’érudit allemand E. Kôhler, observant que maints troubadours appartiennent aux couches intermédiaires entre l’ancienne noblesse de haute extraction et la paysannerie, en infère que les tensions idéologiques régnant entre ces classes ont pu contribuer à générer le système de valeurs exprimé dans le trobar. En effet, le troubadour est avant tout un poète de cour, et le caractère aulique de cette poésie se manifeste clairement tant dans sa phase d’expansion que lors de son déclin : née à la cour de Poitiers, elle connaît, vers 1150, une période de gloire dans les vicomtés limousins (Limoges, Ventadour, Comborn, Turenne), avant de gagner progressivement les cours d’Auvergne, du Languedoc et de Provence; inversement, la déstructuration du tissu féodal méridional, après la croisade contre les albigeois (1208-1229), contraignit les troubadours à chercher des protecteurs dans les cours d’Espagne et d’Italie du Nord; la croisade et ses conséquences sociopolitiques constituent d’ailleurs le principal facteur externe de la décadence du lyrisme occitan.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VIES DES TROUBADOURS. (résumé & analyse de l’oeuvre)
- MÉLODIES DES TROUBADOURS - résumé, analyse
- Grand oral du bac : Arts et Culture LES TROUBADOURS
- troubadours et trouvères - littérature.
- Troubadours et trouvères L'aube du lyrisme.