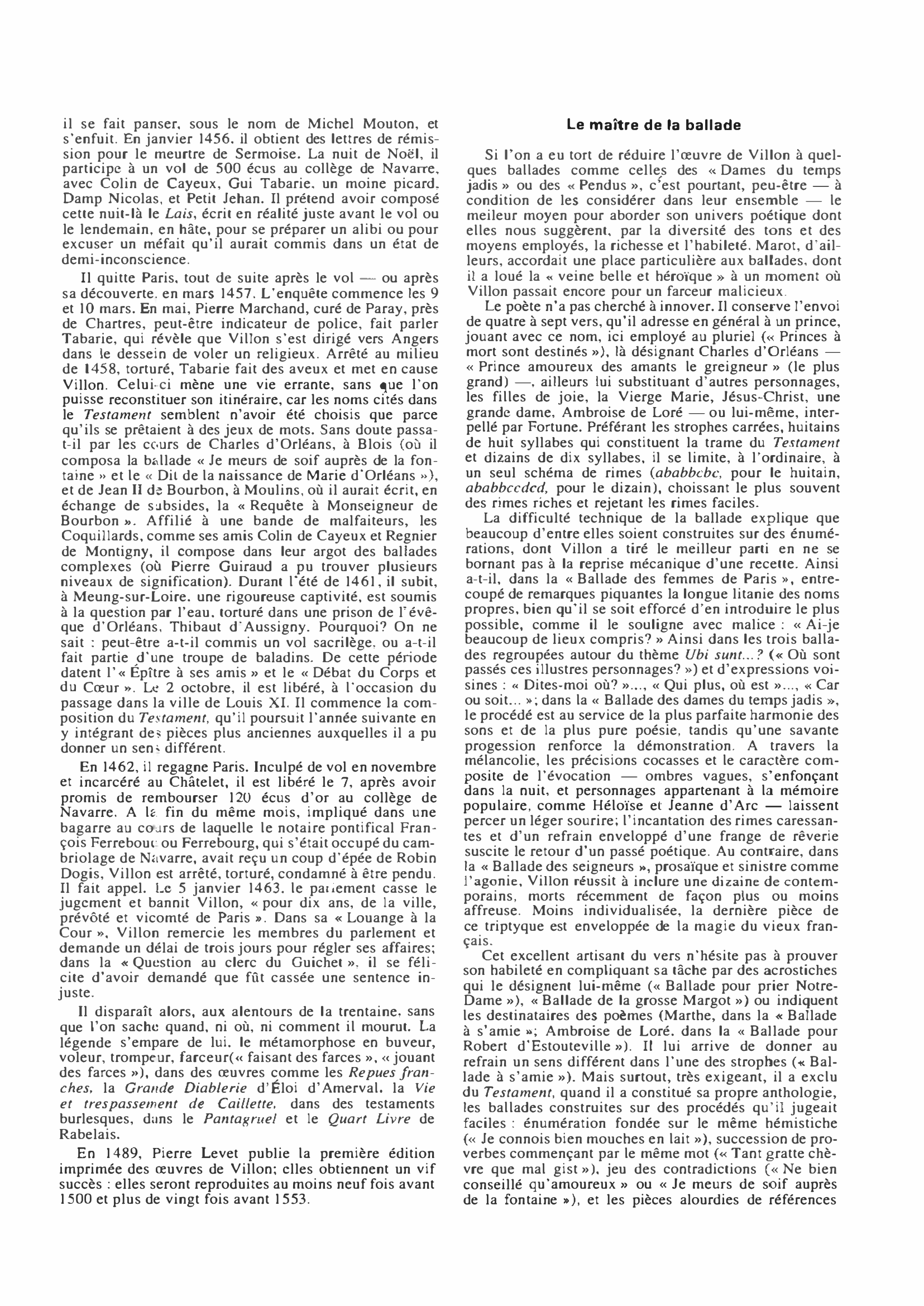VILLON François : sa vie et son oeuvre
Publié le 13/11/2018

Extrait du document

VILLON François (1431 ou 1432-après 1463). Villon a toujours eu des fidèles passionnés, pour des raisons souvent opposées. Clément Marot et Théodore de Banville ont admiré l’habile poète des ballades et des rondeaux émouvants; Théophile Gautier trouve dans son œuvre des types amusants et singuliers; Arthur Rimbaud chante le pur poète, le fol enfant qui a des rimes plein l’âme, des rimes qui rient et qui pleurent, qui nous font rire ou pleurer; Jean Richepin exalte le marlou de génie, Francis Carco et Pierre Mac Orlan, le mauvais garçon un peu lâche, l’ami des prostituées, dévoré par la passion de la liberté, resté poète au fond de l'âme malgré ses turpitudes, terrorisé par le spectre du gibet, fasciné par le mal et la chute. Mais ce mauvais garçon a été élevé au sein de l’Église, dans la communauté de Saint-Benoît-le-Bétourné, aux côtés de son père adoptif Guillaume de Villon, dont il assume l’héritage spirituel : une admiration sincère pour Jeanne d’Arc et du Guesclin, une hostilité acerbe contre les chanoines de Notre-Dame et les moines mendiants, une profonde imprégnation de la Bible, une adhésion aux idées des prédicateurs et des poètes de son temps (putréfaction du corps, universalité de la mort...). Il porte en lui un riche fonds de culture écrite et orale que, poète docte et non peuple, il utilise pour s’adresser aux lettrés; il joue même l’ignorance, note André Suarès : « ingénu, non pas naïf ».
Tous ces visages de Villon comportent une part de vérité; il faut les garder tous pour tenter de recomposer la personnalité de ce poète aux noms multiples (François de Montcorbier, François des Loges, Michel Mouton, François Villon), différent de ses légendes et de lui-même, des rimeurs de cour comme de ses compagnons de ribote.
Clerc et mauvais garçon
François de Montcorbier, qui deviendra Villon, naît à Paris, dans une famille pauvre. Très tôt orphelin de père, il est présenté à Guillaume de Villon, chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné, près de la Sorbonne, et professeur de droit religieux; son « plus-que-père » lui donne nom, culture, vie sociale et religieuse. En 1443, Villon s’inscrit à la faculté des arts; il est reçu bachelier en mars 1449. Le 4 septembre 1450, Guillaume de Villon, en procès avec le chapitre de Notre-Dame (que le poète n'épargnera pas), est emprisonné. Entre le 4 mai et le 26 août 1452, Villon obtient sa licence et sa maîtrise ès arts.
De 1453 à 1455, il participe à des chahuts d'étudiants de plus en plus audacieux, à des bagarres avec la police; il hante les tavernes. Le 5 juin 1455, il blesse mortellement un prêtre, Philippe Sermoise, qui l’a pris à partie;

«
il
se fait panser, sous le nom de Michel Mouton, et
s'enfuit.
En janvier 1456, il obtient des lettres de rémis
sion pour le meurtre de Sermoise.
La nuit de Noël, il
participe à un vol de 500 écus au collège de Navarre,
avec Colin de Cayeux, Gui Tabarie, un moine picard,
Damp Nicolas, et Petit Jehan.
Il prétend avoir composé
cette nuit-là le Lais, écrit en réalité juste avant le vol ou
le lendemain, en hâte, pour se préparer un alibi ou pour
excuser un méfait qu'il aurait commis dans un état de
demi-inconscience.
Il quitte Paris, tout de suite après le vol -ou après
sa découverte.
en mars 1457.
L'enquête commence les 9
et 10 mars.
En mai, Pierre Marchand, curé de Paray, près
de Chartres, peut-être indicateur de police, fait parler
Tabarie, qui révèle que Villon s'est dirigé vers Angers
dans le dessein de voler un religieux.
Arrêté au milieu
de 1458, torturé, Tabarie fait des aveux et met en cause
Villon.
Celu i-- c i mène une vie errante, sans que l'on
puisse reconstituer son itinéraire, car les noms cités dans
le Testament semblent n'avoir été choisis que parce
qu'ils se prêtaient à des jeux de mots.
Sans doute passa
t-il par les cc·urs de Charles d'Orléans, à Blois (où il
composa la ballade «Je meurs de soif auprès de la fon
taine >> et le « Dit de la naissance de Marie d'Orléans >>),
et de Jean n de Bourbon, à Moulins, où il aurait écrit, en
échange de subsides, la « Requête à Monseigneur de
Bourbon>>.
Affilié à une bande de malfaiteurs, les
Coquillards, comme ses amis Colin de Cayeux et Regnier
de Montigny, il compose dans leur argot des ballades
complexes (où Pierre Guiraud a pu trouver plusieurs
niveaux de signification).
Durant l'été de 146 1, il subit,
à Meung-sur-Loire, une rigoureuse captivité, est soumis
à la question par 1 'eau.
torturé dans une prison de l' évê
que d'Orléans.
Thibaut d' Aussigny.
Pourquoi? On ne
sait : peut-être a-t-il commis un vol sacrilège, ou a-t-il
fait partie ,d'une troupe de baladins.
De cette période
datent 1' « Epître à ses amis >> et le « Débat du Corps et
du Cœur>>.
Le! 2 octobre, il est libéré, à l'occasion du
passage dans la ville de Louis XI.
Il commence la com
position du Testament, qu'il poursuit l'année suivante en
y intégrant de; pièces plus anciennes auxquelles il a pu
donner un sen;.
différent.
En 1462, il regagne Paris.
Inculpé de vol en novembre
et incarcéré au Châtelet, il est libéré le 7, après avoir
promis de rembourser 120 écus d'or au collège de
Navarre.
A lé.
fin du même mois, impliqué dans une
bagarre au cours de laquelle le notaire pontifical Fran
çois FerrebouC' ou Ferrebourg, qui s'était occupé du cam
briolage de NHvarre, avait reçu un coup d'épée de Robin
Dogis, Villon est arrêté, torturé, condamné à être pendu.
Il faü appel.
L-e 5 janvier 1463.
le pat;ement casse le
jugement et bannit Villon, .
Dans sa «Louange à la
Cour>> , Villon remercie les membres du parlement et
demande un délai de trois jours pour régler ses affaires;
dans la >; dans la« Ballade des dames du temps jadis>>,
le procédé est au service de la plus parfaite harmonie des
sons et de la plus pure poésie, tandis qu'une savante
progession renforce la démonstration.
A travers la
mélancolie, les précisions cocasses et le caractère com
posite de l'évocation -ombres vagues, s • enfonçant
dans la nuit, et personnages appartenant à la mémoire
populaire, comme Héloïse et Jeanne d'Arc -laissent
percer un léger sourire; l'incantation des rimes caressan
tes et d'un refrain enveloppé d'une frange de rêverie
suscite le retour d'un passé poétique.
Au contraire, dans
la« Ballade des seigneurs >>, prosaïque et sinistre comme
1' agonie, Villon réussit à inclure une dizaine de contem
porains, morts récemment de façon plus ou moins
affreuse.
Moins individualisée, la dernière pièce de
ce triptyque est enveloppée de la magie du vieux fran
çais.
Cet excellent artisant du vers n'hésite pas à prouver
son habileté en compliquant sa tâche par des acrostiches
qui le désignent lui-même ( > ).
Il lui arrive de donner au
refrain un sens différent dans l'une des strophes (.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- WEYERGANS François : sa vie et son oeuvre
- Introduction à la vie dévote. Ouvrage de François de Sales (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- TOUSSAINT François Vincent (vie et oeuvre)
- VILLEMAIN Abel François : sa vie et son oeuvre
- VIE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE (résumé & analyse de l’oeuvre)