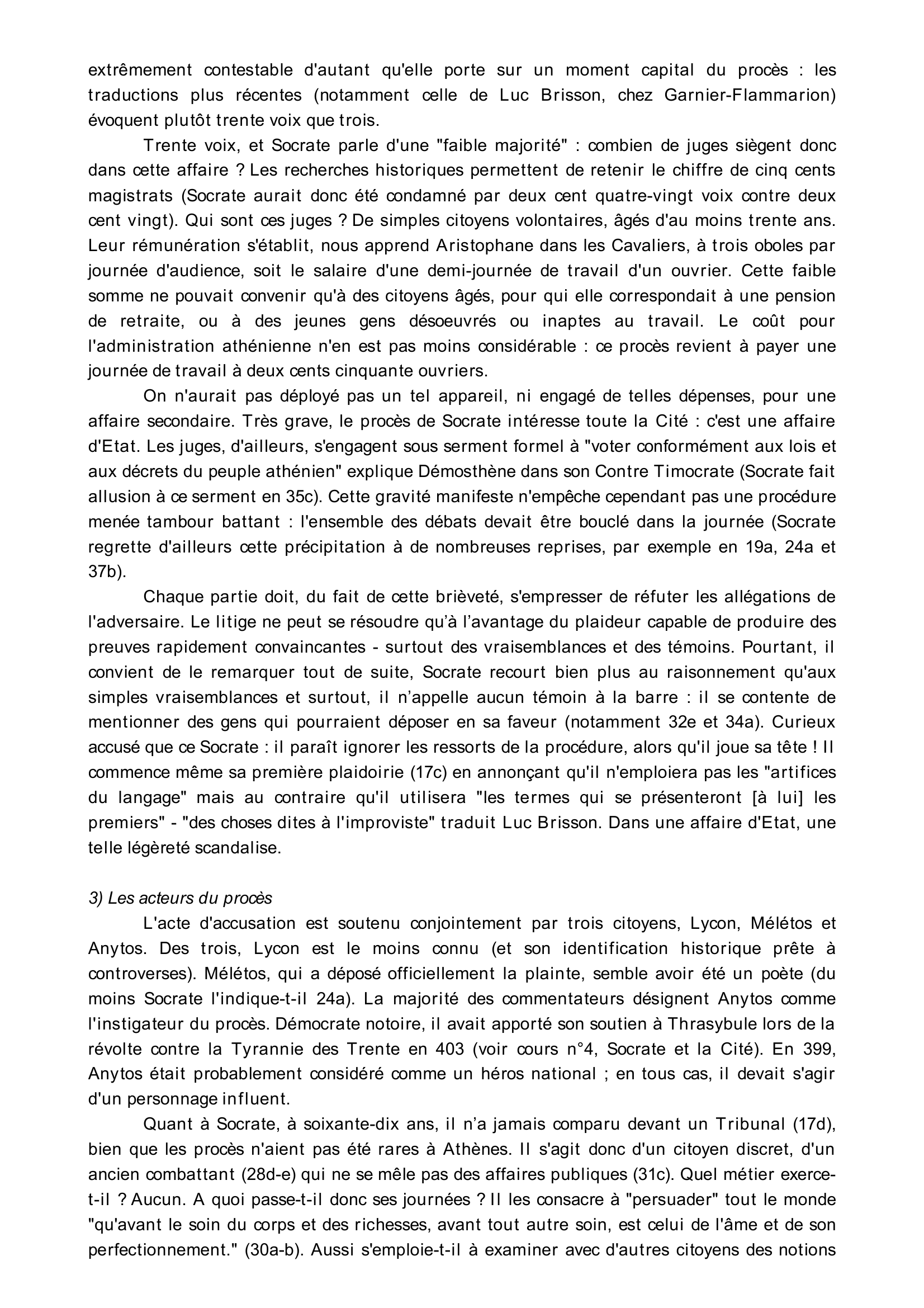Apologie de Socrate
Publié le 02/11/2013

Extrait du document
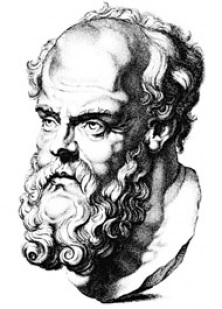
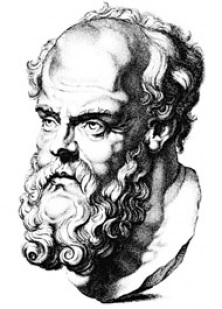
«
ext rêmemen t con testab le d'au tan t qu'el le po r te su r u n momen t capi ta l du p rocès : les
t rad uc t ions p l us récen tes (notammen t cel le de L uc B r isson, chez Ga r n ier-F lamma r ion)
évoquen t p l u tô t t ren te voix que t ro is.
T ren te voix, et Socra te pa r le d'une "fa ib le majo r i té" : combien de j uges siègen t donc
dans cet te affa i re ? Les recherches h is to r iques pe r me t ten t de re ten i r le chi f f re de cinq cen ts
mag is t ra ts (Socra te au ra i t donc été condamné pa r deux cen t qua t re-v i ng t voix con t re deux
cen t v i ng t).
Qu i son t ces j uges ? De simp les ci toyens volon ta i res, âgés d'au moi ns t ren te ans.
Leu r rém uné ra t ion s'étab l i t, nous app rend A r is tophane dans les Caval ie rs, à t ro is oboles pa r
jou r née d'aud ience, soi t le sala i re d'une dem i-jou r née de t rava i l d'un ouv r ier.
Cet te fa ib le
somme ne pouvai t conven i r qu'à des ci toyens âgés, pou r qu i el le cor responda i t à u ne pension
de re t ra i te, ou à des jeunes gens désoeuv rés ou i nap tes au t rava i l.
Le coû t pou r
l 'adm i n is t ra t ion a thén ienne n'en est pas moi ns considérab le : ce p rocès rev ien t à payer u ne
jou r née de t rava i l à deux cen ts cinquan te ouv r ie rs.
On n'au ra i t pas déployé pas u n te l appa rei l, n i engagé de te l les dépenses, pou r u ne
affa i re seconda i re.
T rès g rave, le p rocès de Socra te i n té resse tou te la C i té : c'est u ne affa i re
d'E ta t.
Les j uges, d'ai l leu rs, s'engagen t sous sermen t fo r mel à "vote r confo r mémen t aux lo is et
aux décrets du peup le a t hén ien" expl ique Démosthène dans son Con t re T i mocra te (Socra te fa i t
al l us ion à ce sermen t en 35c).
Cet te g rav i té man i feste n'empêche cependan t pas u ne p rocédu re
menée ta mbou r ba t ta n t : l 'ensemble des débats devai t êt re bouclé dans la jou r née (Socra te
reg re t te d'a i l leu rs cet te p récip i ta t ion à de nomb reuses rep r ises, pa r exemple en 19a, 24a et
37b).
Chaque pa r t ie doi t, du fa i t de cet te b r ièveté, s'emp resser de réfu te r les al léga t ions de
l 'adversai re.
Le l i t ige ne peu t se résoud re qu’à l’avan tage du p la ideu r capable de p rodu i re des
p reuves rap idemen t convai ncan tes - su r tou t des v ra isemb lances et des témoi ns.
Pou r ta n t, i l
conv ien t de le rema rque r tou t de su i te, Socra te recou r t bien p l us au ra isonnemen t qu'aux
simp les v ra isemb lances et su r tou t, i l n’appel le aucun témoi n à la ba r re : i l se con ten te de
men t ionne r des gens qu i pou r ra ien t déposer en sa faveu r (notammen t 32e et 34a).
Cu r ieux
accusé que ce Socra te : i l pa raî t igno re r les ressor ts de l a p rocédu re, alors qu' i l joue sa tê te ! I l
commence même sa p rem iè re p la idoi r ie (17c) en annonçan t qu' i l n'emp loiera pas les "a r t i f ices
du la ngage" ma is au con t ra i re qu' i l u t i l isera " les te r mes qu i se p résen te ron t [à l u i ] les
p rem ie rs" - "des choses d i tes à l ' i mp rov is te" t radu i t L uc B r isson.
Dans u ne affa i re d'E ta t, u ne
te l le légère té scandal ise.
3) Les acteurs du procès
L 'ac te d'accusa t ion est sou tenu conjoi n temen t pa r t ro is ci toyens, Lycon, Mé lé tos et
Any tos.
Des t ro is, Lycon est le moi ns connu (et son i den t i f ica t ion h is to r ique p rê te à
con t roverses).
Mé lé tos, qu i a déposé off iciel lemen t la p la i n te, semble avoi r été u n poète (du
moi ns Socra te l ' i nd ique-t- i l 24a).
L a majo r i té des commen ta teu rs désignen t Any tos comme
l ' i ns t iga teu r du p rocès.
Démocra te no toi re, i l avai t appo r té son sou t ien à T h rasybu le lo rs de la
révol te con t re la T y ra nn ie des T ren te en 403 (voi r cou rs n°4, Socra te et la Ci té).
E n 399,
Any tos éta i t p robablemen t considé ré comme u n hé ros na t iona l ; en tous cas, i l devai t s'agi r
d'un personnage i n f l uen t.
Quan t à Socra te, à soixan te-d i x ans, i l n’a ja ma is compa r u devan t u n T r i b u na l (17d),
bien que les p rocès n'a ien t pas été ra res à A t hènes.
I l s'agi t donc d'un ci toyen d iscret, d'un
ancien comba t ta n t (28d-e) qu i ne se mêle pas des affa i res pub l iques (31c).
Quel mé t ie r exerce-
t - i l ? A ucun.
A quoi passe-t -i l donc ses jou r nées ? I l les consacre à "persuader" tou t le monde
"qu'avan t le soin du corps et des r ichesses, avan t tou t au t re soin, est celu i de l 'âme et de son
pe rfect ionnemen t." (30a-b).
Aussi s'emploie-t- i l à exam i ne r avec d'au t res ci toyens des not ions.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse de l’apologie de Socrate
- APOLOGIE DE SOCRATE, Platon (résumé)
- APOLOGIE DE SOCRATE (résumé & analyse) de Platon
- VÉRITABLE APOLOGIE DE SOCRATE (La) Varnalis (résumé)
- apologie socrate