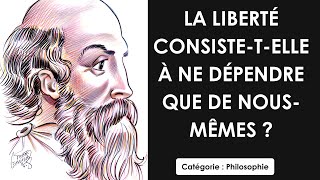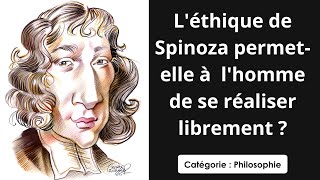Autrui est-il un autre moi-même ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document
«
essentielle sans sacrifier la communauté qui nous lie.
Dans L'Etre et le néant , Sartre y parvient en comprenant autrui comme « un autre moi qui n'est pas moi ».
Un autre moi dont je suisséparé par une distance infranchissable, immotivée, si ce n'est par la libertédont autrui témoigne.
C'est sa liberté, que je ne peux réduire, qui faitqu'autrui ne cesse de m'excéder, de me transcender.
Sartre et Lévinas vont ainsi thématiser chacun à leur manière l'échecdans ma relation avec autrui comme une découverte de l'altérité.
C'est parcequ'autrui me déçoit ou m'étonne, bref, ne se plie pas à se que j'en attendais,diffère de l'idée que je m'en étais fait, qu'il s'affirme comme à distance demoi-même.
C'est seulement dans l'échec de la fusion, de la communication,de la complicité, bref dans la rupture de l'idylle, que l'altérité d'autruim'apparait transcendante.
Il faut donc penser une positivité du conflit : dansle différent qui m'oppose à autrui, c'est sa liberté, synonyme de son altérité,qui se révèle, et réciproquement, la mienne.
Sartre insiste sur la violence qui structure mon rapport à autrui, parexemple dans la passion, la caresse est selon lui une tentative pourdomestiquer autrui, se l'approprier, le rendre inoffensif.
En le caressant jechosifie autrui, j'en fais ma chose, j'essaie de le désarmer, de vaincre sesrésistances, bref, en cherchant à le rejoindre je m'en éloigne, en fusionnantnous nous perdons chacun comme être singuliers et doués de liberté.
De soncôté, par exemple dans Totalité et infini , Lévinas souligne l'impossibilité de la fusion, l'irréductibilité fondamentale qui anime autrui et fait qu'il ne cesse dem'échapper.
Cette irréductibilité s'atteste dans le visage d'autrui, lequelexcède toujours ce que j'en peux dire et ouvre irréversiblement une dimension énigmatique, constitutive d'autrui, delaquelle je ne saurai venir à bout.
Pour Lévinas, l'éthique est la « voie royale vers l'absolument autre » (Préface).
En effet, le désir d'infini n'est pas undésir au sens habituel et négatif de manque mais une expérience sans retour possible de soi vers l'autre, du familiervers l'étranger.
Car « l'absolument autre, c'est autrui » (Rupture de la totalité), autrui n'est donc pas la négation demoi-même, ce qui impliquerait encore une relation d'identité, mais il est positivement « l'absolument autre ».
Autruime révèle le sens de l'éthique comme « rapport non allergique du Même et de l'Autre » (L'Être comme bonté).L'éthique trouvant son sens premier dans la relation de face à face, elle présuppose une ouverture à « l'absolumentautre » que seul le visage d'autrui permet d'entrevoir.
L'éthique est bien originellement une « optique » mais sansimage, car la vision est encore une totalisation.
Or le visage empêche le regard de se fixer, il nous tourne vers unau-delà, un ailleurs ; il figure « l'infiniment autre » qu'on ne parviendra jamais à totaliser.
Le visage d'autrui se donneà voir comme « révélation » de l'Autre dans sa nudité et sa fragilité.
Il m'appelle alors à la responsabilité infiniedevant lui.
III- Moi-même comme un autre. Dans un aphorisme du Gai savoir , Nietzsche pose le moi comme une forteresse imprenable pour soi-même. D'après lui, c'est seulement avec le concours d'autrui, par sa médiation, que je vais apprendre à me connaître, àdécouvrir la vérité sur moi-même.
Mais si autrui est susceptible d'incarner une médiation dans la connaissance demoi-même, ce que pense également Aristote, il faut voir que mon rapport à autrui est probablement plusfondamental encore, ce n'est pas seulement une idée, une connaissance de moi-même qu'autrui m'aide à forger, ilm'aide encore à prendre conscience de moi-même.
Il faut dépasser l'idée d'une médiation gnoséologique, vers unemédiation ontologique dont autrui serait la charnière.
Nous avons vu que, pour Sartre, c'est sa liberté qui constitue autrui comme un alter ego toujours autreque moi-même, essentiellement différent de moi.
Or, cette liberté doit être conçue comme l'indice de la mienne :l'irréductibilité d'autrui à moi-même devient l'index de ma propre liberté, c'est-à-dire de ma propre transcendance parrapport à moi-même.
Autrement dit c'est à partir d'autrui que je me comprends moi-même, que je prends consciencede mon existence sur le mode de la liberté et du projet.
En tant qu'il m'excède, autrui me renvoie à mes proprespossibilités, à la faculté que j'ai à mon tour de transcender le donné.
Si autrui diffère toujours de moi, moi-même j'existe sur le mode de la divergence, c'est-à-dire que monessence est irréductible à quelque donné, je la construis loin qu'elle me précède.
C'est en ce sens que Sartre peutdéfendre l'idée selon laquelle « l'existence précède l'essence » ; c'est parce que j'existe comme être de projet,toujours en avant ou en défaut de moi-même, toujours différent, ce que me révèle l'expérience d'autrui, que je peuxaffirmer la nullité de toute détermination a priori de mon essence.
L'indéterminabilité et la liberté d'autrui sont aussi bien les miennes.
Conclusion : Autrui n'est pas seulement un autre moi-même entendu comme double, image de moi-même, répétition.
Ilest un autre moi-même en tant que moi libre , et c'est précisément de cette liberté qu'il tire à la fois sa communauté et sa différence par rapport à moi.
Nous sommes tous deux des êtres libres, et par cette liberté nous exprimonschacun notre singularité, autrui est donc un autre moi qui n'est pas moi, il existe sur un mode semblable au mienmais axe son existence selon des polarités qui lui sont propres..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓