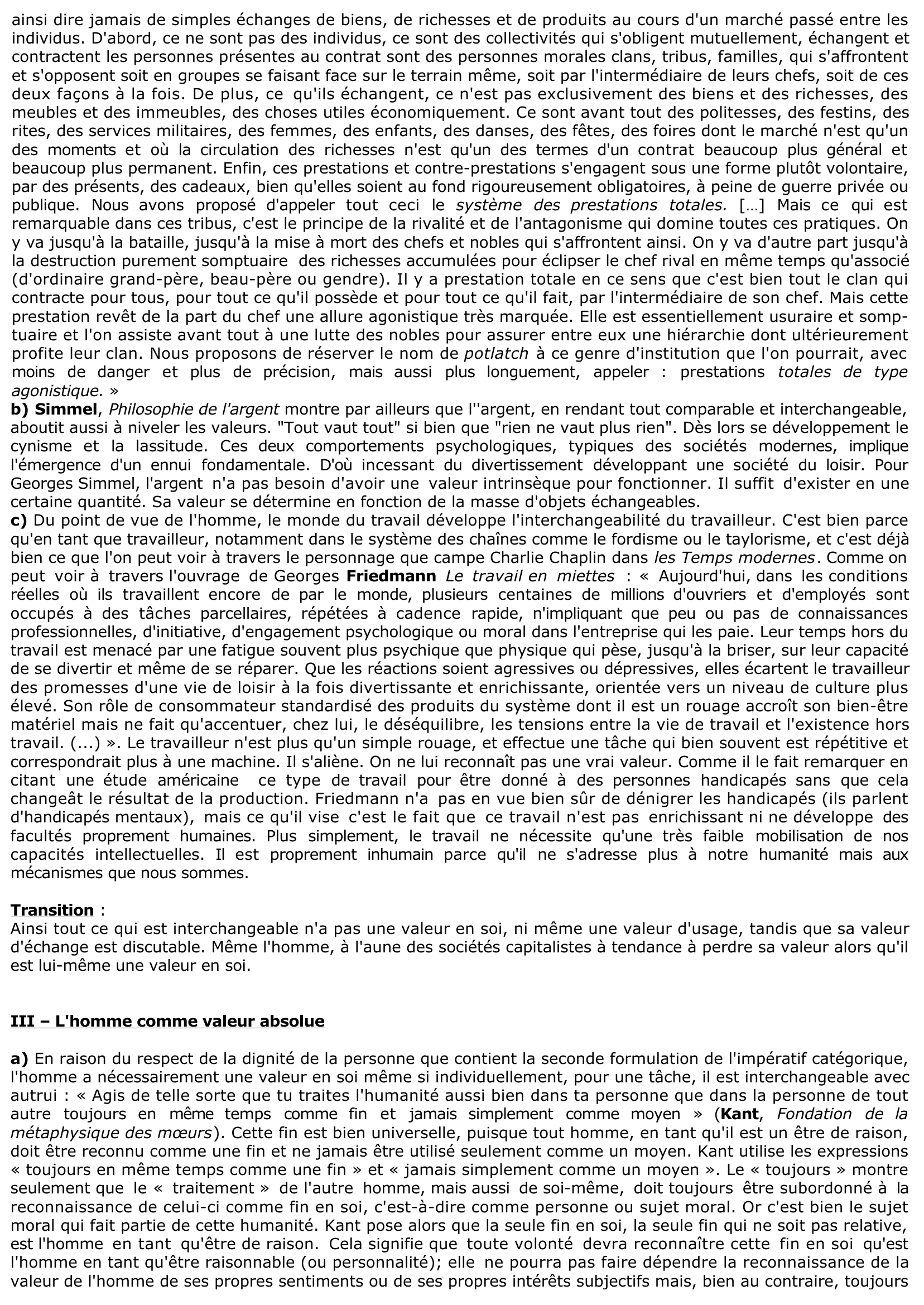Ce qui est interchangeable est-il sans valeur ?
Publié le 23/06/2009

Extrait du document
La valeur désigne la qualité d’un objet, d’une objet. En économie, la valeur rend compte du prix d’un produit, dont le calcul intègre un ensemble de facteurs, tant sociologiques que psychologique. La valeur comprend sens au sein de l’échange. Il se comprend au sein du travail. La tradition reconnaît au moins deux valeurs : une valeur d’usage et une valeur d’échange. L’usage mesure l’utilité du produit pour le consommateur, tandis que la valeur d’échange mesure la valeur de l’objet en vue d’autre chose. Il comprend le temps de travail, la qualité et la quantité du produit. A celles-ci s’ajoute la valeur en soi d’un élément, c’est-à-dire sa valeur pure, inconditionnellement. L’interchangeable est donc au cœur de l’échange mais se saisit comme remplacement possible d’un élément par un autre. Or pouvoir remplacer un élément par un autre est-ce nécessairement ne pas lui accorder de valeur ? N’est-ce pas aller contre l’essence même de l’échange ?
S’il y a bien une valeur d’échange et une valeur d’une usage (1ère partie), il n’en reste pas moins que ce qui peut être remplacé peut perdre toute valeur à nos yeux (2nd partie), pourtant, à l’aune d’une société du travail, l’homme même si dans ses fonctions peut être interchangeables, il n’a pas moins une valeur en soi (3ème partie).
«
ainsi dire jamais de simples échanges de biens, de richesses et de produits au cours d'un marché passé entre lesindividus.
D'abord, ce ne sont pas des individus, ce sont des collectivités qui s'obligent mutuellement, échangent etcontractent les personnes présentes au contrat sont des personnes morales clans, tribus, familles, qui s'affrontentet s'opposent soit en groupes se faisant face sur le terrain même, soit par l'intermédiaire de leurs chefs, soit de cesdeux façons à la fois.
De plus, ce qu'ils échangent, ce n'est pas exclusivement des biens et des richesses, desmeubles et des immeubles, des choses utiles économiquement.
Ce sont avant tout des politesses, des festins, desrites, des services militaires, des femmes, des enfants, des danses, des fêtes, des foires dont le marché n'est qu'undes moments et où la circulation des richesses n'est qu'un des termes d'un contrat beaucoup plus général etbeaucoup plus permanent.
Enfin, ces prestations et contre-prestations s'engagent sous une forme plutôt volontaire,par des présents, des cadeaux, bien qu'elles soient au fond rigoureusement obligatoires, à peine de guerre privée oupublique.
Nous avons proposé d'appeler tout ceci le système des prestations totales.
[…] Mais ce qui est remarquable dans ces tribus, c'est le principe de la rivalité et de l'antagonisme qui domine toutes ces pratiques.
Ony va jusqu'à la bataille, jusqu'à la mise à mort des chefs et nobles qui s'affrontent ainsi.
On y va d'autre part jusqu'àla destruction purement somptuaire des richesses accumulées pour éclipser le chef rival en même temps qu'associé(d'ordinaire grand-père, beau-père ou gendre).
Il y a prestation totale en ce sens que c'est bien tout le clan quicontracte pour tous, pour tout ce qu'il possède et pour tout ce qu'il fait, par l'intermédiaire de son chef.
Mais cetteprestation revêt de la part du chef une allure agonistique très marquée.
Elle est essentiellement usuraire et somp-tuaire et l'on assiste avant tout à une lutte des nobles pour assurer entre eux une hiérarchie dont ultérieurementprofite leur clan.
Nous proposons de réserver le nom de potlatch à ce genre d'institution que l'on pourrait, avec moins de danger et plus de précision, mais aussi plus longuement, appeler : prestations totales de type agonistique. » b) Simmel , Philosophie de l'argent montre par ailleurs que l''argent, en rendant tout comparable et interchangeable, aboutit aussi à niveler les valeurs.
"Tout vaut tout" si bien que "rien ne vaut plus rien".
Dès lors se développement lecynisme et la lassitude.
Ces deux comportements psychologiques, typiques des sociétés modernes, impliquel'émergence d'un ennui fondamentale.
D'où incessant du divertissement développant une société du loisir.
PourGeorges Simmel, l'argent n'a pas besoin d'avoir une valeur intrinsèque pour fonctionner.
Il suffit d'exister en unecertaine quantité.
Sa valeur se détermine en fonction de la masse d'objets échangeables.c) Du point de vue de l'homme, le monde du travail développe l'interchangeabilité du travailleur.
C'est bien parcequ'en tant que travailleur, notamment dans le système des chaînes comme le fordisme ou le taylorisme, et c'est déjàbien ce que l'on peut voir à travers le personnage que campe Charlie Chaplin dans les Temps modernes .
Comme on peut voir à travers l'ouvrage de Georges Friedmann Le travail en miettes : « Aujourd'hui, dans les conditions réelles où ils travaillent encore de par le monde, plusieurs centaines de millions d'ouvriers et d'employés sontoccupés à des tâches parcellaires, répétées à cadence rapide, n'impliquant que peu ou pas de connaissancesprofessionnelles, d'initiative, d'engagement psychologique ou moral dans l'entreprise qui les paie.
Leur temps hors dutravail est menacé par une fatigue souvent plus psychique que physique qui pèse, jusqu'à la briser, sur leur capacitéde se divertir et même de se réparer.
Que les réactions soient agressives ou dépressives, elles écartent le travailleurdes promesses d'une vie de loisir à la fois divertissante et enrichissante, orientée vers un niveau de culture plusélevé.
Son rôle de consommateur standardisé des produits du système dont il est un rouage accroît son bien-êtrematériel mais ne fait qu'accentuer, chez lui, le déséquilibre, les tensions entre la vie de travail et l'existence horstravail.
(...) ».
Le travailleur n'est plus qu'un simple rouage, et effectue une tâche qui bien souvent est répétitive etcorrespondrait plus à une machine.
Il s'aliène.
On ne lui reconnaît pas une vrai valeur.
Comme il le fait remarquer encitant une étude américaine ce type de travail pour être donné à des personnes handicapés sans que celachangeât le résultat de la production.
Friedmann n'a pas en vue bien sûr de dénigrer les handicapés (ils parlentd'handicapés mentaux), mais ce qu'il vise c'est le fait que ce travail n'est pas enrichissant ni ne développe desfacultés proprement humaines.
Plus simplement, le travail ne nécessite qu'une très faible mobilisation de noscapacités intellectuelles.
Il est proprement inhumain parce qu'il ne s'adresse plus à notre humanité mais auxmécanismes que nous sommes.
Transition : Ainsi tout ce qui est interchangeable n'a pas une valeur en soi, ni même une valeur d'usage, tandis que sa valeurd'échange est discutable.
Même l'homme, à l'aune des sociétés capitalistes à tendance à perdre sa valeur alors qu'ilest lui-même une valeur en soi.
III – L'homme comme valeur absolue a) En raison du respect de la dignité de la personne que contient la seconde formulation de l'impératif catégorique,l'homme a nécessairement une valeur en soi même si individuellement, pour une tâche, il est interchangeable avecautrui : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de toutautre toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen » ( Kant , Fondation de la métaphysique des mœurs ).
Cette fin est bien universelle, puisque tout homme, en tant qu'il est un être de raison, doit être reconnu comme une fin et ne jamais être utilisé seulement comme un moyen.
Kant utilise les expressions« toujours en même temps comme une fin » et « jamais simplement comme un moyen ».
Le « toujours » montreseulement que le « traitement » de l'autre homme, mais aussi de soi-même, doit toujours être subordonné à lareconnaissance de celui-ci comme fin en soi, c'est-à-dire comme personne ou sujet moral.
Or c'est bien le sujetmoral qui fait partie de cette humanité.
Kant pose alors que la seule fin en soi, la seule fin qui ne soit pas relative,est l'homme en tant qu'être de raison.
Cela signifie que toute volonté devra reconnaître cette fin en soi qu'estl'homme en tant qu'être raisonnable (ou personnalité); elle ne pourra pas faire dépendre la reconnaissance de lavaleur de l'homme de ses propres sentiments ou de ses propres intérêts subjectifs mais, bien au contraire, toujours.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓