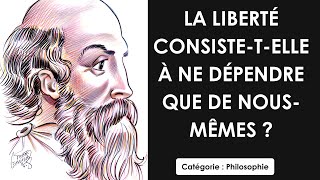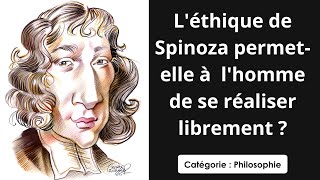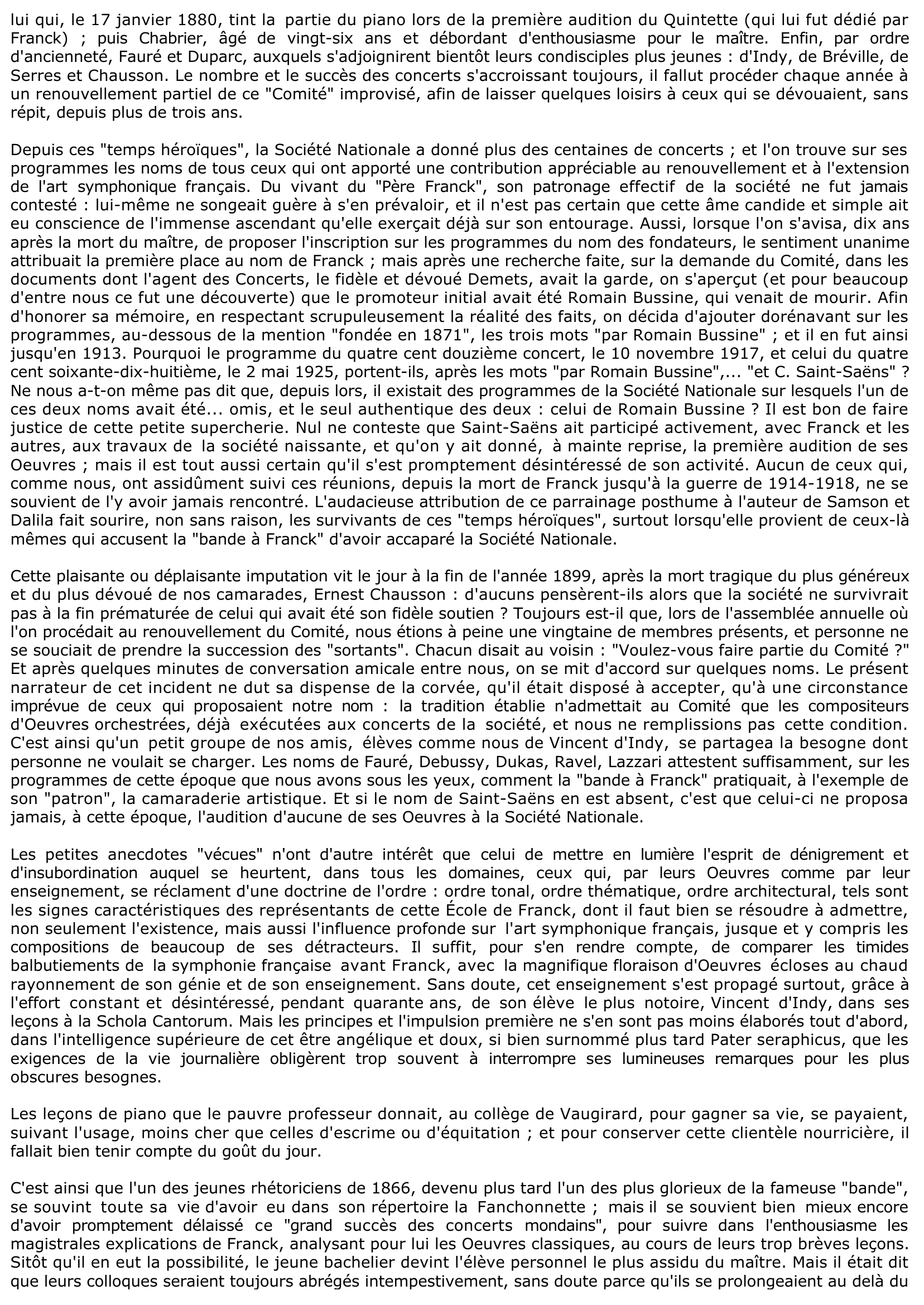César Franck
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
«
lui qui, le 17 janvier 1880, tint la partie du piano lors de la première audition du Quintette (qui lui fut dédié parFranck) ; puis Chabrier, âgé de vingt-six ans et débordant d'enthousiasme pour le maître.
Enfin, par ordred'ancienneté, Fauré et Duparc, auxquels s'adjoignirent bientôt leurs condisciples plus jeunes : d'Indy, de Bréville, deSerres et Chausson.
Le nombre et le succès des concerts s'accroissant toujours, il fallut procéder chaque année àun renouvellement partiel de ce "Comité" improvisé, afin de laisser quelques loisirs à ceux qui se dévouaient, sansrépit, depuis plus de trois ans.
Depuis ces "temps héroïques", la Société Nationale a donné plus des centaines de concerts ; et l'on trouve sur sesprogrammes les noms de tous ceux qui ont apporté une contribution appréciable au renouvellement et à l'extensionde l'art symphonique français.
Du vivant du "Père Franck", son patronage effectif de la société ne fut jamaiscontesté : lui-même ne songeait guère à s'en prévaloir, et il n'est pas certain que cette âme candide et simple aiteu conscience de l'immense ascendant qu'elle exerçait déjà sur son entourage.
Aussi, lorsque l'on s'avisa, dix ansaprès la mort du maître, de proposer l'inscription sur les programmes du nom des fondateurs, le sentiment unanimeattribuait la première place au nom de Franck ; mais après une recherche faite, sur la demande du Comité, dans lesdocuments dont l'agent des Concerts, le fidèle et dévoué Demets, avait la garde, on s'aperçut (et pour beaucoupd'entre nous ce fut une découverte) que le promoteur initial avait été Romain Bussine, qui venait de mourir.
Afind'honorer sa mémoire, en respectant scrupuleusement la réalité des faits, on décida d'ajouter dorénavant sur lesprogrammes, au-dessous de la mention "fondée en 1871", les trois mots "par Romain Bussine" ; et il en fut ainsijusqu'en 1913.
Pourquoi le programme du quatre cent douzième concert, le 10 novembre 1917, et celui du quatrecent soixante-dix-huitième, le 2 mai 1925, portent-ils, après les mots "par Romain Bussine",...
"et C.
Saint-Saëns" ?Ne nous a-t-on même pas dit que, depuis lors, il existait des programmes de la Société Nationale sur lesquels l'un deces deux noms avait été...
omis, et le seul authentique des deux : celui de Romain Bussine ? Il est bon de fairejustice de cette petite supercherie.
Nul ne conteste que Saint-Saëns ait participé activement, avec Franck et lesautres, aux travaux de la société naissante, et qu'on y ait donné, à mainte reprise, la première audition de sesOeuvres ; mais il est tout aussi certain qu'il s'est promptement désintéressé de son activité.
Aucun de ceux qui,comme nous, ont assidûment suivi ces réunions, depuis la mort de Franck jusqu'à la guerre de 1914-1918, ne sesouvient de l'y avoir jamais rencontré.
L'audacieuse attribution de ce parrainage posthume à l'auteur de Samson etDalila fait sourire, non sans raison, les survivants de ces "temps héroïques", surtout lorsqu'elle provient de ceux-làmêmes qui accusent la "bande à Franck" d'avoir accaparé la Société Nationale.
Cette plaisante ou déplaisante imputation vit le jour à la fin de l'année 1899, après la mort tragique du plus généreuxet du plus dévoué de nos camarades, Ernest Chausson : d'aucuns pensèrent-ils alors que la société ne survivraitpas à la fin prématurée de celui qui avait été son fidèle soutien ? Toujours est-il que, lors de l'assemblée annuelle oùl'on procédait au renouvellement du Comité, nous étions à peine une vingtaine de membres présents, et personne nese souciait de prendre la succession des "sortants".
Chacun disait au voisin : "Voulez-vous faire partie du Comité ?"Et après quelques minutes de conversation amicale entre nous, on se mit d'accord sur quelques noms.
Le présentnarrateur de cet incident ne dut sa dispense de la corvée, qu'il était disposé à accepter, qu'à une circonstanceimprévue de ceux qui proposaient notre nom : la tradition établie n'admettait au Comité que les compositeursd'Oeuvres orchestrées, déjà exécutées aux concerts de la société, et nous ne remplissions pas cette condition.C'est ainsi qu'un petit groupe de nos amis, élèves comme nous de Vincent d'Indy, se partagea la besogne dontpersonne ne voulait se charger.
Les noms de Fauré, Debussy, Dukas, Ravel, Lazzari attestent suffisamment, sur lesprogrammes de cette époque que nous avons sous les yeux, comment la "bande à Franck" pratiquait, à l'exemple deson "patron", la camaraderie artistique.
Et si le nom de Saint-Saëns en est absent, c'est que celui-ci ne proposajamais, à cette époque, l'audition d'aucune de ses Oeuvres à la Société Nationale.
Les petites anecdotes "vécues" n'ont d'autre intérêt que celui de mettre en lumière l'esprit de dénigrement etd'insubordination auquel se heurtent, dans tous les domaines, ceux qui, par leurs Oeuvres comme par leurenseignement, se réclament d'une doctrine de l'ordre : ordre tonal, ordre thématique, ordre architectural, tels sontles signes caractéristiques des représentants de cette École de Franck, dont il faut bien se résoudre à admettre,non seulement l'existence, mais aussi l'influence profonde sur l'art symphonique français, jusque et y compris lescompositions de beaucoup de ses détracteurs.
Il suffit, pour s'en rendre compte, de comparer les timidesbalbutiements de la symphonie française avant Franck, avec la magnifique floraison d'Oeuvres écloses au chaudrayonnement de son génie et de son enseignement.
Sans doute, cet enseignement s'est propagé surtout, grâce àl'effort constant et désintéressé, pendant quarante ans, de son élève le plus notoire, Vincent d'Indy, dans sesleçons à la Schola Cantorum.
Mais les principes et l'impulsion première ne s'en sont pas moins élaborés tout d'abord,dans l'intelligence supérieure de cet être angélique et doux, si bien surnommé plus tard Pater seraphicus, que lesexigences de la vie journalière obligèrent trop souvent à interrompre ses lumineuses remarques pour les plusobscures besognes.
Les leçons de piano que le pauvre professeur donnait, au collège de Vaugirard, pour gagner sa vie, se payaient,suivant l'usage, moins cher que celles d'escrime ou d'équitation ; et pour conserver cette clientèle nourricière, ilfallait bien tenir compte du goût du jour.
C'est ainsi que l'un des jeunes rhétoriciens de 1866, devenu plus tard l'un des plus glorieux de la fameuse "bande",se souvint toute sa vie d'avoir eu dans son répertoire la Fanchonnette ; mais il se souvient bien mieux encored'avoir promptement délaissé ce "grand succès des concerts mondains", pour suivre dans l'enthousiasme lesmagistrales explications de Franck, analysant pour lui les Oeuvres classiques, au cours de leurs trop brèves leçons.Sitôt qu'il en eut la possibilité, le jeune bachelier devint l'élève personnel le plus assidu du maître.
Mais il était ditque leurs colloques seraient toujours abrégés intempestivement, sans doute parce qu'ils se prolongeaient au delà du.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ÉOLIDES (Les) de César Franck (résumé)
- RÉDEMPTION. César Franck. Résumé et analyse
- DJINNS (Les). de César Franck
- BÉATITUDES (Les). (résumé & analyse) César Franck
- TROIS CHORALS. César Franck