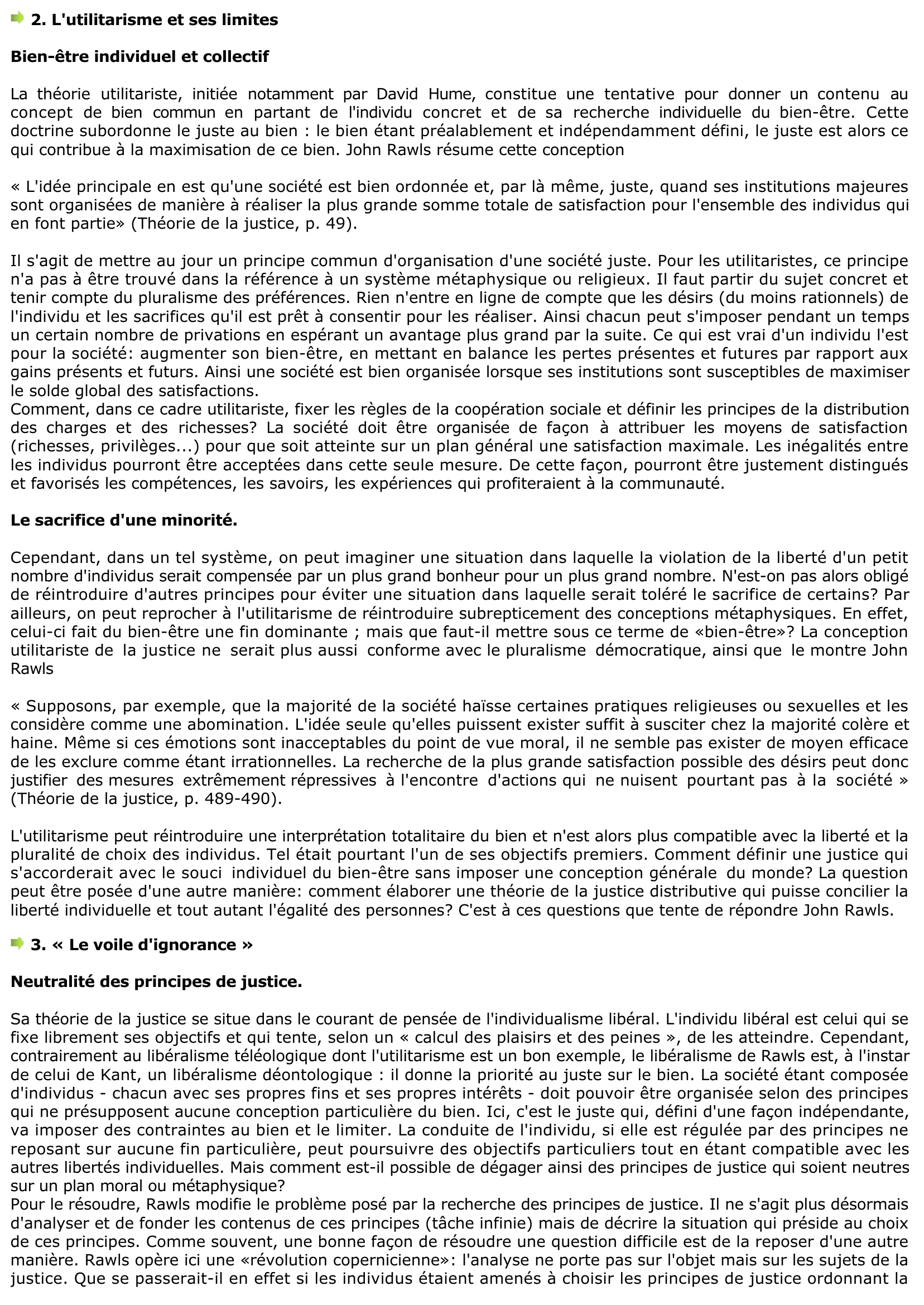Est-il dans la nature de l'État de refuser les différences ?
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
La question du juste et de l'injuste est de celles qui provoquent de vives réactions. Chacun se sent agressé lorsqu'il a le sentiment de n'avoir pas été traité d'une façon comparable aux autres. Dès lors, il peut sembler qu'un accord unanime peut être aisément obtenu entre les individus qui composent une communauté: les personnes doivent être traitées d'une façon égale. Mais ce qui constitue une revendication personnelle ne suffit pas pour autant à définir un principe d'organisation des sociétés complexes. Il n'y, a rien sans doute de plus injuste qu'une société égalitariste: donnera-t-on à chacun exactement la même chose sans tenir compte des différences individuelles? Faut-il traiter d'une façon identique tous les individus? Mais l'égalité n'est pas l'identité. Comment alors penser en même temps l'égalité et la différence? Ce qui revient à se demander s'il est possible d'organiser une société autour de ces deux valeurs que sont la liberté et l'égalité. Dès lors, une société juste ne sera-t-elle pas condamnée à s'accommoder de certaines formes d'inégalité?
«
2.
L'utilitarisme et ses limites
Bien-être individuel et collectif
La théorie utilitariste, initiée notamment par David Hume, constitue une tentative pour donner un contenu auconcept de bien commun en partant de l'individu concret et de sa recherche individuelle du bien-être.
Cettedoctrine subordonne le juste au bien : le bien étant préalablement et indépendamment défini, le juste est alors cequi contribue à la maximisation de ce bien.
John Rawls résume cette conception
« L'idée principale en est qu'une société est bien ordonnée et, par là même, juste, quand ses institutions majeuressont organisées de manière à réaliser la plus grande somme totale de satisfaction pour l'ensemble des individus quien font partie» (Théorie de la justice, p.
49).
Il s'agit de mettre au jour un principe commun d'organisation d'une société juste.
Pour les utilitaristes, ce principen'a pas à être trouvé dans la référence à un système métaphysique ou religieux.
Il faut partir du sujet concret ettenir compte du pluralisme des préférences.
Rien n'entre en ligne de compte que les désirs (du moins rationnels) del'individu et les sacrifices qu'il est prêt à consentir pour les réaliser.
Ainsi chacun peut s'imposer pendant un tempsun certain nombre de privations en espérant un avantage plus grand par la suite.
Ce qui est vrai d'un individu l'estpour la société: augmenter son bien-être, en mettant en balance les pertes présentes et futures par rapport auxgains présents et futurs.
Ainsi une société est bien organisée lorsque ses institutions sont susceptibles de maximiserle solde global des satisfactions.Comment, dans ce cadre utilitariste, fixer les règles de la coopération sociale et définir les principes de la distributiondes charges et des richesses? La société doit être organisée de façon à attribuer les moyens de satisfaction(richesses, privilèges...) pour que soit atteinte sur un plan général une satisfaction maximale.
Les inégalités entreles individus pourront être acceptées dans cette seule mesure.
De cette façon, pourront être justement distinguéset favorisés les compétences, les savoirs, les expériences qui profiteraient à la communauté.
Le sacrifice d'une minorité.
Cependant, dans un tel système, on peut imaginer une situation dans laquelle la violation de la liberté d'un petitnombre d'individus serait compensée par un plus grand bonheur pour un plus grand nombre.
N'est-on pas alors obligéde réintroduire d'autres principes pour éviter une situation dans laquelle serait toléré le sacrifice de certains? Parailleurs, on peut reprocher à l'utilitarisme de réintroduire subrepticement des conceptions métaphysiques.
En effet,celui-ci fait du bien-être une fin dominante ; mais que faut-il mettre sous ce terme de «bien-être»? La conceptionutilitariste de la justice ne serait plus aussi conforme avec le pluralisme démocratique, ainsi que le montre JohnRawls
« Supposons, par exemple, que la majorité de la société haïsse certaines pratiques religieuses ou sexuelles et lesconsidère comme une abomination.
L'idée seule qu'elles puissent exister suffit à susciter chez la majorité colère ethaine.
Même si ces émotions sont inacceptables du point de vue moral, il ne semble pas exister de moyen efficacede les exclure comme étant irrationnelles.
La recherche de la plus grande satisfaction possible des désirs peut doncjustifier des mesures extrêmement répressives à l'encontre d'actions qui ne nuisent pourtant pas à la société »(Théorie de la justice, p.
489-490).
L'utilitarisme peut réintroduire une interprétation totalitaire du bien et n'est alors plus compatible avec la liberté et lapluralité de choix des individus.
Tel était pourtant l'un de ses objectifs premiers.
Comment définir une justice quis'accorderait avec le souci individuel du bien-être sans imposer une conception générale du monde? La questionpeut être posée d'une autre manière: comment élaborer une théorie de la justice distributive qui puisse concilier laliberté individuelle et tout autant l'égalité des personnes? C'est à ces questions que tente de répondre John Rawls.
3.
« Le voile d'ignorance »
Neutralité des principes de justice.
Sa théorie de la justice se situe dans le courant de pensée de l'individualisme libéral.
L'individu libéral est celui qui sefixe librement ses objectifs et qui tente, selon un « calcul des plaisirs et des peines », de les atteindre.
Cependant,contrairement au libéralisme téléologique dont l'utilitarisme est un bon exemple, le libéralisme de Rawls est, à l'instarde celui de Kant, un libéralisme déontologique : il donne la priorité au juste sur le bien.
La société étant composéed'individus - chacun avec ses propres fins et ses propres intérêts - doit pouvoir être organisée selon des principesqui ne présupposent aucune conception particulière du bien.
Ici, c'est le juste qui, défini d'une façon indépendante,va imposer des contraintes au bien et le limiter.
La conduite de l'individu, si elle est régulée par des principes nereposant sur aucune fin particulière, peut poursuivre des objectifs particuliers tout en étant compatible avec lesautres libertés individuelles.
Mais comment est-il possible de dégager ainsi des principes de justice qui soient neutressur un plan moral ou métaphysique?Pour le résoudre, Rawls modifie le problème posé par la recherche des principes de justice.
Il ne s'agit plus désormaisd'analyser et de fonder les contenus de ces principes (tâche infinie) mais de décrire la situation qui préside au choixde ces principes.
Comme souvent, une bonne façon de résoudre une question difficile est de la reposer d'une autremanière.
Rawls opère ici une «révolution copernicienne»: l'analyse ne porte pas sur l'objet mais sur les sujets de lajustice.
Que se passerait-il en effet si les individus étaient amenés à choisir les principes de justice ordonnant la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les mathématiques et les sciences de la nature (ressemblances et différences)
- Peut-on fonder les différences culturelles sur la nature ?
- Vouloir transformer la nature, est-ce refuser de la respecter ?
- REFUSER LA NATURE HUMAINE ?
- Victor Hugo écrit : «La nature procède par contrastes. C'est par les oppositions qu'elle fait saillir les objets. C'est par leurs contraires qu'elle fait sentir les choses, le jour par la nuit, le chaud par le froid, etc.; toute clarté fait ombre. De là le relief, le contour, la proportion, le rapport, la réalité. La création, la vie, le destin, ne sont pour l'homme qu'un immense clair-obscur. Le poète, ce philosophe du concret et ce peintre de l'abstrait, le poète, ce penseur suprême,