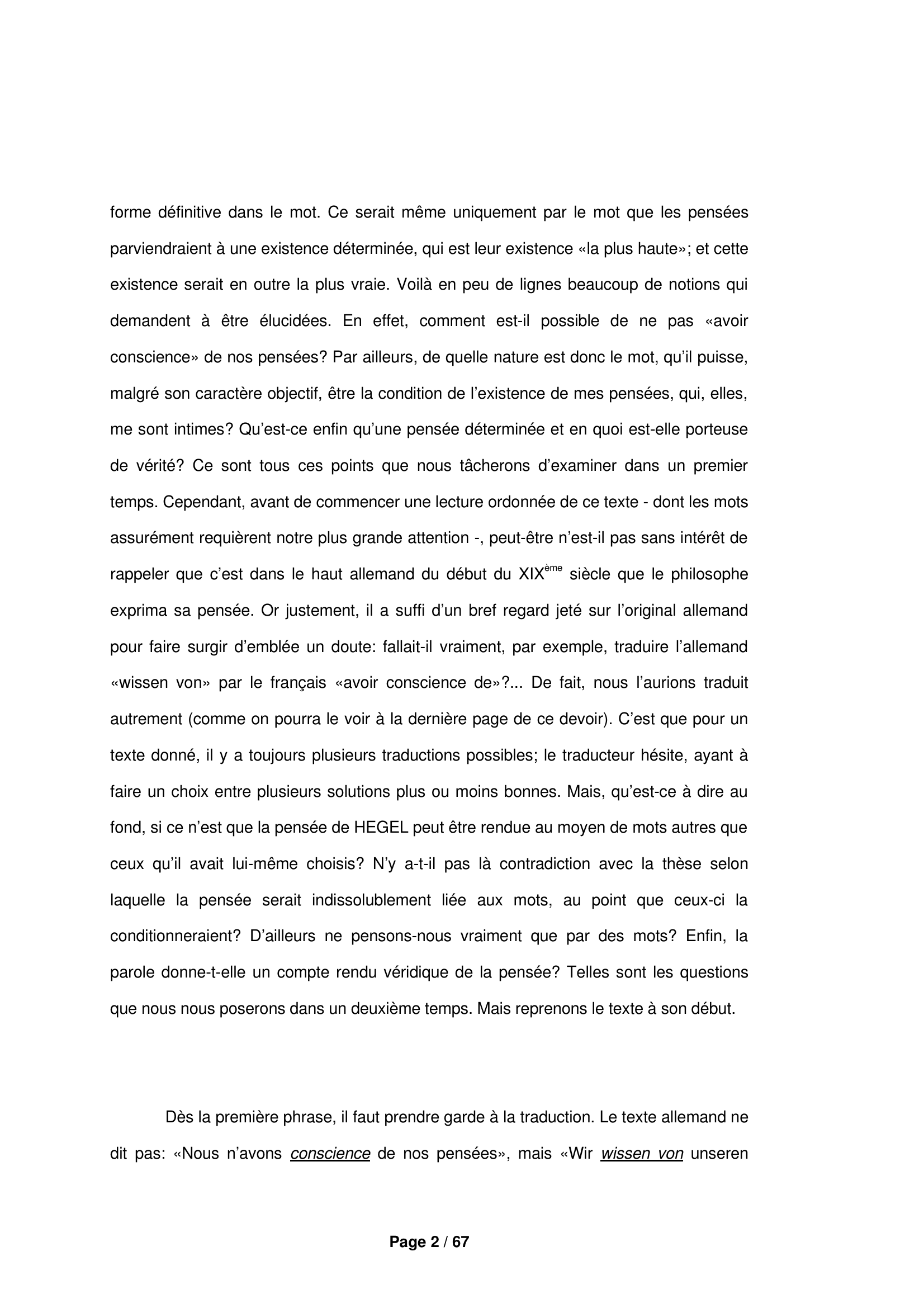janvier 2002 «Nous n'avons conscience de nos pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective, que nous les différencions de notre intériorité, et, par suite, nous les marquons d'une forme externe, mais d'une forme qui contient aussi le caractère de l'activité interne la plus haute. C'est le son articulé, le mot, qui seul nous offre l'existence où l'externe et l'interne sont si intimement unis. Par conséquent, vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée [...] Et il est également absurde de considérer comme un désavantage et comme un défaut de la pensée cette nécessité qui lie celle-ci au mot. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu'il y a de plus haut, c'est l'ineffable. Mais c'est là une opinion superficielle et sans fondement; car, en réalité, l'ineffable, c'est la pensée obscure, la pensée à l'état de fermentation, et qui ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot. Ainsi le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie.» Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques. Philosophie de l'esprit, trad. A. Vera, Félix Alcan, add. § 462, 1807 On trouvera à la dernière page de ce devoir la version originale du texte de Hegel, suivie d'une version, par moi-même corrigée, de sa traduction. Note préliminaire: Étant donné l'importance que donne le sujet même du présent devoir aux mots en tant que tels, il m'a semblé utile de citer textuellement et donc amplement les propos de plusieurs auteurs sur le thème du langage. Quand ces citations ne sont pas en français, je les ai généralement fait suivre d'une traduction de mon cru. Malheureusement, non seulement le devoir s'en trouve allongé d'autant, mais il peut aussi en résulter une certaine gêne pour le lecteur, ce dont je le prie à l'avance de bien vouloir m'excuser. Quelle est la thèse que soutient Hegel dans ce texte? Les pensées, lit-on, ne sauraient accéder à la conscience de celui-là même qui pense, avant d'avoir trouvé leur forme définitive dans le mot. Ce serait même uniquement par le mot que les pensées parviendraient à une existence déterminée, qui est leur existence «la plus haute»; et cette existence serait en outre la plus vraie. Voilà en peu de lignes beaucoup de notions qui demandent à être élucidées. En effet, comment est-il possible de ne pas «avoir conscience» de nos pensées? Par ailleurs, de quelle nature est donc le mot, qu'il puisse, malgré son caractère objectif, être la condition de l'existence de mes pensées, qui, elles, me sont intimes? Qu'est-ce enfin qu'une pensée déterminée et en quoi est-elle porteuse de vérité? Ce sont tous ces points que nous tâcherons d'examiner dans un premier temps. Cependant, avant de commencer une lecture ordonnée de ce texte - dont les mots assurément requièrent notre plus grande attention -, peut-être n'est-il pas sans intérêt de rappeler que c'est dans le haut allemand du début du XIXème siècle que le philosophe exprima sa pensée. Or justement, il a suffi d'un bref regard jeté sur l'original allemand pour faire surgir d'emblée un doute: fallait-il vraiment, par exemple, traduire l'allemand «wissen von» par le français «avoir conscience de»?... De fait, nous l'aurions traduit autrement (comme on pourra le voir à la dernière page de ce devoir). C'est que pour un texte donné, il y a toujours plusieurs traductions possibles; le traducteur hésite, ayant à faire un choix entre plusieurs solutions plus ou moins bonnes. Mais, qu'est-ce à dire au fond, si ce n'est que la pensée de HEGEL peut être rendue au moyen de mots autres que ceux qu'il avait lui-même choisis? N'y a-t-il pas là contradiction avec la thèse selon laquelle la pensée serait indissolublement liée aux mots, au point que ceux-ci la conditionneraient? D'ailleurs ne pensons-nous vraiment que par des mots? Enfin, la parole donne-t-elle un compte rendu véridique de la pensée? Telles sont les questions que nous nous poserons dans un deuxième temps. Mais reprenons le texte à son début. Dès la première phrase, il faut prendre garde à la traduction. Le texte allemand ne dit pas: «Nous n'avons conscience de nos pensées», mais «Wir wissen von unseren Gedanken», c'est-à-dire: nous sommes au fait de nos pensées, nous en sommes instruits, avisés, nous les voyons ou les apercevons. Et être au fait d'une chose, c'est non seulement avoir simplement conscience de cette chose, mais c'est aussi être à même de l'identifier et de l'expliquer, c'est donc proprement la connaître et la reconnaître. De même qu'on ne peut tout bonnement assimiler l'inconscience à l'ignorance, conscience et connaissance sont deux notions à ne pas confondre: la conscience d'une chose n'en implique pas nécessairement la connaissance. La connaissance en effet suppose un point de vue sur un objet, l'ob-jet étant ce qui est «jeté par devant», ce qui tout à la fois s'oppose et se propose, comme le montre de façon encore plus manifeste l'étymologie du mot allemand: le «Gegenstand» est ce qui se tient devant moi «was mir gegenübersteht». On ne connaît que ce qu'on peut poser devant soi pour en faire l'examen. Il y faut un certain recul. Par contre, dans la conscience immédiate que l'on a d'une chose, il n'y a aucun recul. La conscience que l'on a d'une douleur, par exemple, ne se distingue pas de cette douleur elle-même: elle est conscience-douleur. Si je suis tout entier absorbé par ce que je suis en train d'écrire, le début de douleur que je sens dans le dos ou dans la main ne m'apparaît que par la phrase que je suis en train d'écrire, qui me fait soudain l'effet d'être «pénible à écrire». La douleur elle-même en tant que telle n'est pas encore reconnue; je ne m'en suis pas encore avisé. Pourtant, elle ne cesse pas un instant de m'être présente: «[...] elle ne cesse pas un instant de nous être présente; elle s'interpose entre toutes nos manières d'être, et fait même partie essentielle du sentiment actuel que nous avons de notre existence; [...]» (à propos de la sensation de «résistance», MAINE DE BIRAN - INFLUENCE DE L'HABITUDE SUR LA FACULTÉ DE PENSER, en 1799, p. 123). Selon la définition qu'en donne HEGEL dans sa PHILOSOPHIE DES GEISTES (paragraphe 418), la conscience d'une chose est en premier lieu (zunächst) la certitude immédiate (unvermittelte Gewißheit) de cette chose, la simple saisie de cette chose, qui en quelque sorte se confond avec elle: «[...] l'?il se confond avec l'objet [...]»BOSSUET - (Sermons, M.-A. de Beauvais, II). Si bien que, tout entière faite de cette chose, la conscience apparaît riche en contenu, alors qu'elle est pauvre en pensées. (Es erscheint als das reichste an Inhalt, ist aber das ärmste an Gedanken - §418) Et elle est pauvre en pensées, précisément parce que, en l'absence de tout recul, elle ne permet aucun point de vue, aucune prise de position, aucun jugement; bref, elle perçoit sans apercevoir. HEGEL nomme cette conscience «la conscience sensible» (das sinnliche Bewußtsein), laquelle, bien qu'étant aussi certitude immédiate d'elle même (Gewißheit seiner selbst), n'a cependant pas nécessairement connaissance d'elle-même, ne s'étant pas encore elle-même constituée en objet (pour tout à la fois s'opposer et se fondre à cet objet). Ainsi, tant que ma douleur n'en est qu'à l'état de conscience immédiate, bien que je sois tout entier cette douleur, je ne puis rien dire sur elle. Ce n'est qu'à la réflexion et par la réflexion que j'en fais un objet de connaissance, en prenant du recul pour me retourner sur elle et l'examiner comme si elle était une chose en dehors de moi. Et MAINE DE BIRAN d'ajouter (p. 123): «mais si sa continuité la rend très familière et nous en distrait le plus souvent, le moindre retour de l'attention lui rend toute sa clarté [...]» Précisons, pour compléter, que la Bewußtsein qui a connaissance d'elle-même, HEGEL l'appelle la Selbstbewußtsein: «Das Selbstbewußtsein hat das Bewußtsein zu seinem Gegenstande, stellt sich somit demselben gegenüber - § 417 »- La conscience de soi est celle qui a pour objet le fait même d'être conscient, et qui se met pour ainsi dire en face d'elle-même. Cette Selbstbewußtsein ne saurait cependant se suffire tout à fait à elle-même et a besoin d'un autre objet pour se circonscrire: «Mais l'effort suppose deux termes, ou plutôt un sujet et un terme essentiellement relatifs l'un à l'autre; c'est bien toujours le sujet qui est modifié, mais, s'il ne faisait que sentir, il demeurerait identifié avec sa modification, et s'ignorerait lui-même; il ne peut se connaître sans se circonscrire, sans se comparer à son terme; c'est dans ce dernier qu'il se perçoit, qu'il se mire en quelque sorte, c'est donc là qu'il rapportera également tout ce qu'il distingue et compare.» MAINE DE BIRAN (les mots ont été soulignés par nous) (p. 133) À la lumière de cette petite rectification, nous comprenons dès lors que c'est non pour en prendre conscience, mais pour en prendre connaissance que nous objectivons nos pensées, que nous en faisons des objets pour nous, -ou plus exactement, nous dit HEGEL, que nous leur donnons le caractère d'un objet (Gegenständlichkeit), et d'un objet bien distinct de nous-mêmes (Unterschiedensein). Pour y arriver, il nous faut en quelque sorte mettre nos pensées dehors (les «ex-poser»), ou du moins leur prêter la forme (Gestalt) d'un objet. La forme seulement, car ma pensée ne saurait m'être tout à fait comme un objet étranger que j'aurais simplement «trouvé» (gefunden). Au contraire, en s'objectivant, ma pensée m'apparaît d'emblée tout entière comme déjà mienne et connue: prendre connaissance de ma pensée, c'est la reconnaître. Tout compte fait, ma pensée ne m'est extérieure que dans la mesure où j'établis entre elle et moi un rapport, un rapport ne pouvant exister qu'entre objets distincts. Mais ce rapport est d'un type spécial: c'est un rapport intrinsèque qui fait que ma pensée n'existe que dans la mesure où elle se rapporte à moi. (§414 - das Verhältnis [ist] der Widerspruch der Selbständigkeit beider Seiten und ihrer Identität - Tout rapport existant entre deux termes est à la fois la preuve que ces deux termes ne sont pas identiques et la preuve qu'ils ne sauraient être l'un sans l'autre). Il faut donc une extériorité qui n'en soit pas une, un dehors intime (ein innerliches Äußerliches), nous dit HEGEL; et ce dehors intime, affirme-t-il, ne peut être que le son articulé, le mot. HEGEL entend par là que, quand je parle, ma parole m'est tout à la fois objective et subjective. Voire objective d'une façon subjective et objective d'une façon subjective. Qu'est-ce à dire? Laissons-nous guider par HEGEL - en nous aidant des travaux de MAINE DE BIRAN, de ROUSSEAU et de ceux des linguistes du XXème siècle -, et tentons d'examiner cet aspect de la parole. Tout d'abord, il va de soi qu'en «émettant» ou «proférant» une parole, le sujet parlant en fait un objet physique, puisque cette parole se matérialise autour de lui de façon sensible par les vibrations du son, et que le son par sa matérialité s'impose à lui, autrement dit puisqu'il l'entend (encore que ce soit une matérialité bien évanescente et fugace que celle du son, lequel, du fait même de sa propagation, à peine né, s'atténue déjà pour finalement disparaître. «das Sichverbreiten des Tones [ist] ebensosehr sein Verschwinden» (§ 401)). Mais, d'un autre côté, à y «écouter» de plus près, on s'aperçoit que, dans la parole, ce n'est pas exactement le son physique et matériel qu'on entend. Les sons, nous explique MAINE DE BIRAN dans INFLUENCE DE L'HABITUDE SUR LA FACULTÉ DE PENSER (en 1799), «nous les percevons toujours d'autant plus distinctement, qu'ils ont plus de rapport avec ceux que nous pouvons rendre, imiter ou articuler nous-mêmes [...] nous n'entendons bien qu'autant que nous parlons;[...] p. 82» Pour entendre une langue comme l'entendent ceux qui la parlent, il faut d'abord que nous-mêmes nous la parlions et la comprenions. En d'autres termes, nous n'entendons guère que ce à quoi nous sommes préparés; nous n'entendons que pour autant que nous savons par avance ce qu'il y a à entendre. Ou encore: pour entendre ou comprendre un son ou un certain sens, il ne suffit pas de le recevoir, il faut encore l'anticiper: «Il y a de certaines choses qu'on n'entend jamais, quand on ne les entend pas d'abord [...]» MADAME DE SÉVIGNÉ - Lettre du 14 mai 1686 p. 338. De là sans doute le double sens du mot «entendre», qui signifie aussi bien «ouïr» que «comprendre». En jouant sur cette ambiguïté, on peut avancer que le son de la parole ne «se fait entendre» finalement que pour «faire entendre» quelque chose d'autre que lui-même, à savoir le sens de ces paroles, en d'autres termes: ce que ces paroles au juste veulent dire; et ce, à telle enseigne que, si le sens en est clair, la déficience objective d'un son chuchoté, bafouillé ou déformé ne sera la plupart du temps ni identifiée ni même seulement perçue par l'auditeur, comme l'ont prouvé diverses expériences réalisées en laboratoire de phonologie (voir à ce sujet THE CAMBRIDGE ENCYCOPLEDIA OF LANGUAGE; ainsi que ALFRED TOMATIS, L'OREILLE ET LE LANGAGE). C'est du reste cette «double entente» de la parole qui explique que nous ne soyons jamais à même d'apprécier la mélodie de notre propre langue: il n'y a que les langues étrangères qui puissent nous faire l'effet d'une musique ou d'un bruit que nous jugeons agréable ou non. C'est ainsi que peut s'entendre le bon mot de KURT TUCHOLSKY, dans SPRACHE IST EINE WAFFE (Le langage est une arme): «Fremde Sprachen sind schön, wenn man sie nicht versteht» (Les langues étrangères sont belles, quand on ne les comprend pas). Dès lors que nous en avons le sens, nous ne percevons plus le son physique pour lui-même: nos oreilles ne captent jamais le son de notre langue d'une manière objective. Ce que nous percevons dans la parole, c'est bien plutôt ce que MAINE DE BIRAN appela dans son mémoire de 1799 le «son réfléchi intérieur»: «Ainsi, l'individu qui écoute, est lui-même son propre écho, l'oreille se trouve comme frappée instantanément, et du son direct externe, et du son réfléchi intérieur: ces deux empreintes s'ajoutent l'une à l'autre dans l'organe cérébral [...]» (INFLUENCE DE L'HABITUDE SUR LA FACULTÉ DE PENSER, p.82. Un bon siècle plus tard, SAUSSURE, dans son COURS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE, parlera, quant à lui, d'une «image acoustique», laquelle n'est pas «le son matériel, chose purement physique, mais l'empreinte psychique de ce son, la représentation que nous en donne le témoignage de nos sens.». L'extériorité, l'objectivité matérielle de la parole qui se fait entendre se trouve donc en quelque sorte démentie (niée) par le fait que c'est l'intention du sujet parlant qu'on entend (comprend) dans le son que rendent ces paroles. Mais cette subjectivité, à son tour, se trouve comme infirmée par la nature même du mot, lequel doit bien être doué d'une certaine existence objective, puisque, nous dit HEGEL, il est comme une donnée objective qu'il nous faut apprendre: § 457 - «man [muß] die Bedeutung der Zeichen erst lernen» (La signification du signe est d'abord à apprendre). Remarquons que par «Zeichen» (signe) HEGEL semble ici plutôt désigner ce que SAUSSURE, de son côté, nommera «l'image acoustique» ou encore «le signifiant», le signe étant pour SAUSSURE la combinaison du signifiant (image acoustique) et du concept, et le concept lui-même étant le «signifié». En quoi donc l'image acoustique du mot est-elle bien une donnée qu'il nous faut apprendre? SAUSSURE nous donne la réponse: «Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire [...] Ainsi l'idée de «s?ur» n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de sons s-?-r qui lui sert de signifiant; il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quelle autre: à preuve les différences entre les langues et l'existence même de langues différentes [...]» p. 100 Si pour un signifié donné telle image acoustique ne s'impose pas davantage que telle autre, si même toute autre image acoustique aurait aussi bien pu faire l'affaire, si ce qu'on appelle «b?uf» d'un côté de la frontière, est appelé «Ochs» de l'autre, alors je ne peux, de moi-même, connaître ces mots sans les avoir appris. C'est notamment, précise HEGEL, ce qui distingue le signe du symbole, car la forme du symbole, loin d'être indifférente, est au contraire toujours plus ou moins dérivée de la chose que ce symbole représente (par exemple: le rouge symbole du sang, de la violence etc.). Par là, le symbole reste rattaché à mon imagination, au lieu que le mot renvoie d'emblée à une idée générale (concept) sans image: «der Name, indem wir ihn verstehen, ist die bildlose einfache Vorstellung» HEGEL § 462 (dans le temps que nous en saisissons le sens, le nom est une représentation sans image). Qu'est-ce à dire? Que le mot renvoie toujours à une idée générale se conçoit aisément: le mot «arbre», par exemple, ne laisse de renvoyer à un genre, à une catégorie, même quand nous l'appliquons à tel ou tel arbre particulier. Même le sensible et le concret, écrit HEGEL, nous ne pouvons l'exprimer autrement qu'en combinant des idées générales et abstraites: «Als ein Allgemeines sprechen wir auch das Sinnliche aus». Mais pourquoi l'idée générale est-elle sans image? Eh bien, avait déjà répondu ROUSSEAU, parce qu'il est tout simplement impossible de se faire une image du général; nous ne pouvons nous représenter que des choses en particulier: «Essayez de vous tracer l'image d'un arbre en général, jamais vous n'en viendrez à bout, malgré vous il faudra le voir petit ou grand, rare ou touffu, clair ou foncé, et s'il dépendait de vous de n'y voir que ce qui ce trouve en tout arbre, cette image ne ressemblerait plus à un arbre. » - DISCOURS SUR L'ORIGINE ET LES FONDEMENTS DE L'INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES, publié en 1754 - p. 206. L'idée générale est donc bien une représentation sans image, ou pour reprendre plutôt les termes de ROUSSEAU, elle est une représentation «purement intellectuelle». D'où aussi qu'elle n'a pas à dépendre d'une quelconque réalité a priori des choses: «Qu'est-ce au fond que la réalité qu'une idée générale et abstraite a dans notre esprit? Ce n'est qu'un nom, ou, si elle est autre chose, elle cesse nécessairement d'être abstraite et générale.» CONDILLAC - LOGIQUE, V (publié en 1780). En somme, il n'est rien dans le mot, ni son image acoustique ni le concept auquel il renvoie, qui puisse se déduire des choses: «Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique» (SAUSSURE p. 98) - l'un comme l'autre n'ayant «aucune attache naturelle dans la réalité» (SAUSSURE p. 101). Il nous faut l'apprendre entièrement, comme on apprend une donnée objective. Pourtant, d'un autre côté et en retour, tout objectif soit-il, le signe n'a de valeur que pour moi, que pour autant que je lui prête un sens concret dans une situation particulière, sans quoi il ne serait plus qu'une «extériorité» vide de sens, «sinnlose Äußerlichkeiten» nous dit HEGEL(§459). Le mot, pour être compris, est à dépasser; il faut en faire abstraction, y passer outre, si l'on veut pouvoir porter le regard vers la réalité qu'il désigne. Le mot «petit», par exemple ne signifie pas la même chose dans «une petite souris» que dans «un petit éléphant», «petit caporal» ou «petit commerçant». Les mots «je», «ici», «hier» ne peuvent s'interpréter qu'en situation concrète, etc. Nous voilà de retour dans la subjectivité. Il est inutile de poursuivre, les quelques remarques que nous venons de faire étant suffisantes pour nous convaincre du caractère à la fois objectif et subjectif de la parole. À quoi avons-nous abouti? Nous avons vu que pour connaître notre pensée il fallait d'abord ne plus faire corps avec elle, donc en quelque sorte la détacher de nous, la rendre extérieure à nous, tout en maintenant avec elle cependant un rapport intime niant ou contredisant cette extériorité. En outre, nous avons reconnu avec HEGEL que la parole, par son caractère objectivement subjectif et subjectivement objectif, était tout à fait propre à donner aux pensées cette extériorité niée, ce dehors intime. À présent, il nous reste à examiner ce qui fait que le mot constitue, pour HEGEL, le degré d'existence le plus digne et le plus valable (würdigtes) pour nos pensées, et en quoi ce degré serait aussi celui qui contient le plus de vérité (wahrhaftestes). Tout d'abord, qu'est-ce que le plus haut degré de la pensée pour HEGEL? Sur ce point aussi, la PHILOSOPHIE DES GEISTES nous fournit de nombreux indices: le plus haut degré de la pensée, son stade le plus accompli, écrit HEGEL, c'est l'idée GÉNÉRALE ou le «concept» [Begriff] clairement reconnu pour tel. Ce n'est que dans le «concept» que la pensée trouvera sa forme déterminée (bestimmt). Qu'est-ce à dire? Les concepts sont certes déterminés, puisque les mots leur donnent une forme objective. Mais pourquoi faut-il forcément que la pensée s'articule en concepts? C'est que, pour HEGEL, le concept constitue l'intelligibilité même de ma réalité vécue: cet arbre particulier n'existe en fait pour moi que par l'idée générale, le concept [Begriff] d'arbre que j'en ai. Sans ce concept, qui découpe et filtre le réel, mon arbre se fondrait tout bonnement dans un ensemble indifférencié et s'évanouirait pour moi en tant qu'arbre. Le concept est donc ce qui proprement informe ma réalité, tout à la fois en fondant le général et en renseignant le particulier; il est ce par quoi advient la multiplicité des choses et ce qui constitue leur unité propre. Tout ce que je vois, ce que j'entends et ressens, tous les «objets» que je perçois, ne sont en ce sens que les produits de mon intelligence (Intelligenz), qui est comme une grille de lecture du réel. Autrement dit, je n'appréhende le réel que dans la mesure où, dans le sens fort du terme, je le conçois (je l'engendre, je l'enfante): «Das Denken ist das Sein» - L'être, c'est de la pensée, lit-on dans le §465. Penser, ce serait donc nécessairement conceptualiser, dresser une nomenclature, poser des termes. Au surplus, il convient de distinguer, nous dit HEGEL, si nous ne faisons que concevoir le réel ou si, par surcroît, nous nous voyons le concevant, autrement dit, si le concept, qui est notre création, est reconnu pour être tel. Ou encore, pour citer NIETZSCHE (DIE FRÖHLICHE WISSENSCHAFT / LE GAI SAVOIR §301), si oui ou non, nous nous sommes débarrassés de «cette duperie de l'esprit» («Wahn») qui nous fait croire que nous ne serions que spectateurs et auditeurs de la vie, alors que nous en sommes proprement les artisans, les auteurs et les continuateurs ([...] er meint, als Zuschauer und Zuhörer vor das grosse Schau- und Tonspiel gestellt zu sein, welches das Leben ist: er [...] übersieht dabei, dass er selber der eigentliche Dichter und Fortdichter des Lebens ist). Ce n'est, selon HEGEL, que dans le cas où nous nous voyons, où nous nous connaissons concevant, que le concept trouvera son plein achèvement. À ce stade, l'intelligence sait que le réel ne prend forme que dans le concept: §465 «[Die Intelligenz] weiß daß, was ist, nur ist, insofern es Gedanken ist» (L'intelligence sait que ce qui est, n'est, ne peut prétendre être, que pour autant qu'on le pense). Or, comme on l'a déjà vu, il ne saurait y avoir de connaissance sans recul, sans objet de connaissance; et n'est-ce pas le mot, qui en prêtant son extériorité objective au concept, peut le mieux permettre ce recul et fournir l'objet nécessaire? Ainsi, pour HEGEL, penser c'est conceptualiser, et conceptualiser, c'est nommer et dénommer. «§462 Es ist in Namen, daß wir denken» écrit HEGEL (C'est par les noms que nous pensons). Mais il y a plus: car la pensée, en se coulant dans le mot, non seulement parvient à son meilleur degré de détermination et d'achèvement, mais encore elle se met en état de saisir la «vérité» des choses (§467 imstande, die Wahrheit der Dinge zu erfassen) Et ce, pour cette raison qu'on n'appréhende la «vérité» d'une chose particulière, nous dit HEGEL, qu'en en dégageant le caractère général (Das Tiefste ist auch das Allgemeine - Le plus profond est aussi le général - HEGEL in REDE BEIM ANTRITT AN DER UNIVERSITÄT BERLIN). En effet, on ne peut prétendre appréhender la «vérité» d'une chose - c'est-à-dire dans ce qu'elle a pour moi de permanent, d'essentiel, de caractéristique - qu'en faisant abstraction de sa variation dans le temps comme de sa contingence; d'où que c'est bien le concept, à la fois général et abstrait, qui est riche en vérité (§396 : Die Sprache aber befähigt den Menschen, die Dinge als allgemeine aufzufassen - C'est le langage qui nous rend capable d'appréhender les choses dans leur généralité). Pour illustrer cette conception de la vérité, recourons à un exemple, celui de la linguistique. Celle-ci a pour objet d'étude le langage, et non nécessairement les langues elles-mêmes: il n'est pas en effet absolument nécessaire d'apprendre des langues pour faire de la linguistique, ou du moins, de les apprendre toutes. Or le langage n'a bien sûr d'autre réalité concrète dans le monde que les langues elles-mêmes qui y sont parlées, diverses et particulières; car savoir parler, c'est forcément savoir parler une certaine langue en particulier. En même temps, d'un autre côté, sans cette notion générale de langage, nous ne saurions appréhender ce qui fait qu'une langue est une langue: «Si l'on veut découvrir la véritable nature de la langue, il faut la prendre d'abord dans ce qu'elle a de commun avec tous les autres systèmes du même ordre [...]» SAUSSURE p. 35 (Introduction). Vouloir saisir le langage, c'est en effet tenter d'établir s'il est possible, à partir des traits particuliers et contingents de telles ou telles langues, de dégager des règles générales et abstraites, des «lois» pouvant s'appliquer à toutes les langues. «Ainsi, quand on veut montrer une chose générale, il faut en donner la règle particulière d'un cas; mais si on veut montrer un cas particulier, il faudra commencer par la règle générale» BLAISE PASCAL - Pensées (n°40, p. 82). En ce sens, le langage désignerait l'essence et la vérité des langues, étant entendu toutefois que c'est une essence choisie par nous et une vérité qui ne vaut que pour nous. Car le monde n'a pas de significations préalables qui ne seraient plus pour nous qu'à déchiffrer. Si le monde nous paraît lisible, ce n'est que d'après une grille de lecture dont nous nous dotons nous-mêmes. Ou plutôt, notre lecture n'est autre au fond que cette grille de lecture, que notre grille de lecture à nous. Ainsi, pour en revenir à l'exemple de l'arbre, la «vérité» pour nous de cet arbre-ci n'est autre que l'idée générale que nous nous faisons de tout arbre, «vérité» qui n'a en retour d'autre «réalité» pour nous que les choses en particulier que nous voulons bien désigner par ce terme d'arbre. Il s'ensuit que la pensée, comme on l'a déjà marqué pour le mot, ne doit rien a priori au monde, puisque la réalité des choses pensées ne dépend que de la «vérité» que nous leur donnons, autrement dit, de leurs concepts (de la conception que nous nous en faisons), qui sont «purement intellectuels». La pensée n'entretient donc qu'un rapport parfaitement libre avec son objet: «§467 - Somit steht das Denken hier zum Objekt in einem vollkommen freien Verhältnisse.»; en quelque sorte, la pensée se soutient elle-même par le rapport qu'elle entretient avec elle-même. C'est ce que HEGEL appelle «la pensée raisonnée» (vernünftiges Denken), qui est une pensée pure (reines Denken), où il ne se mêle aucune sensation, ni, en dernière instance, plus aucune subjectivité - ma personne (le «je») ne se définissant que par opposition aux autres personnes (autrui), que je définis en les nommant (en les concevant donc) et qui me définissent en me nommant (en me concevant); subjectivités se soutenant les unes les autres, sans autre appui qu'elles-mêmes, et par là même s'annihilant en tant que telles, mais pour passer à un degré supérieur, autrement dit: «sie heben sich auf» (où «aufheben» signifierait tout à la fois: abolir, neutraliser, annuler, compenser, conserver, élever, relever...); c'est donc, en dernier lieu, une pensée purement conceptuelle, qui s'épanouit librement en elle-même et par elle-même: «ein Denken, in das sich nichts - das Sinnliche, Gemeinte, Subjektive - einmischt, sondern das frei und nur bei sich selbst entwickelt». Voilà pourquoi, selon HEGEL, le mot, en tant qu'il est la forme concrète du concept, est non seulement le plus haut degré de la pensée mais aussi le plus «vrai». * * * Nous voilà enfin arrivé au bout de la démonstration de HEGEL. Il est temps à présent de récapituler: «Das Wort gibt demnach den Gedanken ihr würdigstes und wahrhaftestes Dasein.», c'est la parole, donc, voire peut-être le mot, qui donnerait aux pensées leur existence la plus digne et la plus véritable. Mais, avons-nous vu, c'est parce que la pensée serait précisément faite de concepts prenant forme par le mot. N'y a-t-il pas là comme un cercle? Ne semble-t-il pas finalement que l'affirmation de HEGEL soit vraie «par définition»? Car enfin, si on a pris soin au départ de ne voir dans la pensée qu'un système de concepts déterminés, et que l'on pose ensuite qu'un concept n'est déterminé que dans la mesure où il fait corps avec un mot, alors en effet, il n'est pas surprenant que pensée et parole soient indissolublement liées, à tel point même que l'une ne pourrait être imaginée sans l'autre: «penser sans les mots, c'est une tentative insensée... » Ce qui ne peut être exprimé par des mots (das Unaussprechliche, l'ineffable), selon HEGEL, ne serait qu'une chose indéfinie, une chose en fermentation, sans clarté. Le fameux vers de BOILEAU «Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement» (L'ART POÉTIQUE) ne serait alors qu'une vaine tautologie, concevoir et énoncer n'étant alors que les deux faces d'une même chose. Mais le sens d'un énoncé peut-il vraiment se déduire entièrement et uniquement des mots qui le composent? Le traducteur a-t-il d'ailleurs eu bien raison de rendre l'allemand «Wort» par le français «mot»? C'est que «Wort» est très polysémique, et, selon les contextes, peut signifier aussi bien «mot», que «propos», «énoncé», «parole»... Et selon qu'on l'entende au sens de «parole» ou de «mot», par exemple, la question qui se pose est tout autre. Dans le premier cas, la pensée serait certes nécessairement liée à la parole en général, à l'existence d'un langage articulé, mais quelle que soit par ailleurs la langue utilisée. Dans le second cas, la pensée serait bel et bien liée à la langue particulière dans laquelle elle s'exprime, ce qui finalement reviendrait à dire que telle pensée exprimée en telle langue serait incommunicable en toute autre langue. Nous commencerons par examiner la seconde de ces deux hypothèses: «§462 Es ist in Namen, daß wir denken» écrit HEGEL, c'est par les «noms» donc que nous penserions. Mais en affirmant pareille proposition, n'admettons-nous pas du même coup que la pensée serait a priori limitée par le lexique ou la structure de la langue dans laquelle elle s'exprime? Plus encore: ne faudrait-il pas croire, dans ces conditions, qu'il suffirait de changer de langue pour changer de pensée? Bref, notre pensée serait-elle en quelque sorte prisonnière de notre langue ou comme enchaînée à elle? Dans les paragraphes suivants, nous aimerions à cette thèse opposer deux points de vues: d'abord celui du traducteur, puis celui que nous appellerons, par commodité, le point de vue du «psychologue». Dans l'exposé que nous ferons du «point de vue du traducteur», nous tenterons de montrer que le travail même de la traduction contredit l'affirmation de HEGEL; que, pour rendre le sens d'un énoncé on ne peut se contenter de traduire isolément chaque mot le composant; enfin que, contrairement aux hypothèses de BENJAMIN LEE WHORF, les mots et les catégories grammaticales, loin de mettre des bornes à la pensée ou à son expression, sont plutôt comme des panneaux de signalisation qui indiquent le chemin suivi par la pensée sans jamais limiter celle-ci; que, si limites il y a, elles ne sont pas linguistiques, mais simplement humaines; et que, par voie de conséquence, il n'y a aucune idée ou conception, pour peu qu'elle ait été exprimée dans une langue, qui ne puisse être exprimée dans une autre langue. Puis, dans les paragraphes consacrés au point de vue du «psychologue», partant d'un texte de FICHTE, que nous citerons amplement tout en le commentant, nous verrons que les mots comme les langues font communément l'objet de toutes sortes d'appréciations et de jugements de valeurs visant notamment à établir des hiérarchies entre les langues, voire à leur attribuer une sorte de quotient intellectuel qui limiterait a priori leur capacité d'expression. Nous essaierons d'expliquer pourquoi ces classements ne nous paraissent pas recevables et en quoi même ils sont dangereux. Finalement nous tâcherons de faire voir que ces jugements reposent en fait sur des conceptions fausses, quoique répandues, qui prêtent aux langues une existence propre et un pouvoir autonome qu'elles n'ont pas. Voyons donc, pour commencer, le point de vue du traducteur. Pour un traducteur, croyons-nous, il ne peut y avoir, entre pensées et mots, ni identité, ni lien de nécessité. Car enfin, s'il en était ainsi que pensées et mots ne fussent que les deux faces d'une seule et même chose, comment comprendre le long travail de la traduction qui consiste, dans un premier temps, à dégager entièrement le sens du texte de départ, autrement dit à abstraire de la forme donnée (en contexte) un certain sens pour, dans un deuxième temps, rendre ce sens sous une forme nouvelle (dans un autre contexte); et ce, non sans avoir d'abord essayé tour à tour diverses combinaisons de mots, plusieurs tournures et plusieurs tours de phrase, choisissant ainsi, selon le contexte, selon l'effet à obtenir, parmi plusieurs moyens possibles, ceux qui conviendront le mieux? Comment expliquer qu'on ait ce choix, qu'il y ait seulement la possibilité d'un choix entre plusieurs mots ou tournures etc. pour traduire ou reproduire l'intention de l'auteur, et, de manière générale, qu'on puisse reformuler sa pensée par d'autres mots? D'où viendrait que nous sentons parfois, non sans frustration, que nos mots ne rendent que bien imparfaitement notre pensée? «Mann kann auch seine Gedanken nicht ganz in Worten wiedergeben.» (Même ses propres pensées, on ne peut tout à fait les rendre par des paroles.) FRIEDRICH NIETZSCHE - DIE FRÖHLICHE WISSENSCHAFT (244 - Gedanken und Worte) -p. 514. D'où viendrait le sentiment de décalage qu'il nous arrive d'éprouver entre ce que nous sentons et ce que nous exprimons: «Que ne puis-je t'exprimer ce que je sens si bien! et comment sens-je si bien ce que je ne puis t'exprimer?» MONTESQUIEU - Lettres persanes - Lettre VII p. 18; ou au contraire le sentiment qui nous saisit, en certaines occasions, d'une adéquation parfaite avec notre pensée, mais à retardement, comme lorsque dans les mots de tel grand écrivain nous reconnaissons soudain une pensée que nous avons eue mais que nous n'aurions jamais su nous-même si bien formuler? Enfin change-t-on de pensée pour l'exprimer dans une autre langue? Après tout, le texte de HEGEL n'a-t-il pas été traduit dans d'autres langues? - il est vrai, plus ou moins bien. La question qui se pose alors est de savoir si le degré de réussite d'une traduction dépend uniquement de la compétence du traducteur, ou bien si ce degré de réussite est de toute façon et a priori conditionné par la nature de la langue de départ et de celle d'arrivée. C'est cette dernière hypothèse que BENJAMIN LEE WHORF, en 1956, dans «LANGUAGE, THOUGHT and REALITY», voulut démontrer: pour lui, la pensée était à ce point solidaire des mots et des structures de la langue utilisée, que toute tentative pour exprimer cette pens&eacu...