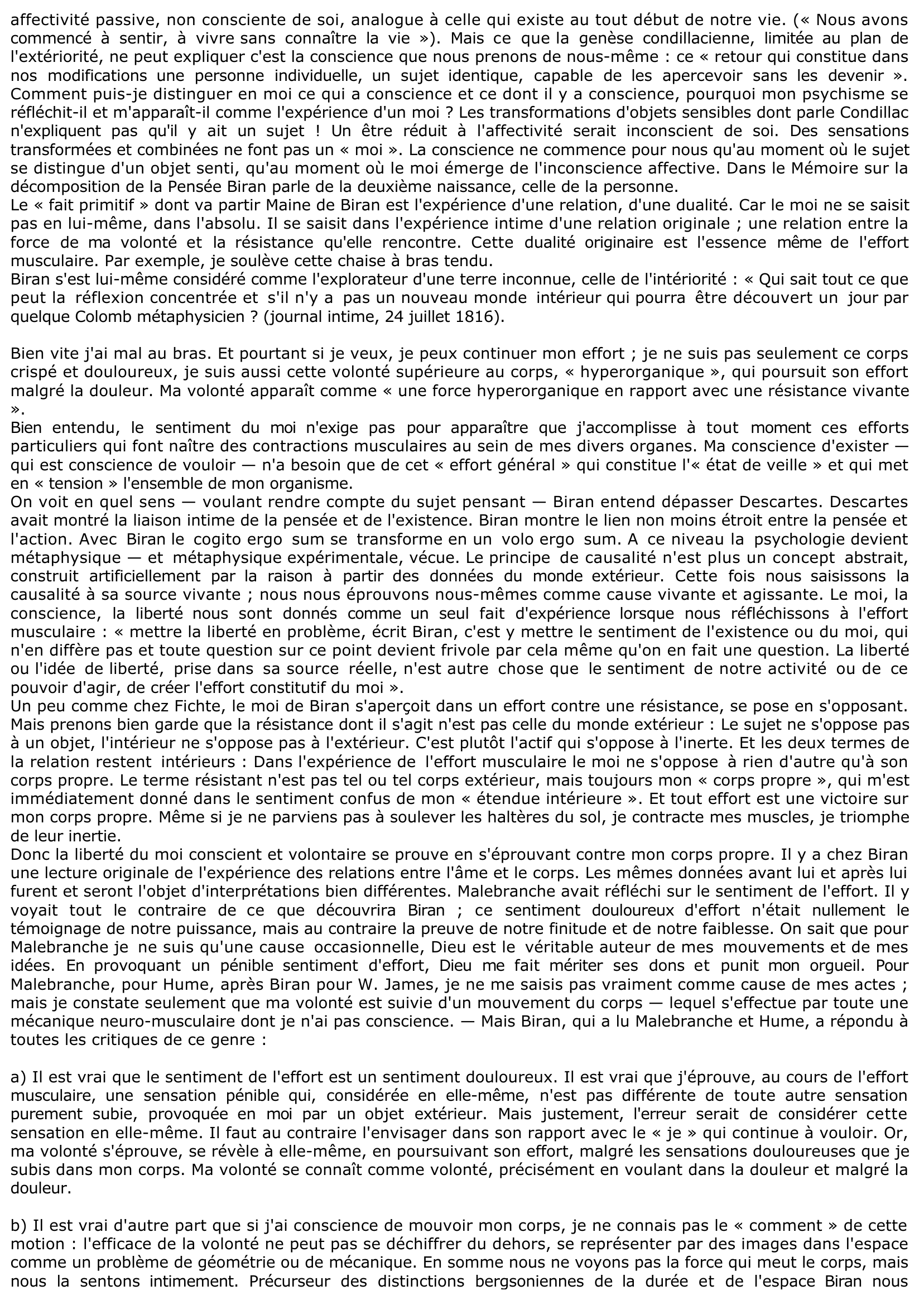La philosophie de Maine de Biran
Publié le 23/12/2009

Extrait du document

xxx ?
Bien qu'il ait été sous l'Empire sous-préfet de Bergerac, puis sous la Restauration, constamment député de Bergerac, (sauf en 1816 où un « ultra « lui prit son siège) Maine de Biran n'est aucunement, comme les auteurs dont nous avons parlé précédemment, un penseur de la Restauration. Il reste beaucoup plus qu'on ne le dit d'ordinaire un homme du XVIIIe siècle, ayant appris à penser dans les ouvrages de Condillac, de Destutt de Tracy, à sentir dans ceux de J.-J. Rousseau. En 1820 il est encore franc-maçon, assidu aux réunions de la loge de Bergerac. Il est préoccupé de philanthropie active, d'instruction publique élémentaire, de nouveautés pédagogiques (il écrira personnellement à Pestalozzi pour avoir un de ses élèves comme instituteur primaire). Le spiritualisme qu'il défendra contre les idéologues obéit à de toutes autres exigences qu'à la protection de l'ordre social. Certes devant le lit de mort de sa soeur, Biran renonce à l'agnosticisme religieux de sa jeunesse. Il éprouve le besoin irrésistible d'une consolation qui, comme le dit très bien Gouhier, « répond à une exigence existentielle et non à une exigence morale «. Dieu n'est pas pour lui essentiellement (comme il fut pour Rousseau lui-même), le garant de l'ordre moral; (« je puis affirmer, écrit-il dans sa jeunesse, dans toute la sincérité de mon coeur qu'il ne m'arrive jamais de penser à Dieu lorsque je fais le bien et que je déteste le vice «).

«
affectivité passive, non consciente de soi, analogue à celle qui existe au tout début de notre vie.
(« Nous avonscommencé à sentir, à vivre sans connaître la vie »).
Mais ce que la genèse condillacienne, limitée au plan del'extériorité, ne peut expliquer c'est la conscience que nous prenons de nous-même : ce « retour qui constitue dansnos modifications une personne individuelle, un sujet identique, capable de les apercevoir sans les devenir ».Comment puis-je distinguer en moi ce qui a conscience et ce dont il y a conscience, pourquoi mon psychisme seréfléchit-il et m'apparaît-il comme l'expérience d'un moi ? Les transformations d'objets sensibles dont parle Condillacn'expliquent pas qu'il y ait un sujet ! Un être réduit à l'affectivité serait inconscient de soi.
Des sensationstransformées et combinées ne font pas un « moi ».
La conscience ne commence pour nous qu'au moment où le sujetse distingue d'un objet senti, qu'au moment où le moi émerge de l'inconscience affective.
Dans le Mémoire sur ladécomposition de la Pensée Biran parle de la deuxième naissance, celle de la personne.Le « fait primitif » dont va partir Maine de Biran est l'expérience d'une relation, d'une dualité.
Car le moi ne se saisitpas en lui-même, dans l'absolu.
Il se saisit dans l'expérience intime d'une relation originale ; une relation entre laforce de ma volonté et la résistance qu'elle rencontre.
Cette dualité originaire est l'essence même de l'effortmusculaire.
Par exemple, je soulève cette chaise à bras tendu.Biran s'est lui-même considéré comme l'explorateur d'une terre inconnue, celle de l'intériorité : « Qui sait tout ce quepeut la réflexion concentrée et s'il n'y a pas un nouveau monde intérieur qui pourra être découvert un jour parquelque Colomb métaphysicien ? (journal intime, 24 juillet 1816).
Bien vite j'ai mal au bras.
Et pourtant si je veux, je peux continuer mon effort ; je ne suis pas seulement ce corpscrispé et douloureux, je suis aussi cette volonté supérieure au corps, « hyperorganique », qui poursuit son effortmalgré la douleur.
Ma volonté apparaît comme « une force hyperorganique en rapport avec une résistance vivante».Bien entendu, le sentiment du moi n'exige pas pour apparaître que j'accomplisse à tout moment ces effortsparticuliers qui font naître des contractions musculaires au sein de mes divers organes.
Ma conscience d'exister —qui est conscience de vouloir — n'a besoin que de cet « effort général » qui constitue l'« état de veille » et qui meten « tension » l'ensemble de mon organisme.On voit en quel sens — voulant rendre compte du sujet pensant — Biran entend dépasser Descartes.
Descartesavait montré la liaison intime de la pensée et de l'existence.
Biran montre le lien non moins étroit entre la pensée etl'action.
Avec Biran le cogito ergo sum se transforme en un volo ergo sum.
A ce niveau la psychologie devientmétaphysique — et métaphysique expérimentale, vécue.
Le principe de causalité n'est plus un concept abstrait,construit artificiellement par la raison à partir des données du monde extérieur.
Cette fois nous saisissons lacausalité à sa source vivante ; nous nous éprouvons nous-mêmes comme cause vivante et agissante.
Le moi, laconscience, la liberté nous sont donnés comme un seul fait d'expérience lorsque nous réfléchissons à l'effortmusculaire : « mettre la liberté en problème, écrit Biran, c'est y mettre le sentiment de l'existence ou du moi, quin'en diffère pas et toute question sur ce point devient frivole par cela même qu'on en fait une question.
La libertéou l'idée de liberté, prise dans sa source réelle, n'est autre chose que le sentiment de notre activité ou de cepouvoir d'agir, de créer l'effort constitutif du moi ».Un peu comme chez Fichte, le moi de Biran s'aperçoit dans un effort contre une résistance, se pose en s'opposant.Mais prenons bien garde que la résistance dont il s'agit n'est pas celle du monde extérieur : Le sujet ne s'oppose pasà un objet, l'intérieur ne s'oppose pas à l'extérieur.
C'est plutôt l'actif qui s'oppose à l'inerte.
Et les deux termes dela relation restent intérieurs : Dans l'expérience de l'effort musculaire le moi ne s'oppose à rien d'autre qu'à soncorps propre.
Le terme résistant n'est pas tel ou tel corps extérieur, mais toujours mon « corps propre », qui m'estimmédiatement donné dans le sentiment confus de mon « étendue intérieure ».
Et tout effort est une victoire surmon corps propre.
Même si je ne parviens pas à soulever les haltères du sol, je contracte mes muscles, je triomphede leur inertie.Donc la liberté du moi conscient et volontaire se prouve en s'éprouvant contre mon corps propre.
Il y a chez Biranune lecture originale de l'expérience des relations entre l'âme et le corps.
Les mêmes données avant lui et après luifurent et seront l'objet d'interprétations bien différentes.
Malebranche avait réfléchi sur le sentiment de l'effort.
Il yvoyait tout le contraire de ce que découvrira Biran ; ce sentiment douloureux d'effort n'était nullement letémoignage de notre puissance, mais au contraire la preuve de notre finitude et de notre faiblesse.
On sait que pourMalebranche je ne suis qu'une cause occasionnelle, Dieu est le véritable auteur de mes mouvements et de mesidées.
En provoquant un pénible sentiment d'effort, Dieu me fait mériter ses dons et punit mon orgueil.
PourMalebranche, pour Hume, après Biran pour W.
James, je ne me saisis pas vraiment comme cause de mes actes ;mais je constate seulement que ma volonté est suivie d'un mouvement du corps — lequel s'effectue par toute unemécanique neuro-musculaire dont je n'ai pas conscience.
— Mais Biran, qui a lu Malebranche et Hume, a répondu àtoutes les critiques de ce genre :
a) Il est vrai que le sentiment de l'effort est un sentiment douloureux.
Il est vrai que j'éprouve, au cours de l'effortmusculaire, une sensation pénible qui, considérée en elle-même, n'est pas différente de toute autre sensationpurement subie, provoquée en moi par un objet extérieur.
Mais justement, l'erreur serait de considérer cettesensation en elle-même.
Il faut au contraire l'envisager dans son rapport avec le « je » qui continue à vouloir.
Or,ma volonté s'éprouve, se révèle à elle-même, en poursuivant son effort, malgré les sensations douloureuses que jesubis dans mon corps.
Ma volonté se connaît comme volonté, précisément en voulant dans la douleur et malgré ladouleur.
b) Il est vrai d'autre part que si j'ai conscience de mouvoir mon corps, je ne connais pas le « comment » de cettemotion : l'efficace de la volonté ne peut pas se déchiffrer du dehors, se représenter par des images dans l'espacecomme un problème de géométrie ou de mécanique.
En somme nous ne voyons pas la force qui meut le corps, maisnous la sentons intimement.
Précurseur des distinctions bergsoniennes de la durée et de l'espace Biran nous.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Maine de Biran - philosophie.
- Maine de Biran (1766-1824) - Résumé de sa philosophie
- INFLUENCE DE L’HABITUDE SUR LA FACULTÉ DE PENSER ou MÉMOIRE SUR L’HABITUDE, 1802. Maine de Biran
- ESSAI SUR LES FONDEMENTS DE LA PSYCHOLOGIE ET SUR SES RAPPORTS AVEC L’ÉTUDE DE LA NATURE, Maine de Biran
- Maine de Biran: ESSAI SUR LES FONDEMENTS DE LA PSYCHOLOGIE ET SUR SES RAPPORTS AVEC L’ÉTUDE DE LA NATURE.