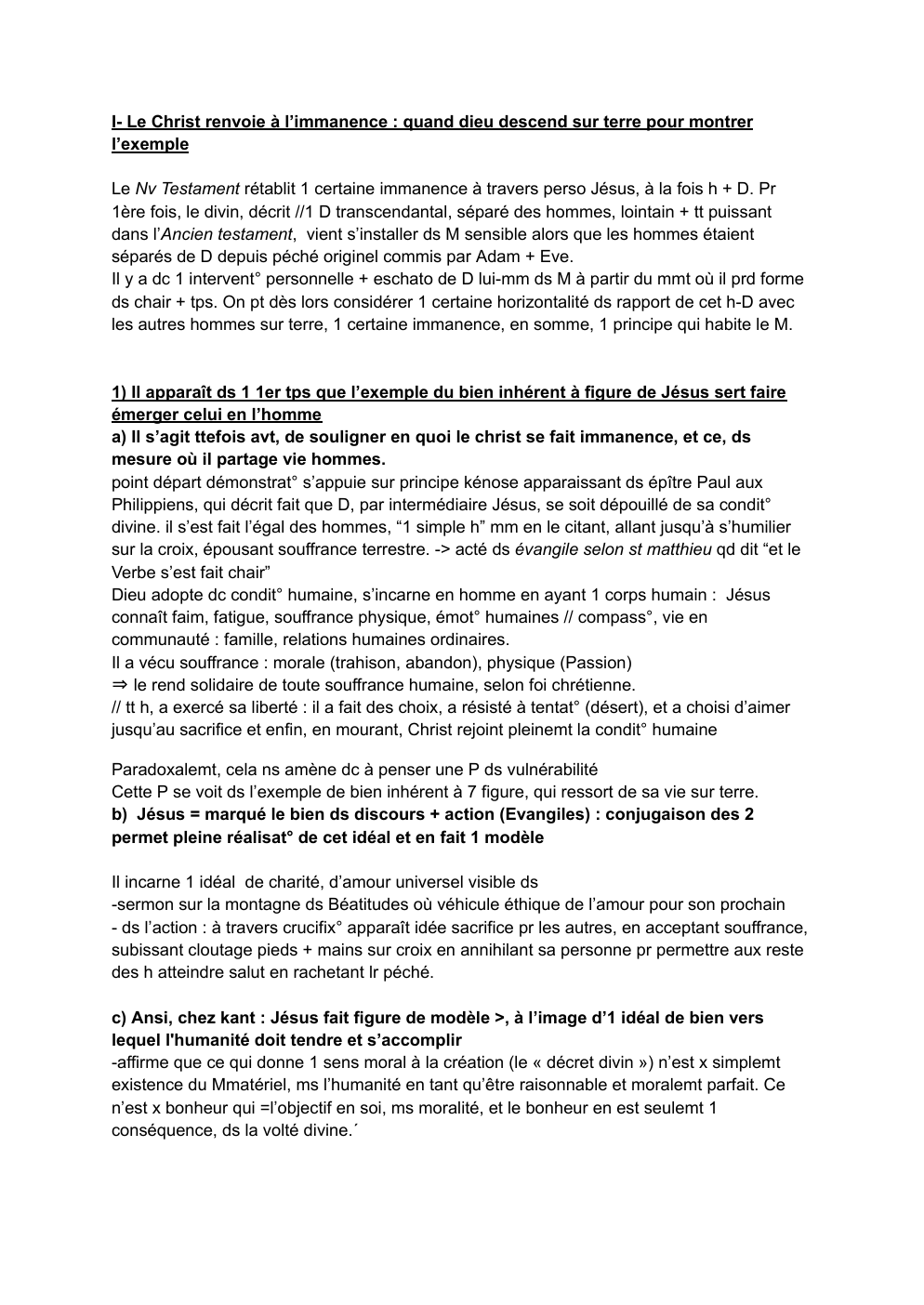Le Christ
Publié le 07/09/2025
Extrait du document
«
I- Le Christ renvoie à l’immanence : quand dieu descend sur terre pour montrer
l’exemple
Le Nv Testament rétablit 1 certaine immanence à travers perso Jésus, à la fois h + D.
Pr
1ère fois, le divin, décrit //1 D transcendantal, séparé des hommes, lointain + tt puissant
dans l’Ancien testament, vient s’installer ds M sensible alors que les hommes étaient
séparés de D depuis péché originel commis par Adam + Eve.
Il y a dc 1 intervent° personnelle + eschato de D lui-mm ds M à partir du mmt où il prd forme
ds chair + tps.
On pt dès lors considérer 1 certaine horizontalité ds rapport de cet h-D avec
les autres hommes sur terre, 1 certaine immanence, en somme, 1 principe qui habite le M.
1) Il apparaît ds 1 1er tps que l’exemple du bien inhérent à figure de Jésus sert faire
émerger celui en l’homme
a) Il s’agit ttefois avt, de souligner en quoi le christ se fait immanence, et ce, ds
mesure où il partage vie hommes.
point départ démonstrat° s’appuie sur principe kénose apparaissant ds épître Paul aux
Philippiens, qui décrit fait que D, par intermédiaire Jésus, se soit dépouillé de sa condit°
divine.
il s’est fait l’égal des hommes, “1 simple h” mm en le citant, allant jusqu’à s’humilier
sur la croix, épousant souffrance terrestre.
-> acté ds évangile selon st matthieu qd dit “et le
Verbe s’est fait chair”
Dieu adopte dc condit° humaine, s’incarne en homme en ayant 1 corps humain : Jésus
connaît faim, fatigue, souffrance physique, émot° humaines // compass°, vie en
communauté : famille, relations humaines ordinaires.
Il a vécu souffrance : morale (trahison, abandon), physique (Passion)
⇒ le rend solidaire de toute souffrance humaine, selon foi chrétienne.
// tt h, a exercé sa liberté : il a fait des choix, a résisté à tentat° (désert), et a choisi d’aimer
jusqu’au sacrifice et enfin, en mourant, Christ rejoint pleinemt la condit° humaine
Paradoxalemt, cela ns amène dc à penser une P ds vulnérabilité
Cette P se voit ds l’exemple de bien inhérent à 7 figure, qui ressort de sa vie sur terre.
b) Jésus = marqué le bien ds discours + action (Evangiles) : conjugaison des 2
permet pleine réalisat° de cet idéal et en fait 1 modèle
Il incarne 1 idéal de charité, d’amour universel visible ds
-sermon sur la montagne ds Béatitudes où véhicule éthique de l’amour pour son prochain
- ds l’action : à travers crucifix° apparaît idée sacrifice pr les autres, en acceptant souffrance,
subissant cloutage pieds + mains sur croix en annihilant sa personne pr permettre aux reste
des h atteindre salut en rachetant lr péché.
c) Ansi, chez kant : Jésus fait figure de modèle >, à l’image d’1 idéal de bien vers
lequel l'humanité doit tendre et s’accomplir
-affirme que ce qui donne 1 sens moral à la création (le « décret divin ») n’est x simplemt
existence du Mmatériel, ms l’humanité en tant qu’être raisonnable et moralemt parfait.
Ce
n’est x bonheur qui =l’objectif en soi, ms moralité, et le bonheur en est seulemt 1
conséquence, ds la volté divine.´
Il est si moral que K va jusqu’à parler du “Fils de Dieu” nn // 1 pers réelle ou 1 créature, ms
// idée morale idéale, l’image parfaite de l’humanité morale.
Cette idée est éternelle, elle sort
directement de la raison divine.
Dès lors, le C doit ê pris // modèle de l’élévat° morale en tant que devoir pr les h
ns avons devoir de tendre vers 7 idéal moral.
7 idée de perfect° morale= inscrite en ns par la
raison, L ne vient x de ns, ms L = présente en ns.
Et // ns ne comprenons x commt 1 tel idéal
est en ns malgré notre nature imparfaite, ns en parlons comme s’il était “descendu du ciel”,
càd // 1 don moral mystérieux.
Et K distingue Christ de la condit° humaine classique, // ex particulier : l’homme, pécheur,
mérite ses souffrances, tandis que l’idéal, l’h qu’est le Christ symbolique, souffre sans y être
obligé, par pure moralité : accepte de descendre vers humanité imparfaite, de prdre sur lui
souffrances du M, nn x pr racheter magiquemt nos fautes, ms // ex suprême de sacrifice +
pureté morale
Le C semble dc exister // 1 exemple devant servir à faire émerger bien chez h.
2) Si vie du Christ, dc de Dieu ss forme d’h, apparait ss le jour d’1 exemple faisant
ressortir et permettant multiplier certains aspects de ses semblables // l’amour, la
passion, elle révèle 1 caractère inhérent aux hommes : lr violence .
En eff, grâce à 7 immanence, 7 violence se dessine selon 1 logique de bouc émissaire.
Ds
Les choses cachées depuis la fondation du monde, René Girard.
Avt de parler du bouc émissaire, Girard commence par une analyse du désir humain : il n’est
pas autonome mais mimétique.
Nous désirons ce que les autres désirent, en les imitant.
Cela crée inévitablement de la rivalité, car plusieurs individus désirent la même chose.
Ce
désir mimétique engendre des conflits au sein du groupe.
Lorsque tout le groupe est pris ds
rivalités croissantes, violence devient incontrôlable.
Pr mettre fin violence collective, la sté
primitive désigne 1 coupable unique, svt innocent, sur qui elle projette toutes les tensions.
● En tuant ou en excluant ce bouc émissaire, la sté retrouve forme de paix.
● Ce processus = inconscient : commu croit réellemt que mort ou l’expulsion de cet
individu a résolu le problème.
● Ce mécanisme est à la base de nombreuses mythologies anciennes, où la victime
est divinisée après coup (le roi sacrifié, le héros martyr, etc.) et où la violence
collective reste invisible, dissimulée par 1 récit mensonger.
Ms, contrairemt aux mythes qui cachent innocence victime, Évangiles révèlent qu’il est
innocent + masquent x lynchage
● récit Passion montre processus d’exclus° : Jésus est rejeté par foule, jugé
injustement, tué.
● 7 fois, texte prd parti victime en montrant que Jésus = scandaleusemt sacrifié ss
raison.
Christ = ainsi l’ex qui permet révéler mécanisme bouc émissaire qu’on retrouve de manière
systémique ds stés humaines.
La valeur d’ex, de modèle que recouvre Christ + qui justifie en partie descente D sur terre,
en demeurant ds champs immanence = marquée par le (3) carac éphémère de D en
Jésus.
Et l’ex pt dès lors ê critiqué par sa valeur unique et ephémère.
De fait ce n’est
qu’un ex, il échappe à la loi commune et par son caractère d’immanence laisse les
hommes seuls sur terre, sans guide, par opposition à l’étoile qui guide le berger.
Jésus en ce qu’il se caractérise par immanence constitue 1 ex particulier pcq il ne se
manifeste qu’1 seule foi, il est 1 temporalité limité à 1 30taine d’années qui ensuite
s’évanouit du M matériel.
C’est ce qu’illustre légende grd inquisiteur ds les frères
Karamazov.
Ds roman, passage = raconté par Ivan Karamazov, fr intellectuel, sceptique et
tourmenté.
Il l’adresse à Aliocha, son fr moine, profondémt croyant.
Ivan imagine que Jésus
ressent désir visiter les hommes, notammt au lieu où hérétiques viennent d’être brûlés vifs,
symbolisant violence exercée au nom foi.
Malgré 7 cruauté, Jésus apparaît avc compass°,
ressuscite 1 fille morte.
Le cardinal, représentant de l’Église, = sévère, et profondémt inquiet
face Jésus.
Il sait que, s’il laisse Christ libre agir, cela bouleverserait totalement son pvr +
ordre établi.
Le Grd Inquisiteur incarne ici une forme d’autorité rigide, qui préfère maintenir
contrôle sur consciences plutôt que de laisser liberté radicale du message du Christ.
Il se
justifie en reprochant à Jésus d’avoir voulu donner à l’h 1 amour libre càd que l’h puisse
choisir par lui-mm de suivre ou non D, ss contrainte ni miracle pour le forcer.
Ce libre arbitre
est vu comme un fardeau trop lourd, qui conduit au doute, à la révolte, et mm au rejet de D.
Il semble ainsi avoir abandonné hommes par son carac éphémère, et en laissant dominer ce
choix apr lui.
Le Grd Inquisiteur explique que l’Église a « corrigé » l’œ du Christ qui n’aurait x
saisi le tragique de condit° humaine, en supprimant 7 liberté trop difficile à porter, en
imposant 1 soumission aveugle basée sur le miracle, le mystère et l’autorité.
L’étoile qui
guide le berger apparaît ainsi à travers l’institut° de l’Eglise.
⇒ Ainsi, christ apparaît // figure de l’immanence, attachée au M sensible + marquée par
traversée condit° humaine.
Il surgit ds le M en ayant 1 valeur d’ex, révélant chez l’h tantôt tt
le bien qu’il pt faire aux autres, tantôt tte la violence dt il est capable.
Sa valeur d’immanence
se révèle de manière paroxystique ds son simple carac d’ex qui fait de lui 1 homme qui
quitte vie à un mmt donné, abandonnant de la sorte les h face à lr existence.
Toutefois, si ds
l’imaginaire collectif, et + svt en-dehors du cadre religieux, on garde en tête le caractère
immanent du dieu homme, par l’image de sa chair mm qu’on a en tête,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CONVERSATIONS CHRÉTIENNES DANS LESQUELLES ON JUSTIFIE LA VÉRITÉ DE LA RELIGION ET DE LA MORALE DE JÉSUS-CHRIST - Nicolas MalebRAnche
- CHRIST (Le) [Crist]. (résumé & analyse)
- HISTOIRE DU CHRIST [La Storia di Cristo]. (résumé)
- EMMANUEL QUINT, LE FOU EN CHRIST (résumé)
- VICTOIRE ET TRIOMPHE DU CHRIST (résumé & analyse de l’oeuvre)