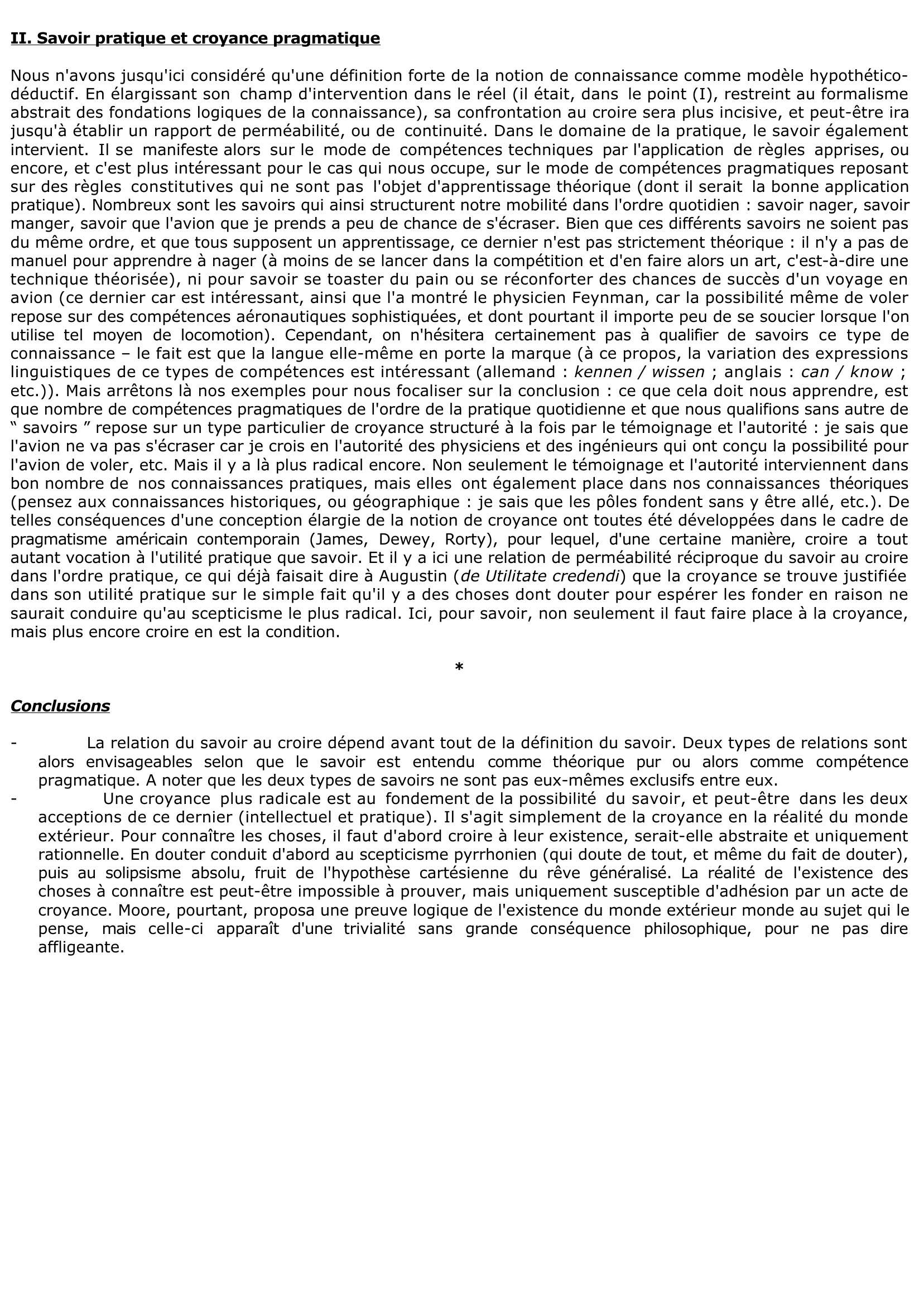Le cru et le su s'excluent-ils ?
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
«
II.
Savoir pratique et croyance pragmatique Nous n'avons jusqu'ici considéré qu'une définition forte de la notion de connaissance comme modèle hypothético-déductif.
En élargissant son champ d'intervention dans le réel (il était, dans le point (I), restreint au formalismeabstrait des fondations logiques de la connaissance), sa confrontation au croire sera plus incisive, et peut-être irajusqu'à établir un rapport de perméabilité, ou de continuité.
Dans le domaine de la pratique, le savoir égalementintervient.
Il se manifeste alors sur le mode de compétences techniques par l'application de règles apprises, ouencore, et c'est plus intéressant pour le cas qui nous occupe, sur le mode de compétences pragmatiques reposantsur des règles constitutives qui ne sont pas l'objet d'apprentissage théorique (dont il serait la bonne applicationpratique).
Nombreux sont les savoirs qui ainsi structurent notre mobilité dans l'ordre quotidien : savoir nager, savoirmanger, savoir que l'avion que je prends a peu de chance de s'écraser.
Bien que ces différents savoirs ne soient pasdu même ordre, et que tous supposent un apprentissage, ce dernier n'est pas strictement théorique : il n'y a pas demanuel pour apprendre à nager (à moins de se lancer dans la compétition et d'en faire alors un art, c'est-à-dire unetechnique théorisée), ni pour savoir se toaster du pain ou se réconforter des chances de succès d'un voyage enavion (ce dernier car est intéressant, ainsi que l'a montré le physicien Feynman, car la possibilité même de volerrepose sur des compétences aéronautiques sophistiquées, et dont pourtant il importe peu de se soucier lorsque l'onutilise tel moyen de locomotion).
Cependant, on n'hésitera certainement pas à qualifier de savoirs ce type deconnaissance – le fait est que la langue elle-même en porte la marque (à ce propos, la variation des expressionslinguistiques de ce types de compétences est intéressant (allemand : kennen / wissen ; anglais : can / know ; etc.)).
Mais arrêtons là nos exemples pour nous focaliser sur la conclusion : ce que cela doit nous apprendre, estque nombre de compétences pragmatiques de l'ordre de la pratique quotidienne et que nous qualifions sans autre de“ savoirs ” repose sur un type particulier de croyance structuré à la fois par le témoignage et l'autorité : je sais quel'avion ne va pas s'écraser car je crois en l'autorité des physiciens et des ingénieurs qui ont conçu la possibilité pourl'avion de voler, etc.
Mais il y a là plus radical encore.
Non seulement le témoignage et l'autorité interviennent dansbon nombre de nos connaissances pratiques, mais elles ont également place dans nos connaissances théoriques(pensez aux connaissances historiques, ou géographique : je sais que les pôles fondent sans y être allé, etc.).
Detelles conséquences d'une conception élargie de la notion de croyance ont toutes été développées dans le cadre depragmatisme américain contemporain (James, Dewey, Rorty), pour lequel, d'une certaine manière, croire a toutautant vocation à l'utilité pratique que savoir.
Et il y a ici une relation de perméabilité réciproque du savoir au croiredans l'ordre pratique, ce qui déjà faisait dire à Augustin ( de Utilitate credendi ) que la croyance se trouve justifiée dans son utilité pratique sur le simple fait qu'il y a des choses dont douter pour espérer les fonder en raison nesaurait conduire qu'au scepticisme le plus radical.
Ici, pour savoir, non seulement il faut faire place à la croyance,mais plus encore croire en est la condition.
* Conclusions - La relation du savoir au croire dépend avant tout de la définition du savoir.
Deux types de relations sont alors envisageables selon que le savoir est entendu comme théorique pur ou alors comme compétencepragmatique.
A noter que les deux types de savoirs ne sont pas eux-mêmes exclusifs entre eux. - Une croyance plus radicale est au fondement de la possibilité du savoir, et peut-être dans les deux acceptions de ce dernier (intellectuel et pratique).
Il s'agit simplement de la croyance en la réalité du mondeextérieur.
Pour connaître les choses, il faut d'abord croire à leur existence, serait-elle abstraite et uniquementrationnelle.
En douter conduit d'abord au scepticisme pyrrhonien (qui doute de tout, et même du fait de douter),puis au solipsisme absolu, fruit de l'hypothèse cartésienne du rêve généralisé.
La réalité de l'existence deschoses à connaître est peut-être impossible à prouver, mais uniquement susceptible d'adhésion par un acte decroyance.
Moore, pourtant, proposa une preuve logique de l'existence du monde extérieur monde au sujet qui lepense, mais celle-ci apparaît d'une trivialité sans grande conséquence philosophique, pour ne pas direaffligeante..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TL1 2015-2016 Désir et raison s'excluent-ils nécessairement ?
- CRU ET LE CUIT (Le). Claude Lévi-Strauss (résumé)
- Le vrai n'est-il que cru ?
- Vérité et mensonge s'excluent-ils par définition et irrémédiablement, ou peut-on trouver une trace de vérité dans le mensonge ?
- Histoire de la Revolution française, IX directoire feignant la franchise, lui montrait ces rapports, et affectait de les traiter avec mépris, comme s'il avait cru le général incapable d'ambition.