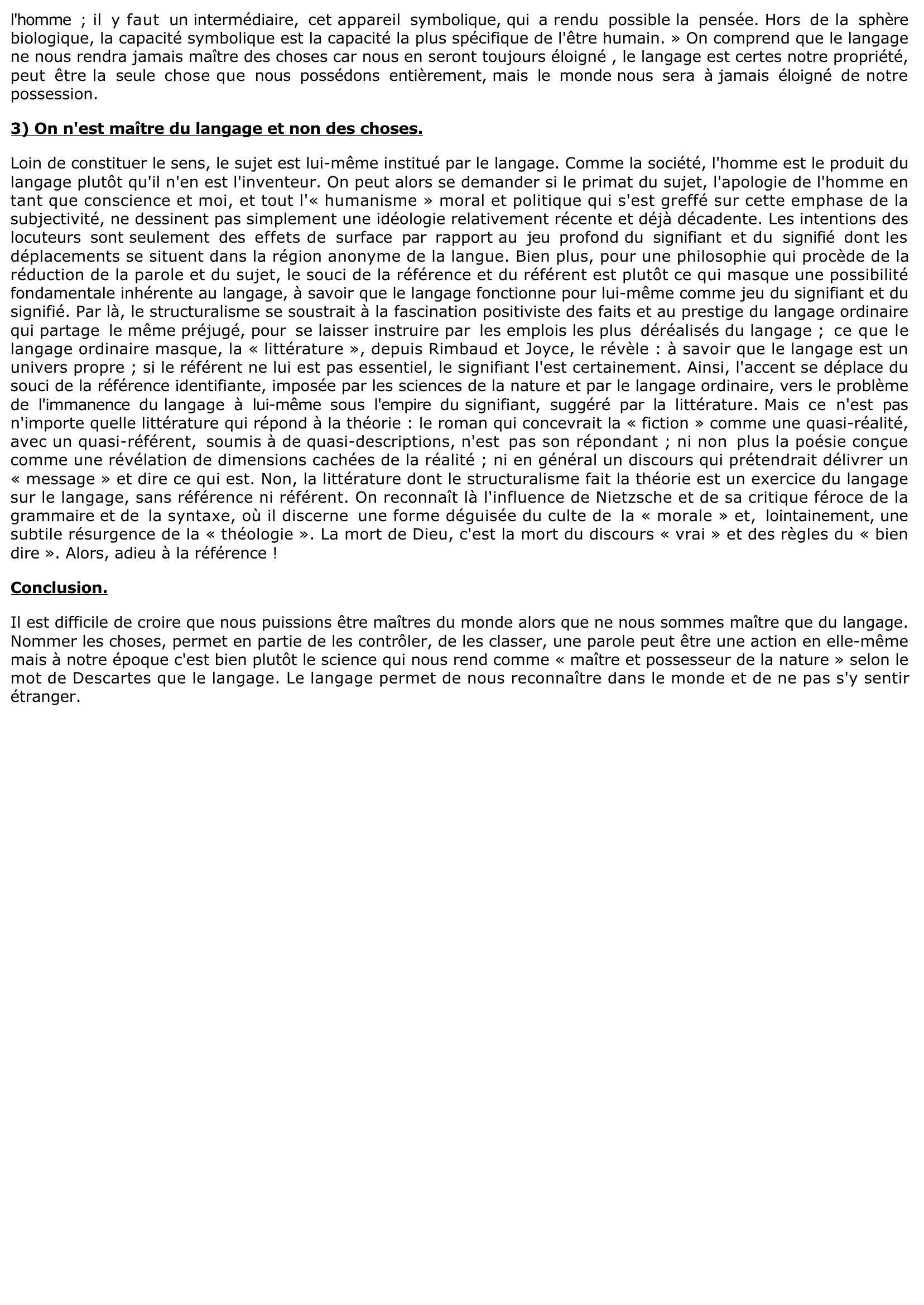Le langage nous rend-il maîtres des choses ?
Publié le 25/01/2004

Extrait du document


«
l'homme ; il y faut un intermédiaire, cet appareil symbolique, qui a rendu possible la pensée.
Hors de la sphèrebiologique, la capacité symbolique est la capacité la plus spécifique de l'être humain.
» On comprend que le langagene nous rendra jamais maître des choses car nous en seront toujours éloigné , le langage est certes notre propriété,peut être la seule chose que nous possédons entièrement, mais le monde nous sera à jamais éloigné de notrepossession.
3) On n'est maître du langage et non des choses.
Loin de constituer le sens, le sujet est lui-même institué par le langage.
Comme la société, l'homme est le produit dulangage plutôt qu'il n'en est l'inventeur.
On peut alors se demander si le primat du sujet, l'apologie de l'homme entant que conscience et moi, et tout l'« humanisme » moral et politique qui s'est greffé sur cette emphase de lasubjectivité, ne dessinent pas simplement une idéologie relativement récente et déjà décadente.
Les intentions deslocuteurs sont seulement des effets de surface par rapport au jeu profond du signifiant et du signifié dont lesdéplacements se situent dans la région anonyme de la langue.
Bien plus, pour une philosophie qui procède de laréduction de la parole et du sujet, le souci de la référence et du référent est plutôt ce qui masque une possibilitéfondamentale inhérente au langage, à savoir que le langage fonctionne pour lui-même comme jeu du signifiant et dusignifié.
Par là, le structuralisme se soustrait à la fascination positiviste des faits et au prestige du langage ordinairequi partage le même préjugé, pour se laisser instruire par les emplois les plus déréalisés du langage ; ce que lelangage ordinaire masque, la « littérature », depuis Rimbaud et Joyce, le révèle : à savoir que le langage est ununivers propre ; si le référent ne lui est pas essentiel, le signifiant l'est certainement.
Ainsi, l'accent se déplace dusouci de la référence identifiante, imposée par les sciences de la nature et par le langage ordinaire, vers le problèmede l'immanence du langage à lui-même sous l'empire du signifiant, suggéré par la littérature.
Mais ce n'est pasn'importe quelle littérature qui répond à la théorie : le roman qui concevrait la « fiction » comme une quasi-réalité,avec un quasi-référent, soumis à de quasi-descriptions, n'est pas son répondant ; ni non plus la poésie conçuecomme une révélation de dimensions cachées de la réalité ; ni en général un discours qui prétendrait délivrer un« message » et dire ce qui est.
Non, la littérature dont le structuralisme fait la théorie est un exercice du langagesur le langage, sans référence ni référent.
On reconnaît là l'influence de Nietzsche et de sa critique féroce de lagrammaire et de la syntaxe, où il discerne une forme déguisée du culte de la « morale » et, lointainement, unesubtile résurgence de la « théologie ».
La mort de Dieu, c'est la mort du discours « vrai » et des règles du « biendire ».
Alors, adieu à la référence !
Conclusion.
Il est difficile de croire que nous puissions être maîtres du monde alors que ne nous sommes maître que du langage.Nommer les choses, permet en partie de les contrôler, de les classer, une parole peut être une action en elle-mêmemais à notre époque c'est bien plutôt le science qui nous rend comme « maître et possesseur de la nature » selon lemot de Descartes que le langage.
Le langage permet de nous reconnaître dans le monde et de ne pas s'y sentirétranger..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le langage nous rend-il maitres des choses?
- Le langage est-il une représentation des choses ?
- Pourquoi le langage ne peut-il exprimer l'essence intime des choses ?
- Nietzsche: Le langage n'exprime pas la vérité des choses, mais le rapport des hommes aux choses
- Le langage nous éloigne-t-il des choses ?