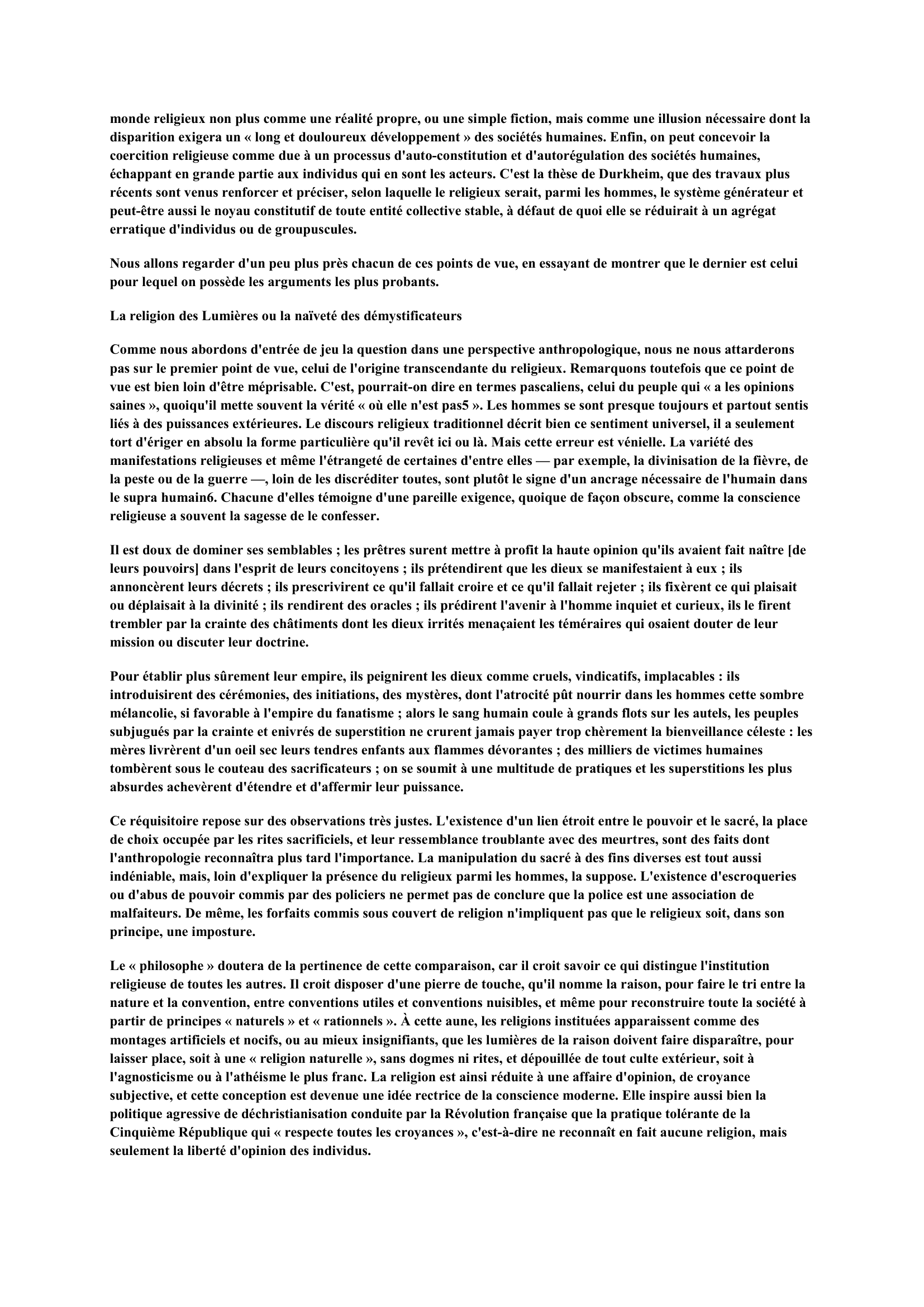Les hommes peuvent-ils se passer de toute religion ?
Publié le 30/01/2012
Extrait du document


«
monde religieux non plus comme une réalité propre, ou une simple fiction, mais comme une illusion nécessaire dont la
disparition exigera un « long et douloureux développement » des sociétés humaines.
Enfin, on peut concevoir la
coercition religieuse comme due à un processus d'auto -constitution et d'autorégulation des sociétés humaines,
échappant en grande partie aux individus qui en sont les acteurs.
C'est la thèse de Durkheim, que des travaux plus
récents sont venus renforcer et préciser, selon laquelle le religieux serait, parmi les hommes, le systè me générateur et
peut -être aussi le noyau constitutif de toute entité collective stable, à défaut de quoi elle se réduirait à un agrégat
erratique d'individus ou de groupuscules.
Nous allons regarder d'un peu plus près chacun de ces points de vue, en essay ant de montrer que le dernier est celui
pour lequel on possède les arguments les plus probants.
La religion des Lumières ou la naïveté des démystificateurs
Comme nous abordons d'entrée de jeu la question dans une perspective anthropologique, nous ne nous a ttarderons
pas sur le premier point de vue, celui de l'origine transcendante du religieux.
Remarquons toutefois que ce point de
vue est bien loin d'être méprisable.
C'est, pourrait -on dire en termes pascaliens, celui du peuple qui « a les opinions
saines » , quoiqu'il mette souvent la vérité « où elle n'est pas5 ».
Les hommes se sont presque toujours et partout sentis
liés à des puissances extérieures.
Le discours religieux traditionnel décrit bien ce sentiment universel, il a seulement
tort d'ériger en abso lu la forme particulière qu'il revêt ici ou là.
Mais cette erreur est vénielle.
La variété des
manifestations religieuses et même l'étrangeté de certaines d'entre elles — par exemple, la divinisation de la fièvre, de
la peste ou de la guerre —, loin de les discréditer toutes, sont plutôt le signe d'un ancrage nécessaire de l'humain dans
le supra humain6.
Chacune d'elles témoigne d'une pareille exigence, quoique de façon obscure, comme la conscience
religieuse a souv ent la sagesse de le confesser.
Il est dou x de dominer ses semblables ; les prêtres surent mettre à profit la haute opinion qu'ils avaient fait naître [de
leurs pouvoirs] dans l'esprit de leurs concitoyens ; ils prétendirent que les dieux se manifestaient à eux ; ils
annoncèrent leurs décrets ; il s prescrivirent ce qu'il fallait croire et ce qu'il fallait rejeter ; ils fixèrent ce qui plaisait
ou déplaisait à la divinité ; ils rendirent des oracles ; ils prédirent l'avenir à l'homme inquiet et curieux, ils le firent
trembler par la crainte des chât iments dont les dieux irrités menaçaient les téméraires qui osaient douter de leur
mission ou discuter leur doctrine.
Pour établir plus sûrement leur empire, ils peignirent les dieux comme cruels, vindicatifs, implacables : ils
introduisirent des cérémonies, des initiations, des mystères, dont l'atrocité pût nourrir dans les hommes cette sombre
mélancolie, si favorable à l'empire du fanatisme ; alors le sang humain coule à grands flots sur les autels, les peuples
subjugués par la crainte et enivrés de super stition ne crurent jamais payer trop chèrement la bienveillance céleste : les
mères livrèrent d'un oeil sec leurs tendres enfants aux flammes dévorantes ; des milliers de victimes humaines
tombèrent sous le couteau des sacrificateurs ; on se soumit à une m ultitude de pratiques et les superstitions les plus
absurdes achevèrent d'étendre et d'affermir leur puissance.
Ce réquisitoire repose sur des observations très justes.
L'existence d'un lien étroit entre le pouvoir et le sacré, la place
de choix occupée pa r les rites sacrificiels, et leur ressemblance troublante avec des meurtres, sont des faits dont
l'anthropologie reconnaîtra plus tard l'importance.
La manipulation du sacré à des fins diverses est tout aussi
indéniable, mais, loin d'expliquer la présence du religieux parmi les hommes, la suppose.
L'existence d'escroqueries
ou d'abus de pouvoir commis par des policiers ne permet pas de conclure que la police est une association de
malfaiteurs.
De même, les forfaits commis sous couvert de religion n'implique nt pas que le religieux soit, dans son
principe, une imposture.
Le « philosophe » doutera de la pertinence de cette comparaison, car il croit savoir ce qui distingue l'institution
religieuse de toutes les autres.
Il croit disposer d'une pierre de touche, q u'il nomme la raison, pour faire le tri entre la
nature et la convention, entre conventions utiles et conventions nuisibles, et même pour reconstruire toute la société à
partir de principes « naturels » et « rationnels ».
À cette aune, les religions instit uées apparaissent comme des
montages artificiels et nocifs, ou au mieux insignifiants, que les lumières de la raison doivent faire disparaître, pour
laisser place, soit à une « religion naturelle », sans dogmes ni rites, et dépouillée de tout culte extérieur, soit à
l'agnosticisme ou à l'athéisme le plus franc.
La religion est ainsi réduite à une affaire d'opinion, de croyance
subjective, et cette conception est devenue une idée rectrice de la conscience moderne.
Elle inspire aussi bien la
politique agressi ve de déchristianisation conduite par la Révolution française que la pratique tolérante de la
Cinquième République qui « respecte toutes les croyances », c'est -à-dire ne reconnaît en fait aucune religion , mais
seulement la liberté d'opinion des individus..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on se passer de religion ?
- l'Etat peut il se passer de la religion
- Une société peut-elle se passer de religion ?
- La religion rassemble t-elle ou divise t-elle les hommes ?
- Peut-on se passer de religion ?