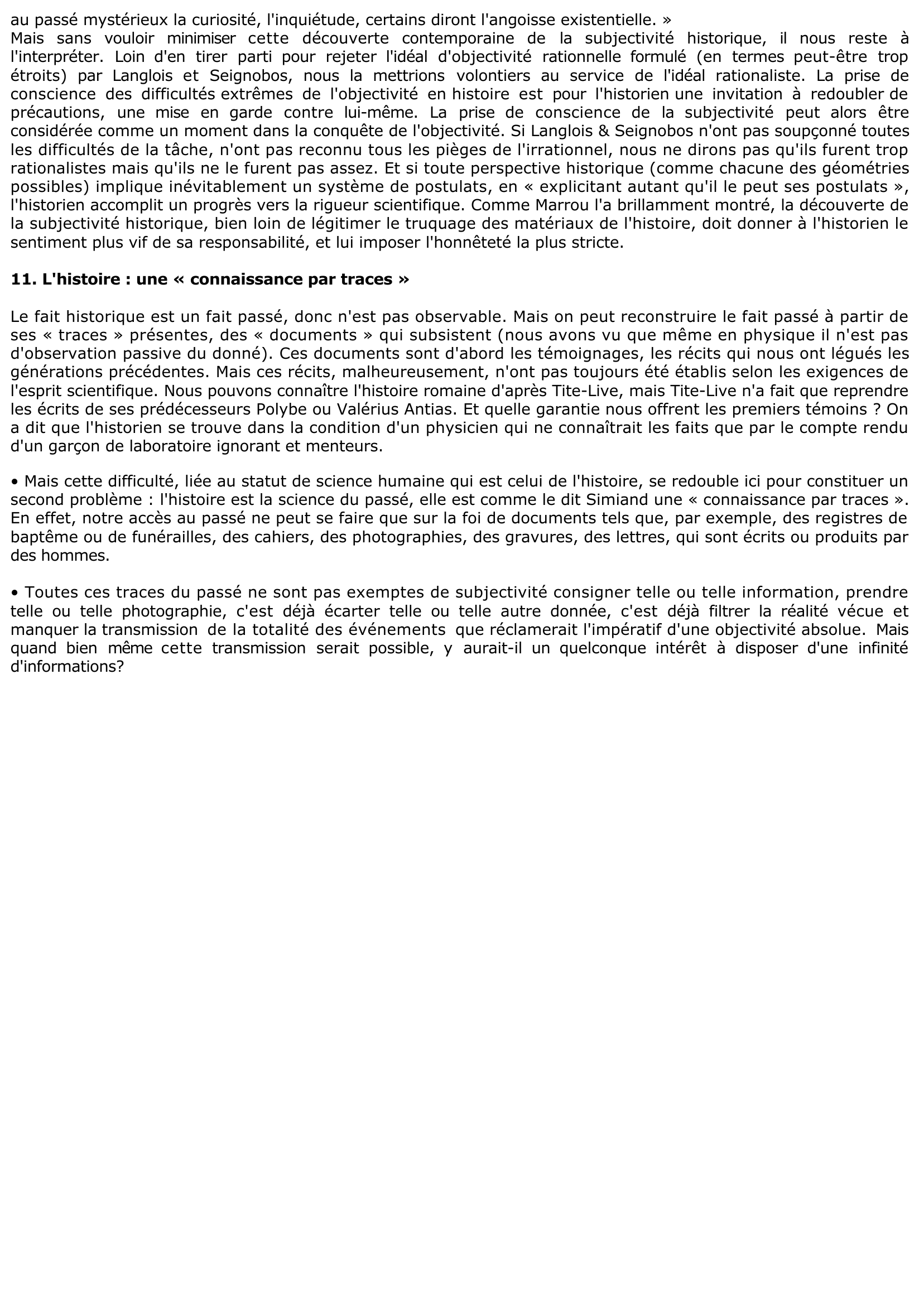L'historien peut-il être objectif ?
Publié le 21/01/2004

Extrait du document
«
au passé mystérieux la curiosité, l'inquiétude, certains diront l'angoisse existentielle.
»Mais sans vouloir minimiser cette découverte contemporaine de la subjectivité historique, il nous reste àl'interpréter.
Loin d'en tirer parti pour rejeter l'idéal d'objectivité rationnelle formulé (en termes peut-être tropétroits) par Langlois et Seignobos, nous la mettrions volontiers au service de l'idéal rationaliste.
La prise deconscience des difficultés extrêmes de l'objectivité en histoire est pour l'historien une invitation à redoubler deprécautions, une mise en garde contre lui-même.
La prise de conscience de la subjectivité peut alors êtreconsidérée comme un moment dans la conquête de l'objectivité.
Si Langlois & Seignobos n'ont pas soupçonné toutesles difficultés de la tâche, n'ont pas reconnu tous les pièges de l'irrationnel, nous ne dirons pas qu'ils furent troprationalistes mais qu'ils ne le furent pas assez.
Et si toute perspective historique (comme chacune des géométriespossibles) implique inévitablement un système de postulats, en « explicitant autant qu'il le peut ses postulats »,l'historien accomplit un progrès vers la rigueur scientifique.
Comme Marrou l'a brillamment montré, la découverte dela subjectivité historique, bien loin de légitimer le truquage des matériaux de l'histoire, doit donner à l'historien lesentiment plus vif de sa responsabilité, et lui imposer l'honnêteté la plus stricte.
11.
L'histoire : une « connaissance par traces »
Le fait historique est un fait passé, donc n'est pas observable.
Mais on peut reconstruire le fait passé à partir deses « traces » présentes, des « documents » qui subsistent (nous avons vu que même en physique il n'est pasd'observation passive du donné).
Ces documents sont d'abord les témoignages, les récits qui nous ont légués lesgénérations précédentes.
Mais ces récits, malheureusement, n'ont pas toujours été établis selon les exigences del'esprit scientifique.
Nous pouvons connaître l'histoire romaine d'après Tite-Live, mais Tite-Live n'a fait que reprendreles écrits de ses prédécesseurs Polybe ou Valérius Antias.
Et quelle garantie nous offrent les premiers témoins ? Ona dit que l'historien se trouve dans la condition d'un physicien qui ne connaîtrait les faits que par le compte rendud'un garçon de laboratoire ignorant et menteurs.
• Mais cette difficulté, liée au statut de science humaine qui est celui de l'histoire, se redouble ici pour constituer unsecond problème : l'histoire est la science du passé, elle est comme le dit Simiand une « connaissance par traces ».En effet, notre accès au passé ne peut se faire que sur la foi de documents tels que, par exemple, des registres debaptême ou de funérailles, des cahiers, des photographies, des gravures, des lettres, qui sont écrits ou produits pardes hommes.
• Toutes ces traces du passé ne sont pas exemptes de subjectivité consigner telle ou telle information, prendretelle ou telle photographie, c'est déjà écarter telle ou telle autre donnée, c'est déjà filtrer la réalité vécue etmanquer la transmission de la totalité des événements que réclamerait l'impératif d'une objectivité absolue.
Maisquand bien même cette transmission serait possible, y aurait-il un quelconque intérêt à disposer d'une infinitéd'informations?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'historien peut-il être objectif?
- L'historien peut-il être objectif ?
- l'historien peut-il être objectif ?
- L'historien est-il objectif?
- L'historien peut-il être objectif ?