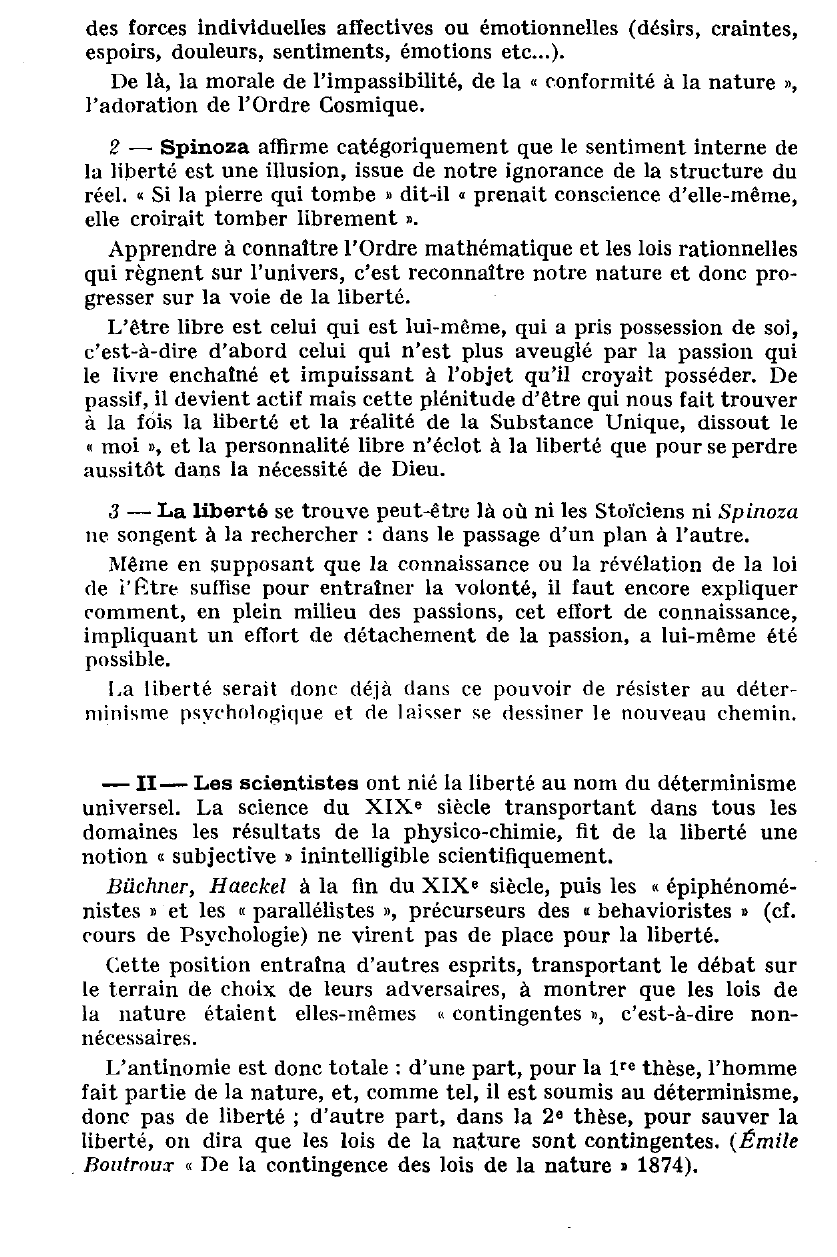Peut-on comprendre la liberté ?
Publié le 03/04/2012
Extrait du document
Selon Bergson, cependant, ce n'est pas dans cette question finale « Voilà donc les tendances, les puissances et les handicaps dont je dispose ou dont je suis pourvu, quoi faire maintenant dans telle situation ? .... que s'éprouve la liberté ; elle est dans tous les actes du moi à condition qu'ils soient sincères, elle est dans la manière même dont se développe la réflexion lorsqu'elle est animée par le moi profond. Il est à remarquer en effet ...
«
des forces individuelles affectives ou émotionnelles (désirs, craintes, espoirs, douleurs, sentiments, émotions etc ...
).
De
là, la morale de l'impassibilité, de la " conformité à la nature ., l'adoration de l'Ordre Cosmique.
2 - Spinoza affirme catégoriquement que le sentiment interne de
la liberté est une illusion, issue de notre ignorance de la structure du
réel.
" Si la pierre qui tombe » dit-il • prenait conscience d'elle-même,
elle croirait tomber librement >.
Apprendre à connaître l'Ordre mathématique et les lois rationnelles qui règnent sur l'univers, c'est reconnaître notre nature et donc pro gresser sur la voie de la liberté.
L'être libre est celui qui est lui-même, qui a pris possession de soi, c'est-à-dire d'abord celui qui n'est plus aveuglé par la passion qui le livre enchaîné et impuissant à l'objet qu'il croyait posséder.
De passif, il devient actif mais cette plénitude d'être qui nous fait trouver à la fois la liberté et la réalité de la Substance Unique, dissout le " moi •, et la personnalité libre n'éclot à la liberté que pour se perdre aussitôt dans la nécessité de Dieu.
3 -La liberté se trouve peut-être là où ni les Stoïciens ni Spinoza ne songent à la rechercher : dans le passage d'un plan à l'autre.
Même en supposant que la connaissance ou la révélation de la loi de i' F.:tre suflise pour entraîner la volonté, il faut encore expliquer comment, en plein milieu des passions, cet effort de connaissance, impliquant un effort de détachement de la passion, a lui-même été possible.
La
liberté serait donc dé.ià dans ce pouvoir de résister au déter minisme psychologi(jue et de lai,ser se dessiner Je nouveau chemin.
-II- Les scientistes ont nié la liberté au nom du déterminisme universel.
La science du XIX• siècle transportant dans tous les
domaines les résultats de la physico-chimie, fit de la liberté une notion « subjective • inintelligible scientifiquement.
Büchner, Haeckel à la fin du XIX• siècle, puis les "épiphénomé nistes » et les « parallélistes >>, précurseurs des « behavioristes » (cf.
cours de Psychologie) ne virent pas de place pour la liberté.
Cette position entraîna d'autres esprits, transportant le débat sur le terrain de choix de leurs adversaires, à montrer que les lois de la nature étaient elles-mêmes « contingentes •, c'est-à-dire non nécessaires.
L'antinomie est donc totale: d'une part, pour la tr• thèse, l'homme fait partie de la nature, et, comme tel, il est soumis au déterminisme, donc pas de liberté ; d'autre part, dans la 2• thèse, pour sauver la liberté, on dira que les lois de la nature sont contingentes.
(Émile Boutroux " De la contingence des lois de la nature • 1874)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Comprendre les notions de liberté d'opinion et d'expression : la presse Objectifs Découvrir Des médias pour s'informer o Souligner la distinction entre quotidien et hebdomadaire.
- Selon vous, en quel sens faut-il comprendre que la liberté ne s'obtient qu'aux prix d'importants sacrifices ?
- « L'analyse des textes diminue-t-elle le plaisir et la liberté de mes lectures ultérieures? Pas du tout. Au contraire, après la réflexion, j'ai toujours éprouvé de nouveaux plaisirs. Comprendre comment fonctionne le langage ne diminue pas le plaisir de parler, ni d'écouter. Pour expliquer ce sentiment, j'ai coutume de dire que même les gynécologues tombent amoureux »
- L'art se distingue de la nature comme faire (facere) d'agir... A vrai dire on ne devrait nommer art que le produit de la liberté, c'est à dire d'un vouloir qui fonde ses actes sur la raison. Kant. (Comprendre que le travail des abeilles n'est pas une oeuvre d'art). Commentez cette citation.
- Dans son livre, L'Homme en procès, Pierre-Henri Simon s'interroge: « Qu'est-ce que le tragique, sinon le sentiment d'une résistance obscure et insensée contre laquelle se brise la force de la liberté et de la raison qui est dans l'homme ? » En quoi votre connaissance des tragédies de Racine vous permet-elle de comprendre et d'illustrer ces propos ?