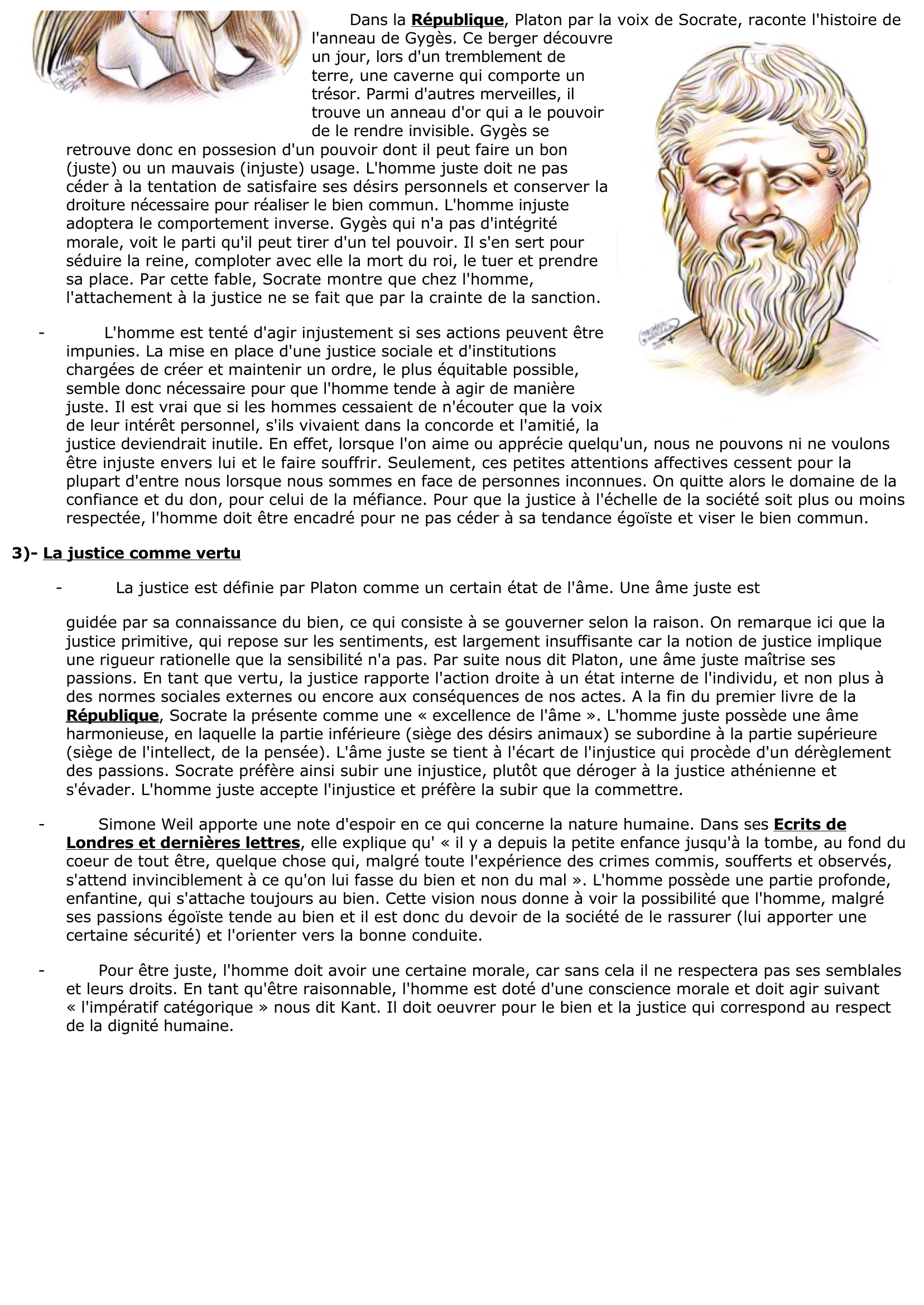Peut-on être juste si les autres ne le sont pas ?
Publié le 23/01/2005

Extrait du document
«
2)- La justice sociale
- Dans la République , Platon par la voix de Socrate, raconte l'histoire de l'anneau de Gygès.
Ce berger découvreun jour, lors d'un tremblement deterre, une caverne qui comporte untrésor.
Parmi d'autres merveilles, iltrouve un anneau d'or qui a le pouvoirde le rendre invisible.
Gygès se retrouve donc en possesion d'un pouvoir dont il peut faire un bon(juste) ou un mauvais (injuste) usage.
L'homme juste doit ne pascéder à la tentation de satisfaire ses désirs personnels et conserver ladroiture nécessaire pour réaliser le bien commun.
L'homme injusteadoptera le comportement inverse.
Gygès qui n'a pas d'intégritémorale, voit le parti qu'il peut tirer d'un tel pouvoir.
Il s'en sert pourséduire la reine, comploter avec elle la mort du roi, le tuer et prendresa place.
Par cette fable, Socrate montre que chez l'homme,l'attachement à la justice ne se fait que par la crainte de la sanction.
- L'homme est tenté d'agir injustement si ses actions peuvent être impunies.
La mise en place d'une justice sociale et d'institutionschargées de créer et maintenir un ordre, le plus équitable possible,semble donc nécessaire pour que l'homme tende à agir de manièrejuste.
Il est vrai que si les hommes cessaient de n'écouter que la voixde leur intérêt personnel, s'ils vivaient dans la concorde et l'amitié, lajustice deviendrait inutile.
En effet, lorsque l'on aime ou apprécie quelqu'un, nous ne pouvons ni ne voulonsêtre injuste envers lui et le faire souffrir.
Seulement, ces petites attentions affectives cessent pour laplupart d'entre nous lorsque nous sommes en face de personnes inconnues.
On quitte alors le domaine de laconfiance et du don, pour celui de la méfiance.
Pour que la justice à l'échelle de la société soit plus ou moinsrespectée, l'homme doit être encadré pour ne pas céder à sa tendance égoïste et viser le bien commun.
3)- La justice comme vertu
- La justice est définie par Platon comme un certain état de l'âme.
Une âme juste est
guidée par sa connaissance du bien, ce qui consiste à se gouverner selon la raison.
On remarque ici que lajustice primitive, qui repose sur les sentiments, est largement insuffisante car la notion de justice impliqueune rigueur rationelle que la sensibilité n'a pas.
Par suite nous dit Platon, une âme juste maîtrise sespassions.
En tant que vertu, la justice rapporte l'action droite à un état interne de l'individu, et non plus àdes normes sociales externes ou encore aux conséquences de nos actes.
A la fin du premier livre de laRépublique , Socrate la présente comme une « excellence de l'âme ».
L'homme juste possède une âme harmonieuse, en laquelle la partie inférieure (siège des désirs animaux) se subordine à la partie supérieure(siège de l'intellect, de la pensée).
L'âme juste se tient à l'écart de l'injustice qui procède d'un dérèglementdes passions.
Socrate préfère ainsi subir une injustice, plutôt que déroger à la justice athénienne ets'évader.
L'homme juste accepte l'injustice et préfère la subir que la commettre.
- Simone Weil apporte une note d'espoir en ce qui concerne la nature humaine.
Dans ses Ecrits de Londres et dernières lettres , elle explique qu' « il y a depuis la petite enfance jusqu'à la tombe, au fond du coeur de tout être, quelque chose qui, malgré toute l'expérience des crimes commis, soufferts et observés,s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal ».
L'homme possède une partie profonde,enfantine, qui s'attache toujours au bien.
Cette vision nous donne à voir la possibilité que l'homme, malgréses passions égoïste tende au bien et il est donc du devoir de la société de le rassurer (lui apporter unecertaine sécurité) et l'orienter vers la bonne conduite.
- Pour être juste, l'homme doit avoir une certaine morale, car sans cela il ne respectera pas ses semblales et leurs droits.
En tant qu'être raisonnable, l'homme est doté d'une conscience morale et doit agir suivant« l'impératif catégorique » nous dit Kant.
Il doit oeuvrer pour le bien et la justice qui correspond au respectde la dignité humaine..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓