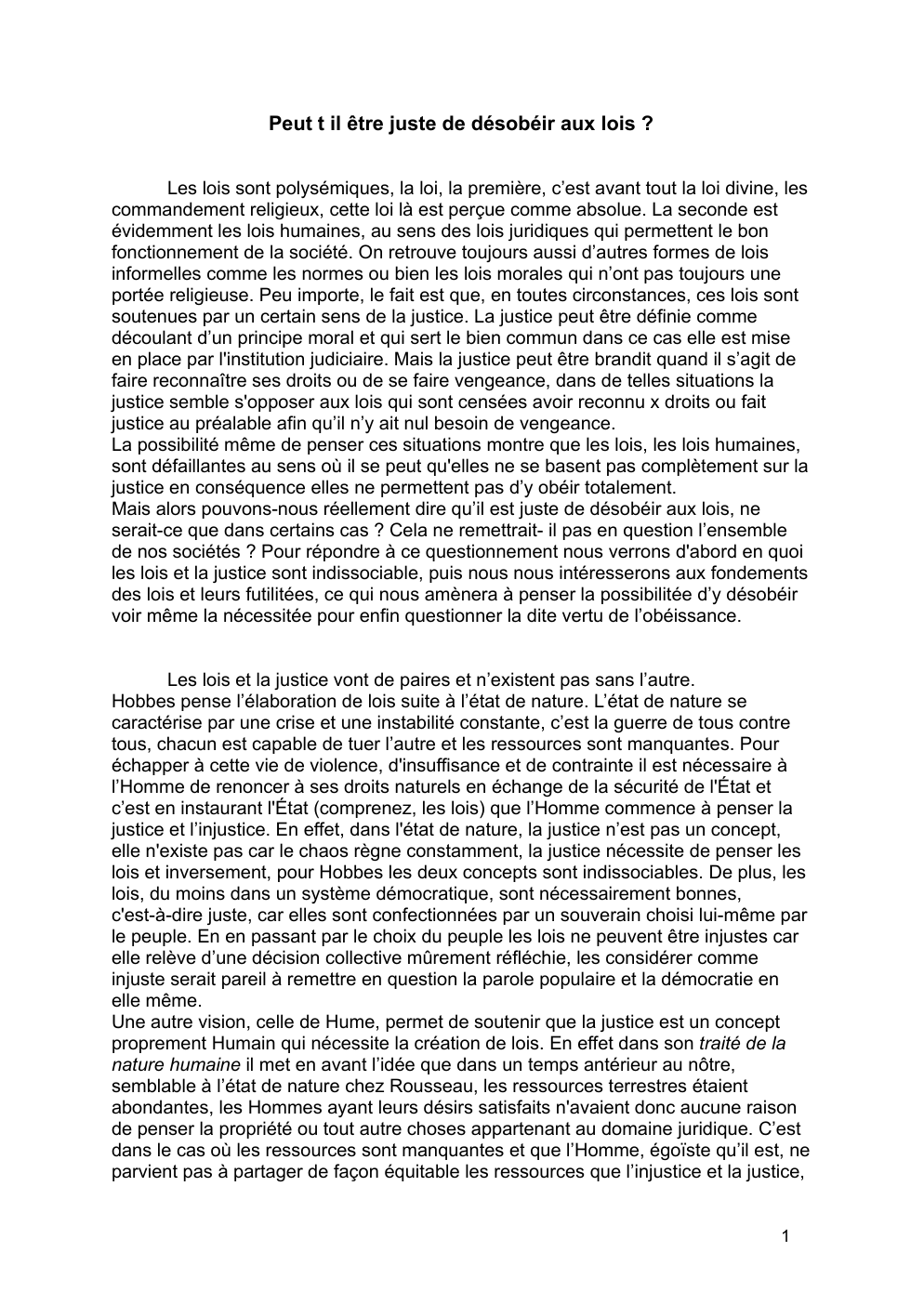Peut t il être juste de désobéir aux lois ?
Publié le 17/04/2025
Extrait du document
«
Peut t il être juste de désobéir aux lois ?
Les lois sont polysémiques, la loi, la première, c’est avant tout la loi divine, les
commandement religieux, cette loi là est perçue comme absolue.
La seconde est
évidemment les lois humaines, au sens des lois juridiques qui permettent le bon
fonctionnement de la société.
On retrouve toujours aussi d’autres formes de lois
informelles comme les normes ou bien les lois morales qui n’ont pas toujours une
portée religieuse.
Peu importe, le fait est que, en toutes circonstances, ces lois sont
soutenues par un certain sens de la justice.
La justice peut être définie comme
découlant d’un principe moral et qui sert le bien commun dans ce cas elle est mise
en place par l'institution judiciaire.
Mais la justice peut être brandit quand il s’agit de
faire reconnaître ses droits ou de se faire vengeance, dans de telles situations la
justice semble s'opposer aux lois qui sont censées avoir reconnu x droits ou fait
justice au préalable afin qu’il n’y ait nul besoin de vengeance.
La possibilité même de penser ces situations montre que les lois, les lois humaines,
sont défaillantes au sens où il se peut qu'elles ne se basent pas complètement sur la
justice en conséquence elles ne permettent pas d’y obéir totalement.
Mais alors pouvons-nous réellement dire qu’il est juste de désobéir aux lois, ne
serait-ce que dans certains cas ? Cela ne remettrait- il pas en question l’ensemble
de nos sociétés ? Pour répondre à ce questionnement nous verrons d'abord en quoi
les lois et la justice sont indissociable, puis nous nous intéresserons aux fondements
des lois et leurs futilitées, ce qui nous amènera à penser la possibilitée d’y désobéir
voir même la nécessitée pour enfin questionner la dite vertu de l’obéissance.
Les lois et la justice vont de paires et n’existent pas sans l’autre.
Hobbes pense l’élaboration de lois suite à l’état de nature.
L’état de nature se
caractérise par une crise et une instabilité constante, c’est la guerre de tous contre
tous, chacun est capable de tuer l’autre et les ressources sont manquantes.
Pour
échapper à cette vie de violence, d'insuffisance et de contrainte il est nécessaire à
l’Homme de renoncer à ses droits naturels en échange de la sécurité de l'État et
c’est en instaurant l'État (comprenez, les lois) que l’Homme commence à penser la
justice et l’injustice.
En effet, dans l'état de nature, la justice n’est pas un concept,
elle n'existe pas car le chaos règne constamment, la justice nécessite de penser les
lois et inversement, pour Hobbes les deux concepts sont indissociables.
De plus, les
lois, du moins dans un système démocratique, sont nécessairement bonnes,
c'est-à-dire juste, car elles sont confectionnées par un souverain choisi lui-même par
le peuple.
En en passant par le choix du peuple les lois ne peuvent être injustes car
elle relève d’une décision collective mûrement réfléchie, les considérer comme
injuste serait pareil à remettre en question la parole populaire et la démocratie en
elle même.
Une autre vision, celle de Hume, permet de soutenir que la justice est un concept
proprement Humain qui nécessite la création de lois.
En effet dans son traité de la
nature humaine il met en avant l’idée que dans un temps antérieur au nôtre,
semblable à l’état de nature chez Rousseau, les ressources terrestres étaient
abondantes, les Hommes ayant leurs désirs satisfaits n'avaient donc aucune raison
de penser la propriété ou tout autre choses appartenant au domaine juridique.
C’est
dans le cas où les ressources sont manquantes et que l’Homme, égoïste qu’il est, ne
parvient pas à partager de façon équitable les ressources que l’injustice et la justice,
1
comme concepts, apparaissent.
Dès lors, pour pallier aux problèmes de répartition
et de justice, l’Homme se crée des lois.
Les lois sont donc créées du fait du
sentiment d’injustice subi par les Hommes, sentiment qui est significatif de leur
humanité car lié à l’égoïsme qui les caractérise.
En sommes, les lois découlent
directement d’un sentiment d’injustice qui est proprement Humain.
Les lois semblent donc, que ce soit pour Hobbes ou Hume, être porteuse de
justice et être fondamentalement lié à la justice que ce soit en tant qu’origine ou
engendrement.
Pourtant cette idée peut être remise en cause.
Malgré ce que peut penser Hobbes ou Hume la justice ne semble pas
toujours concorder aux lois.
En effet “la” justice, en tant qu’unique et universelle, semble difficile à trouver au
point où l’on pourrait se demander si elle existe même.
C’est là d’ailleurs la thèse de
nombreux philosophes comme Pascal qui considère que “la” justice, au sens
d’universelle et d’absolue, n’existe pas sur terre.
Les lois, qui sont censées se baser
sur la justice, ne cessent de changer d'époque à une autre, d’une zone
géographique à l’autre ou simplement entre souverain d’une année à la suivante,
pascal appel cela “la coutume” les lois ne se basent pas sur la nature, la morale ou
la justice mais simplement sur la coutume.
Les exemples historiques ne manquent
pas, on peut citer la panélisation et la dépénalisation de l’homosexualité au cours de
l’histoire, plus globalement toute choses, meme les actes considérés comme
immoraux et affreux ont été félicité par une quelqu’onque société à un moment
donné dans l’histoire, aucune lois ne fait l’unanimité sur terre.
Pour autant Pascal
n’omet pas la possibilité qu’une justice naturelle puisse exister, toutefois il considère
que si tenté qu’une telle justice eut existé elle n’est plus et ne peut plus être du fait
de la perversion et de la corruption de l’Homme.
Dans une forme de continuité à cette thèse Calliclès, personnage dans le Gorgias de
Platon, pense aussi que les lois ne sont que l’expression de l'intérêt de ceux qui
gouvernent.
Sauf que pour Calliclès il existe bien dans le fond une sorte de justice
naturelle et là est le nœud du problème.
Pour lui aussi, les lois n’ont aucune
légitimité car elles ne soutiennent pas la justice naturelle, bien au contraire, les lois
s’opposent à la justice.
Calliclès pense une société de caste où les plus fort sont, par
un droit/devoir naturel, censés régner et les faibles ont une place de subalterne or à
cause de l’instauration de lois les faibles se retrouvent à gouverner et promouvoir
leur modèle de “justice” qui lui se base sur leur intérêt propre.
Ce système ne permet
donc pas d’obéir à la justice naturelle proposée par Calliclès.
Puisque les lois n’ont aucun fondement naturel et ne servent que l'intérêt de
certains, il est possible de les contester voir même nécessaire de le faire pour que
les lois correspondent à un idéal démocratique et ne servent plus simplement
l'intérêt d’un petit groupe.
En effet, si l'on considère les lois comme devant servir la justice et que l’on
observe dans le réel leur non action il est alors acceptable d’y désobéir.
Cette idée nous vient de Henry David Thoreau, philosophe américain du XIX, il écrit
de la désobéissance civile après avoir été emprisonné (pendant une journée hein ça
va) pour refus de payer un impôt.
Il consiéderait que payer l’impot revenait à soutenir
financièrement et idéologoqiue l’action de l’état or Thoreau s’opposait à l’esclavage
et la guerrre contre le mexique qui était menée.
Son action est non violente mais
2
illégale tout de même et se veut réformatrice des lois, l’action de Thoreau sert à
opposer à la froideur et bureaucratie de l'État les voies et les réelles convictions du
peuple.
Cette désobéissance pour autant, pour qu’elle soit effective, ne doit pas se
rapprocher de la criminalité au sens où elle ne doit pas être faite en catimini mais
plutôt aux yeux de tous et de façon collective.
Hannah Arendt l'explique bien, il y a
une réelle différence entre l’acte criminel, qui ne sert....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Spinoza: Faire le mal, est-ce seulement désobéir aux lois ?
- FAUT‐IL, PARFOIS, DÉSOBÉIR AUX LOIS?
- Peut-il être juste de désobéir aux lois de l'Etat ?
- Puis-je obéir librement aux lois, puis-je leur désobéir librement ?
- FAUT-IL, PARFOIS, DÉSOBÉIR AUX LOIS ?