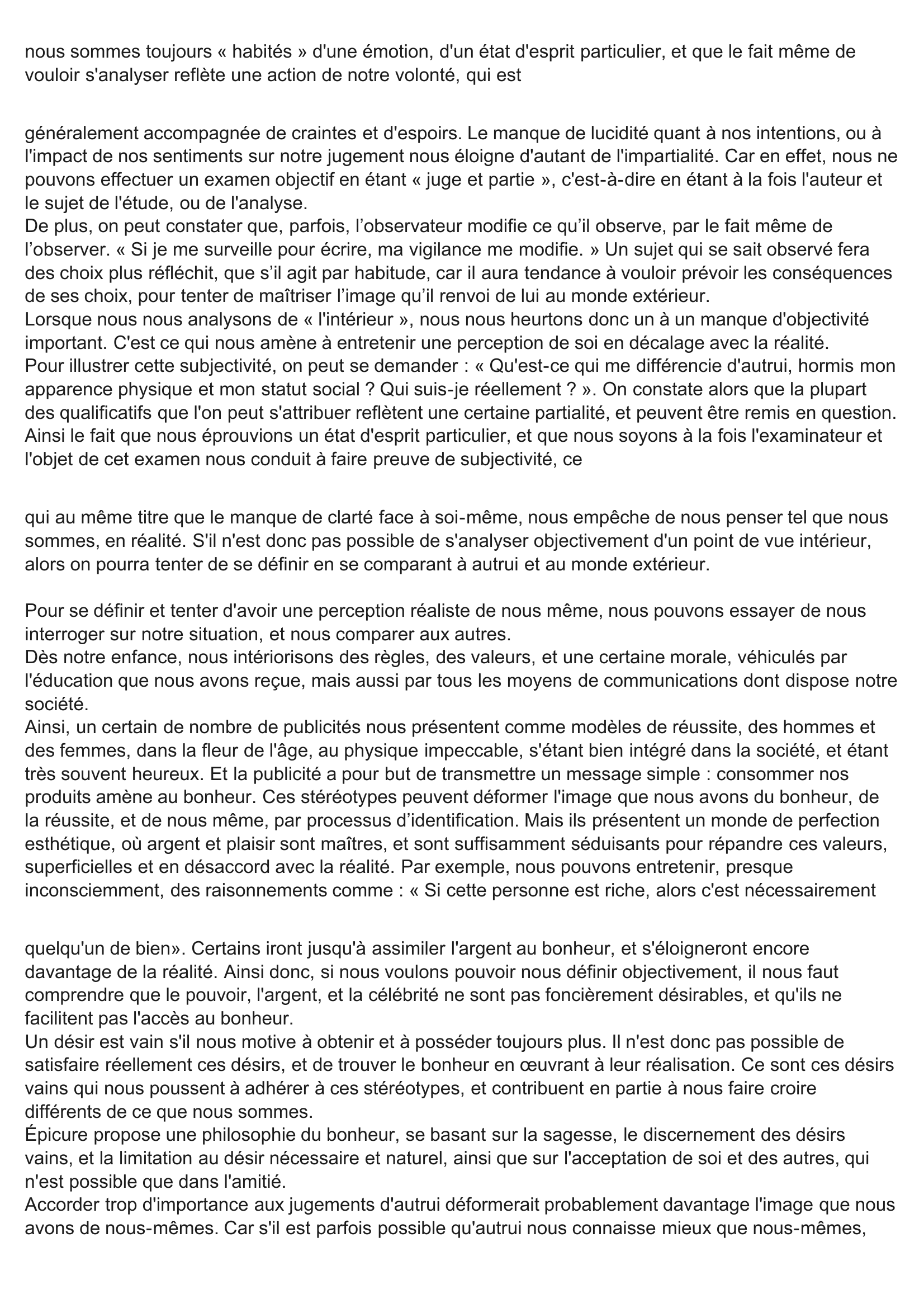Pourquoi Suis-Je Si Différent De Ce Que Je Pense Être ?
Publié le 15/01/2013

Extrait du document
Nous ne pouvons interagir avec le monde extérieur sans l'interpréter. Et par définition, interpréter quelque
chose induit une potentielle erreur, et nous déformons donc souvent la réalité, dans différentes mesures.
Nous ne sommes pas objectifs quant à nos perceptions, et l’interprétation de la réalité. Du fait même de
l'imperfection de nos cinq sens, nous ne sommes pas en mesure de percevoir la réalité avec exactitude.
« L'ego est le résultat d'une activité mentale qui crée et « maintient en vie « une entité imaginaire dans
notre esprit « (H. F. Wit), qui se place au centre de nos expériences.
Généralement, lorsque nous identifions quelque chose (un objet, un événement, ou une personne), nous
le faisons, tout naturellement, en le réduisant, résumant, ou au moins en accentuant ce qui nous
concerne directement. On peut constater ce phénomène lorsque, par exemple, un collège nous annonce
ses résultats à un examen et que notre première réaction et se situer par rapport à lui. Cela peut se faire
naturellement, inconsciemment.
«
nous sommes toujours « habités » d'une émotion, d'un état d'esprit particulier, et que le fait même de
vouloir s'analyser reflète une action de notre volonté, qui est
généralement accompagnée de craintes et d'espoirs.
Le manque de lucidité quant à nos intentions, ou à
l'impact de nos sentiments sur notre jugement nous éloigne d'autant de l'impartialité.
Car en effet, nous ne
pouvons effectuer un examen objectif en étant « juge et partie », c'est-à-dire en étant à la fois l'auteur et
le sujet de l'étude, ou de l'analyse.
De plus, on peut constater que, parfois, l’observateur modifie ce qu’il observe, par le fait même de
l’observer.
« Si je me surveille pour écrire, ma vigilance me modifie.
» Un sujet qui se sait observé fera
des choix plus réfléchit, que s’il agit par habitude, car il aura tendance à vouloir prévoir les conséquences
de ses choix, pour tenter de maîtriser l’image qu’il renvoi de lui au monde extérieur.
Lorsque nous nous analysons de « l'intérieur », nous nous heurtons donc un à un manque d'objectivité
important.
C'est ce qui nous amène à entretenir une perception de soi en décalage avec la réalité.
Pour illustrer cette subjectivité, on peut se demander : « Qu'est-ce qui me différencie d'autrui, hormis mon
apparence physique et mon statut social ? Qui suis-je réellement ? ».
On constate alors que la plupart
des qualificatifs que l'on peut s'attribuer reflètent une certaine partialité, et peuvent être remis en question.
Ainsi le fait que nous éprouvions un état d'esprit particulier, et que nous soyons à la fois l'examinateur et
l'objet de cet examen nous conduit à faire preuve de subjectivité, ce
qui au même titre que le manque de clarté face à soi-même, nous empêche de nous penser tel que nous
sommes, en réalité.
S'il n'est donc pas possible de s'analyser objectivement d'un point de vue intérieur,
alors on pourra tenter de se définir en se comparant à autrui et au monde extérieur.
Pour se définir et tenter d'avoir une perception réaliste de nous même, nous pouvons essayer de nous
interroger sur notre situation, et nous comparer aux autres.
Dès notre enfance, nous intériorisons des règles, des valeurs, et une certaine morale, véhiculés par
l'éducation que nous avons reçue, mais aussi par tous les moyens de communications dont dispose notre
société.
Ainsi, un certain de nombre de publicités nous présentent comme modèles de réussite, des hommes et
des femmes, dans la fleur de l'âge, au physique impeccable, s'étant bien intégré dans la société, et étant
très souvent heureux.
Et la publicité a pour but de transmettre un message simple : consommer nos
produits amène au bonheur.
Ces stéréotypes peuvent déformer l'image que nous avons du bonheur, de
la réussite, et de nous même, par processus d’identification.
Mais ils présentent un monde de perfection
esthétique, où argent et plaisir sont maîtres, et sont suffisamment séduisants pour répandre ces valeurs,
superficielles et en désaccord avec la réalité.
Par exemple, nous pouvons entretenir, presque
inconsciemment, des raisonnements comme : « Si cette personne est riche, alors c'est nécessairement
quelqu'un de bien».
Certains iront jusqu'à assimiler l'argent au bonheur, et s'éloigneront encore
davantage de la réalité.
Ainsi donc, si nous voulons pouvoir nous définir objectivement, il nous faut
comprendre que le pouvoir, l'argent, et la célébrité ne sont pas foncièrement désirables, et qu'ils ne
facilitent pas l'accès au bonheur.
Un désir est vain s'il nous motive à obtenir et à posséder toujours plus.
Il n'est donc pas possible de
satisfaire réellement ces désirs, et de trouver le bonheur en œuvrant à leur réalisation.
Ce sont ces désirs
vains qui nous poussent à adhérer à ces stéréotypes, et contribuent en partie à nous faire croire
différents de ce que nous sommes.
Épicure propose une philosophie du bonheur, se basant sur la sagesse, le discernement des désirs
vains, et la limitation au désir nécessaire et naturel, ainsi que sur l'acceptation de soi et des autres, qui
n'est possible que dans l'amitié.
Accorder trop d'importance aux jugements d'autrui déformerait probablement davantage l'image que nous
avons de nous-mêmes.
Car s'il est parfois possible qu'autrui nous connaisse mieux que nous-mêmes,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓