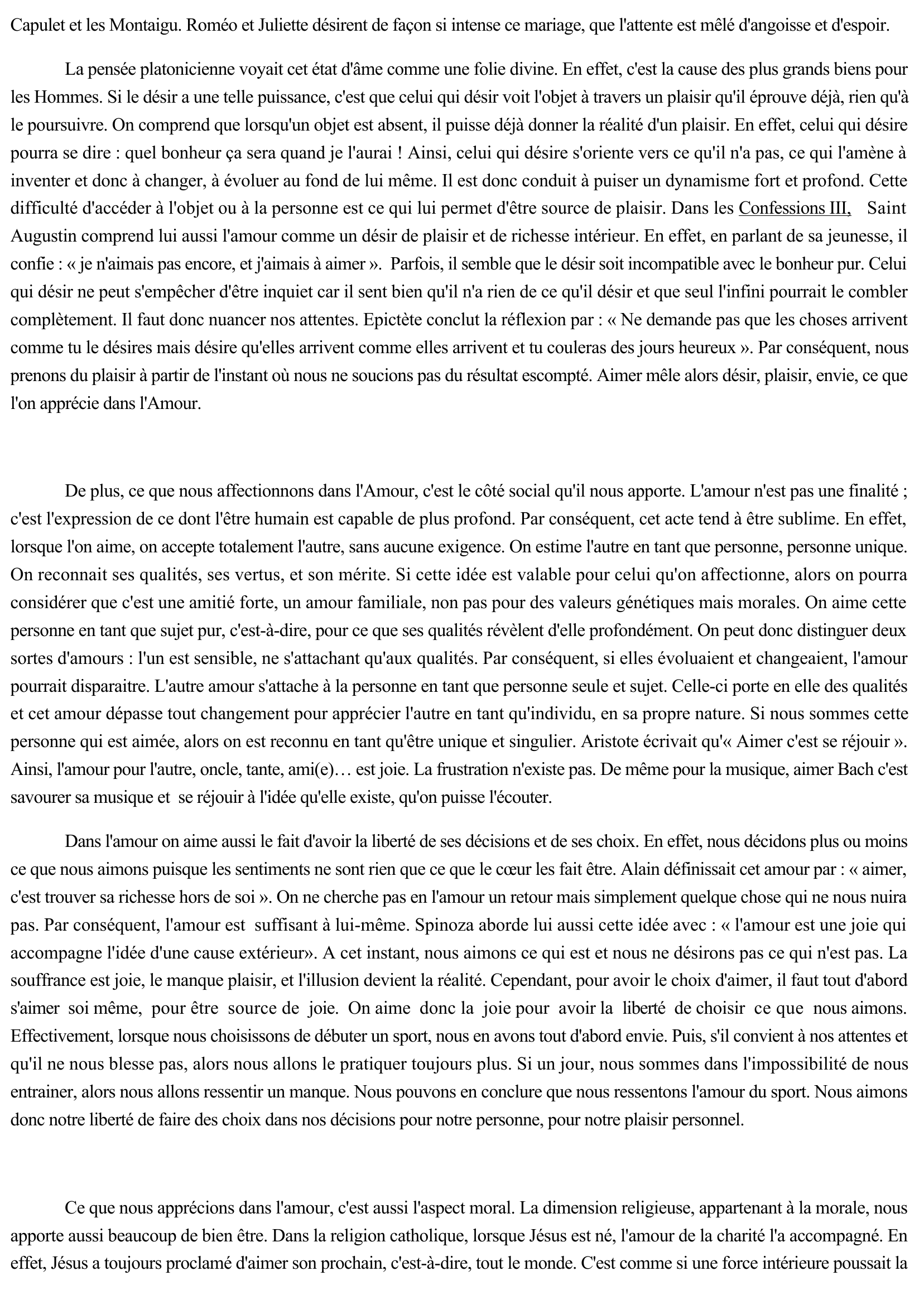Qu'aime-t-on dans l'Amour ?
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
Capulet et les Montaigu.
Roméo et Juliette désirent de façon si intense ce mariage, que l'attente est mêlé d'angoisse et d'espoir.
La pensée platonicienne voyait cet état d'âme comme une folie divine.
En effet, c'est la cause des plus grands biens pour
les Hommes.
Si le désir a une telle puissance, c'est que celui qui désir voit l'objet à travers un plaisir qu'il éprouve déjà, rien qu'à
le poursuivre.
On comprend que lorsqu'un objet est absent, il puisse déjà donner la réalité d'un plaisir.
En effet, celui qui désire
pourra se dire : quel bonheur ça sera quand je l'aurai ! Ainsi, celui qui désire s'oriente vers ce qu'il n'a pas, ce qui l'amène à
inventer et donc à changer, à évoluer au fond de lui même.
Il est donc conduit à puiser un dynamisme fort et profond.
Cette
difficulté d'accéder à l'objet ou à la personne est ce qui lui permet d'être source de plaisir.
Dans les Confessions III, Saint
Augustin comprend lui aussi l'amour comme un désir de plaisir et de richesse intérieur.
En effet, en parlant de sa jeunesse, il
confie : « je n'aimais pas encore, et j'aimais à aimer ».
Parfois, il semble que le désir soit incompatible avec le bonheur pur.
Celui
qui désir ne peut s'empêcher d'être inquiet car il sent bien qu'il n'a rien de ce qu'il désir et que seul l'infini pourrait le combler
complètement.
Il faut donc nuancer nos attentes.
Epictète conclut la réflexion par : « Ne demande pas que les choses arrivent
comme tu le désires mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu couleras des jours heureux ».
Par conséquent, nous
prenons du plaisir à partir de l'instant où nous ne soucions pas du résultat escompté.
Aimer mêle alors désir, plaisir, envie, ce que
l'on apprécie dans l'Amour.
De plus, ce que nous affectionnons dans l'Amour, c'est le côté social qu'il nous apporte.
L'amour n'est pas une finalité ;
c'est l'expression de ce dont l'être humain est capable de plus profond.
Par conséquent, cet acte tend à être sublime.
En effet,
lorsque l'on aime, on accepte totalement l'autre, sans aucune exigence.
On estime l'autre en tant que personne, personne unique.
On reconnait ses qualités, ses vertus, et son mérite.
Si cette idée est valable pour celui qu'on affectionne, alors on pourra
considérer que c'est une amitié forte, un amour familiale, non pas pour des valeurs génétiques mais morales.
On aime cette
personne en tant que sujet pur, c'est-à-dire, pour ce que ses qualités révèlent d'elle profondément.
On peut donc distinguer deux
sortes d'amours : l'un est sensible, ne s'attachant qu'aux qualités.
Par conséquent, si elles évoluaient et changeaient, l'amour
pourrait disparaitre.
L'autre amour s'attache à la personne en tant que personne seule et sujet.
Celle-ci porte en elle des qualités
et cet amour dépasse tout changement pour apprécier l'autre en tant qu'individu, en sa propre nature.
Si nous sommes cette
personne qui est aimée, alors on est reconnu en tant qu'être unique et singulier.
Aristote écrivait qu'« Aimer c'est se réjouir ».
Ainsi, l'amour pour l'autre, oncle, tante, ami(e)… est joie.
La frustration n'existe pas.
De même pour la musique, aimer Bach c'est
savourer sa musique et se réjouir à l'idée qu'elle existe, qu'on puisse l'écouter.
Dans l'amour on aime aussi le fait d'avoir la liberté de ses décisions et de ses choix.
En effet, nous décidons plus ou moins
ce que nous aimons puisque les sentiments ne sont rien que ce que le cœur les fait être.
Alain définissait cet amour par : « aimer,
c'est trouver sa richesse hors de soi ».
On ne cherche pas en l'amour un retour mais simplement quelque chose qui ne nous nuira
pas.
Par conséquent, l'amour est suffisant à lui-même.
Spinoza aborde lui aussi cette idée avec : « l'amour est une joie qui
accompagne l'idée d'une cause extérieur».
A cet instant, nous aimons ce qui est et nous ne désirons pas ce qui n'est pas.
La
souffrance est joie, le manque plaisir, et l'illusion devient la réalité.
Cependant, pour avoir le choix d'aimer, il faut tout d'abord
s'aimer soi même, pour être source de joie.
On aime donc la joie pour avoir la liberté de choisir ce que nous aimons.
Effectivement, lorsque nous choisissons de débuter un sport, nous en avons tout d'abord envie.
Puis, s'il convient à nos attentes et
qu'il ne nous blesse pas, alors nous allons le pratiquer toujours plus.
Si un jour, nous sommes dans l'impossibilité de nous
entrainer, alors nous allons ressentir un manque.
Nous pouvons en conclure que nous ressentons l'amour du sport.
Nous aimons
donc notre liberté de faire des choix dans nos décisions pour notre personne, pour notre plaisir personnel.
Ce que nous apprécions dans l'amour, c'est aussi l'aspect moral.
La dimension religieuse, appartenant à la morale, nous
apporte aussi beaucoup de bien être.
Dans la religion catholique, lorsque Jésus est né, l'amour de la charité l'a accompagné.
En
effet, Jésus a toujours proclamé d'aimer son prochain, c'est-à-dire, tout le monde.
C'est comme si une force intérieure poussait la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans tout amour n'aime-t-on jamais que soi-même ?
- Dans tout amour n'aime t-on jamais que soi même ?
- Dans tout amour n'aime t-on jamais que soi meme ?
- Expliquez et commentez ces affirmations d'Ernest Renan dans l'Avenir de la science : » L'homme ne communique avec les choses que par le savoir et par l'amour : sans la science, il n'aime que des chimères. La science seule fournit le fond de réalité nécessaire à la vie. » ?
- Expliquez, et s'il y a lieu discutez, cette pensée de Jean Guéhenno : «On ne juge jamais mieux qu'à vingt ans l'univers : on l'aime tel qu'il devrait être. Toute la sagesse, après, est à maintenir vivant en soi un tel amour. » (Journal d'un homme de quarante ans.) ?