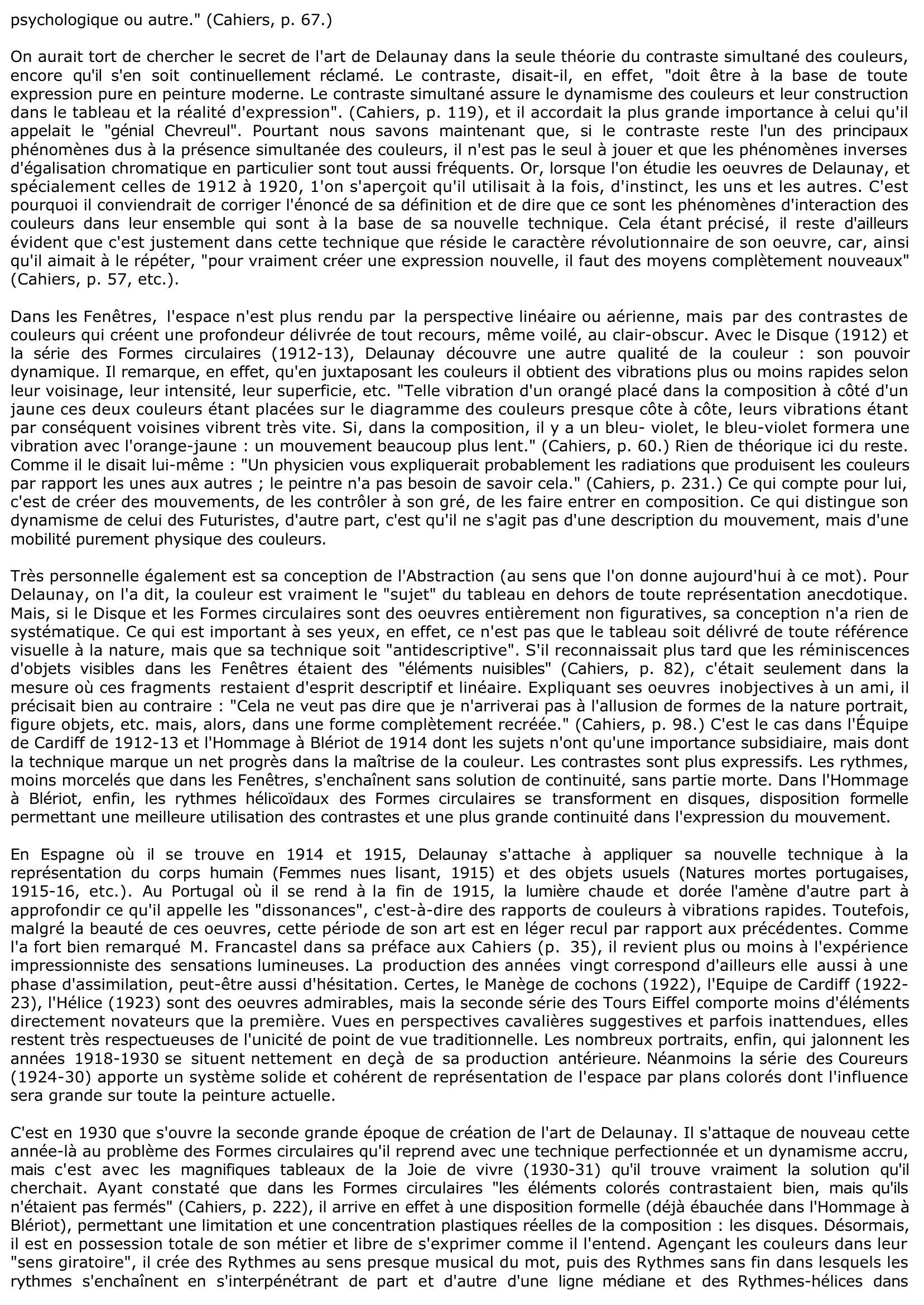Robert Delaunay
Publié le 26/02/2010

Extrait du document

Si la disparition de Robert Delaunay, mort prématurément en 1941 à l'âge de cinquante-six ans, passa presque inaperçue dans un monde bouleversé par des événements tragiques, sa réputation n'a cessé de grandir depuis la guerre au point que la plupart des historiens le considèrent aujourd'hui et à juste titre comme l'un des principaux artistes du XXe siècle. Son aventure esthétique nui devait le mener de Cézanne au Cubisme, puis à l'Abstraction dont il fut l'un des pionniers, est d'ailleurs l'une des plus représentatives de l'évolution de l'art contemporain. Comme presque tous les peintres de sa génération, ses premiers débuts se ressentirent de l'Impressionnisme, puis en 1905, lors d'un séjour en Bretagne, il adopta pendant un temps un chromatisme sourd et saturé, inspiré de la période bretonne de Gauguin. L'année suivante, il subit une forte influence du Néo-Impressionnisme auquel il emprunta le principe de la touche divisée sans retenir toutefois celui du mélange optique, ce qui donne aux oeuvres de cette époque une facture en petits pavés caractéristique et déjà très personnelle. Mais c'est la leçon de Cézanne qui devait donner vers 1909 l'impulsion décisive à son esprit créateur.

«
psychologique ou autre." (Cahiers, p.
67.)
On aurait tort de chercher le secret de l'art de Delaunay dans la seule théorie du contraste simultané des couleurs,encore qu'il s'en soit continuellement réclamé.
Le contraste, disait-il, en effet, "doit être à la base de touteexpression pure en peinture moderne.
Le contraste simultané assure le dynamisme des couleurs et leur constructiondans le tableau et la réalité d'expression".
(Cahiers, p.
119), et il accordait la plus grande importance à celui qu'ilappelait le "génial Chevreul".
Pourtant nous savons maintenant que, si le contraste reste l'un des principauxphénomènes dus à la présence simultanée des couleurs, il n'est pas le seul à jouer et que les phénomènes inversesd'égalisation chromatique en particulier sont tout aussi fréquents.
Or, lorsque l'on étudie les oeuvres de Delaunay, etspécialement celles de 1912 à 1920, 1'on s'aperçoit qu'il utilisait à la fois, d'instinct, les uns et les autres.
C'estpourquoi il conviendrait de corriger l'énoncé de sa définition et de dire que ce sont les phénomènes d'interaction descouleurs dans leur ensemble qui sont à la base de sa nouvelle technique.
Cela étant précisé, il reste d'ailleursévident que c'est justement dans cette technique que réside le caractère révolutionnaire de son oeuvre, car, ainsiqu'il aimait à le répéter, "pour vraiment créer une expression nouvelle, il faut des moyens complètement nouveaux"(Cahiers, p.
57, etc.).
Dans les Fenêtres, l'espace n'est plus rendu par la perspective linéaire ou aérienne, mais par des contrastes decouleurs qui créent une profondeur délivrée de tout recours, même voilé, au clair-obscur.
Avec le Disque (1912) etla série des Formes circulaires (1912-13), Delaunay découvre une autre qualité de la couleur : son pouvoirdynamique.
Il remarque, en effet, qu'en juxtaposant les couleurs il obtient des vibrations plus ou moins rapides selonleur voisinage, leur intensité, leur superficie, etc.
"Telle vibration d'un orangé placé dans la composition à côté d'unjaune ces deux couleurs étant placées sur le diagramme des couleurs presque côte à côte, leurs vibrations étantpar conséquent voisines vibrent très vite.
Si, dans la composition, il y a un bleu- violet, le bleu-violet formera unevibration avec l'orange-jaune : un mouvement beaucoup plus lent." (Cahiers, p.
60.) Rien de théorique ici du reste.Comme il le disait lui-même : "Un physicien vous expliquerait probablement les radiations que produisent les couleurspar rapport les unes aux autres ; le peintre n'a pas besoin de savoir cela." (Cahiers, p.
231.) Ce qui compte pour lui,c'est de créer des mouvements, de les contrôler à son gré, de les faire entrer en composition.
Ce qui distingue sondynamisme de celui des Futuristes, d'autre part, c'est qu'il ne s'agit pas d'une description du mouvement, mais d'unemobilité purement physique des couleurs.
Très personnelle également est sa conception de l'Abstraction (au sens que l'on donne aujourd'hui à ce mot).
PourDelaunay, on l'a dit, la couleur est vraiment le "sujet" du tableau en dehors de toute représentation anecdotique.Mais, si le Disque et les Formes circulaires sont des oeuvres entièrement non figuratives, sa conception n'a rien desystématique.
Ce qui est important à ses yeux, en effet, ce n'est pas que le tableau soit délivré de toute référencevisuelle à la nature, mais que sa technique soit "antidescriptive".
S'il reconnaissait plus tard que les réminiscencesd'objets visibles dans les Fenêtres étaient des "éléments nuisibles" (Cahiers, p.
82), c'était seulement dans lamesure où ces fragments restaient d'esprit descriptif et linéaire.
Expliquant ses oeuvres inobjectives à un ami, ilprécisait bien au contraire : "Cela ne veut pas dire que je n'arriverai pas à l'allusion de formes de la nature portrait,figure objets, etc.
mais, alors, dans une forme complètement recréée." (Cahiers, p.
98.) C'est le cas dans l'Équipede Cardiff de 1912-13 et l'Hommage à Blériot de 1914 dont les sujets n'ont qu'une importance subsidiaire, mais dontla technique marque un net progrès dans la maîtrise de la couleur.
Les contrastes sont plus expressifs.
Les rythmes,moins morcelés que dans les Fenêtres, s'enchaînent sans solution de continuité, sans partie morte.
Dans l'Hommageà Blériot, enfin, les rythmes hélicoïdaux des Formes circulaires se transforment en disques, disposition formellepermettant une meilleure utilisation des contrastes et une plus grande continuité dans l'expression du mouvement.
En Espagne où il se trouve en 1914 et 1915, Delaunay s'attache à appliquer sa nouvelle technique à lareprésentation du corps humain (Femmes nues lisant, 1915) et des objets usuels (Natures mortes portugaises,1915-16, etc.).
Au Portugal où il se rend à la fin de 1915, la lumière chaude et dorée l'amène d'autre part àapprofondir ce qu'il appelle les "dissonances", c'est-à-dire des rapports de couleurs à vibrations rapides.
Toutefois,malgré la beauté de ces oeuvres, cette période de son art est en léger recul par rapport aux précédentes.
Commel'a fort bien remarqué M.
Francastel dans sa préface aux Cahiers (p.
35), il revient plus ou moins à l'expérienceimpressionniste des sensations lumineuses.
La production des années vingt correspond d'ailleurs elle aussi à unephase d'assimilation, peut-être aussi d'hésitation.
Certes, le Manège de cochons (1922), l'Equipe de Cardiff (1922-23), l'Hélice (1923) sont des oeuvres admirables, mais la seconde série des Tours Eiffel comporte moins d'élémentsdirectement novateurs que la première.
Vues en perspectives cavalières suggestives et parfois inattendues, ellesrestent très respectueuses de l'unicité de point de vue traditionnelle.
Les nombreux portraits, enfin, qui jalonnent lesannées 1918-1930 se situent nettement en deçà de sa production antérieure.
Néanmoins la série des Coureurs(1924-30) apporte un système solide et cohérent de représentation de l'espace par plans colorés dont l'influencesera grande sur toute la peinture actuelle.
C'est en 1930 que s'ouvre la seconde grande époque de création de l'art de Delaunay.
Il s'attaque de nouveau cetteannée-là au problème des Formes circulaires qu'il reprend avec une technique perfectionnée et un dynamisme accru,mais c'est avec les magnifiques tableaux de la Joie de vivre (1930-31) qu'il trouve vraiment la solution qu'ilcherchait.
Ayant constaté que dans les Formes circulaires "les éléments colorés contrastaient bien, mais qu'ilsn'étaient pas fermés" (Cahiers, p.
222), il arrive en effet à une disposition formelle (déjà ébauchée dans l'Hommage àBlériot), permettant une limitation et une concentration plastiques réelles de la composition : les disques.
Désormais,il est en possession totale de son métier et libre de s'exprimer comme il l'entend.
Agençant les couleurs dans leur"sens giratoire", il crée des Rythmes au sens presque musical du mot, puis des Rythmes sans fin dans lesquels lesrythmes s'enchaînent en s'interpénétrant de part et d'autre d'une ligne médiane et des Rythmes-hélices dans.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Delaunay Robert Peintre français
- Delaunay Robert
- Robert Delaunay 1885-1941 Manège de cochons
- Delaunay Robert
- Delaunay, Robert - vie et oeuvre du peintre.