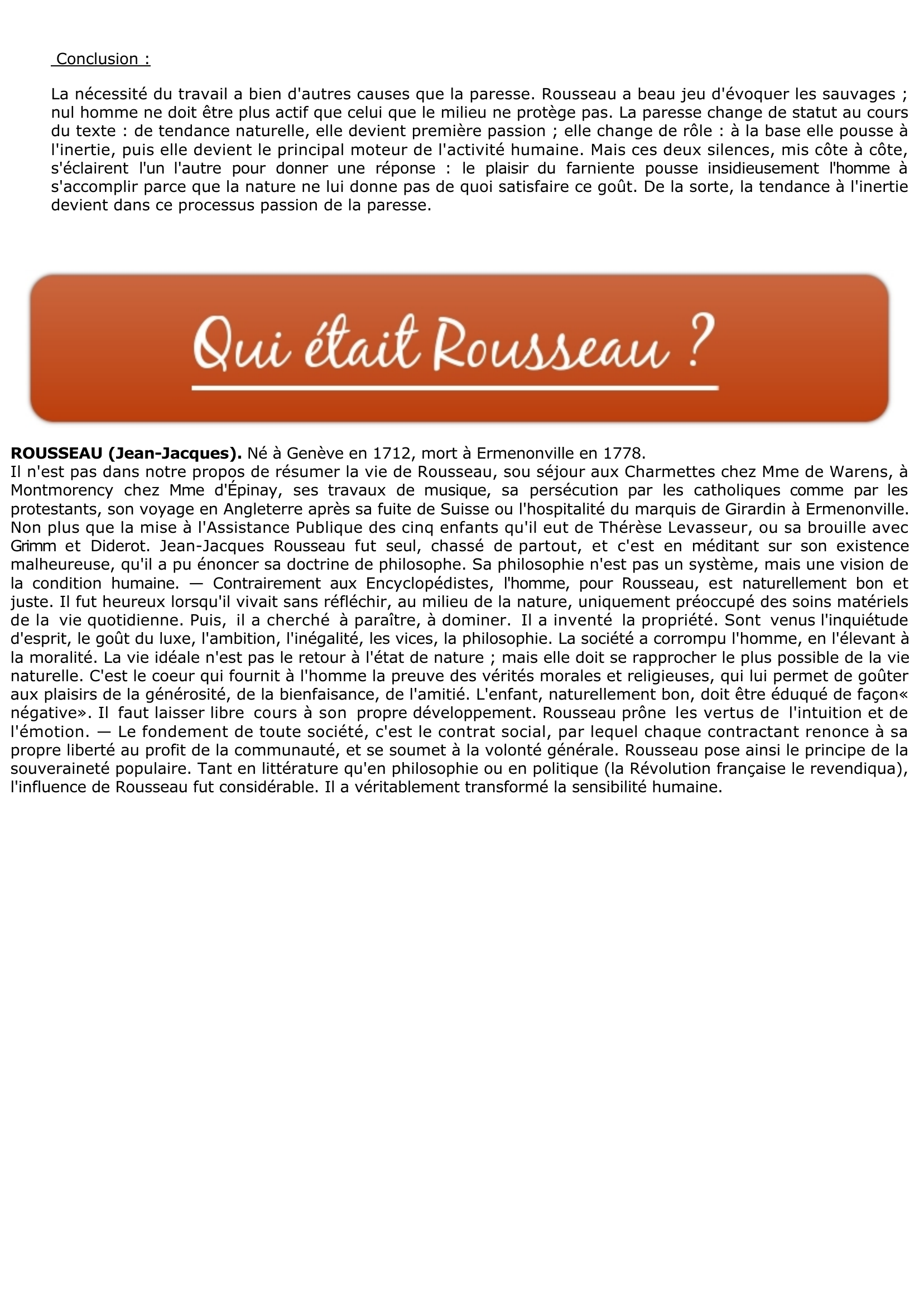Rousseau: Travail et repos
Publié le 27/02/2008

Extrait du document

Ce texte nous amène à nous demander si l’homme est fait pour le travail. Rousseau nous dit qu’il est "naturellement paresseux", - et c'est peut - être là l'une des premières caractéristiques de l'humanité : aucune espèce animale ne peut survivre sans consentir des efforts constants pour se maintenir dans son milieu naturel. L'homme reste naturellement au repos et il y prend du plaisir (première phrase). Une fois ce constat établi, Rousseau oppose à cet homme indolent, et qui n’est pas encore dans un état social mais dans un état de nature, un homme agité par des passions sociales qui le poussent sans cesse vers l’avant, au-delà de lui-même (phrases 2 et 3). Enfin, il avance le paradoxe selon lequel l’homme ne consent à travailler que pour mieux contenter sa paresse naturelle (reste du texte).

«
Conclusion :
La nécessité du travail a bien d'autres causes que la paresse.
Rousseau a beau jeu d'évoquer les sauvages ;nul homme ne doit être plus actif que celui que le milieu ne protège pas.
La paresse change de statut au coursdu texte : de tendance naturelle, elle devient première passion ; elle change de rôle : à la base elle pousse àl'inertie, puis elle devient le principal moteur de l'activité humaine.
Mais ces deux silences, mis côte à côte,s'éclairent l'un l'autre pour donner une réponse : le plaisir du farniente pousse insidieusement l'homme às'accomplir parce que la nature ne lui donne pas de quoi satisfaire ce goût.
De la sorte, la tendance à l'inertiedevient dans ce processus passion de la paresse.
ROUSSEAU (Jean-Jacques). Né à Genève en 1712, mort à Ermenonville en 1778. Il n'est pas dans notre propos de résumer la vie de Rousseau, sou séjour aux Charmettes chez Mme de Warens, àMontmorency chez Mme d'Épinay, ses travaux de musique, sa persécution par les catholiques comme par lesprotestants, son voyage en Angleterre après sa fuite de Suisse ou l'hospitalité du marquis de Girardin à Ermenonville.Non plus que la mise à l'Assistance Publique des cinq enfants qu'il eut de Thérèse Levasseur, ou sa brouille avecGrimm et Diderot.
Jean-Jacques Rousseau fut seul, chassé de partout, et c'est en méditant sur son existencemalheureuse, qu'il a pu énoncer sa doctrine de philosophe.
Sa philosophie n'est pas un système, mais une vision dela condition humaine.
— Contrairement aux Encyclopédistes, l'homme, pour Rousseau, est naturellement bon etjuste.
Il fut heureux lorsqu'il vivait sans réfléchir, au milieu de la nature, uniquement préoccupé des soins matérielsde la vie quotidienne.
Puis, il a cherché à paraître, à dominer.
Il a inventé la propriété.
Sont venus l'inquiétuded'esprit, le goût du luxe, l'ambition, l'inégalité, les vices, la philosophie.
La société a corrompu l'homme, en l'élevant àla moralité.
La vie idéale n'est pas le retour à l'état de nature ; mais elle doit se rapprocher le plus possible de la vienaturelle.
C'est le coeur qui fournit à l'homme la preuve des vérités morales et religieuses, qui lui permet de goûteraux plaisirs de la générosité, de la bienfaisance, de l'amitié.
L'enfant, naturellement bon, doit être éduqué de façon«négative».
Il faut laisser libre cours à son propre développement.
Rousseau prône les vertus de l'intuition et del'émotion.
— Le fondement de toute société, c'est le contrat social, par lequel chaque contractant renonce à sapropre liberté au profit de la communauté, et se soumet à la volonté générale.
Rousseau pose ainsi le principe de lasouveraineté populaire.
Tant en littérature qu'en philosophie ou en politique (la Révolution française le revendiqua),l'influence de Rousseau fut considérable.
Il a véritablement transformé la sensibilité humaine..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans son essai Croissance zéro, Alfred Sauvy écrit, à propos de la fascination qu'exerce sur l'homme l'idée du retour à la nature : « ... L'idée séduisante de retour à l'état naturel, à une vie végétale, ne dure guère qu'un été et d'une façon très relative. Virgile s'extasiait devant les gémissements des boeufs, mais avait des esclaves pour traire ses vaches. Rousseau fut fort aise de trouver une assistance publique pour élever ses enfants. Quant à Diogene, il devait bien produire quel
- J'y serais parvenu peut-être, si la brutalité de mon maître et la gêne excessive ne m'avaient rebuté du travail. Jean-Jacques Rousseau, les Confessions, ABU, la Bibliothèque universelle
- Après deux ou trois mois de ce beau travail et d'efforts inimaginables, je vais au café, maigre, jaune, et presque hébété. Jean-Jacques Rousseau, les Confessions
- ROUSSEAU: «Mais dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire, et les vastes forêt
- Un poète anglais a dit : Tout travail accompli, et même tout travail entrepris seulement, a mérité le repos de la nuit. - Commentez cette pensée.