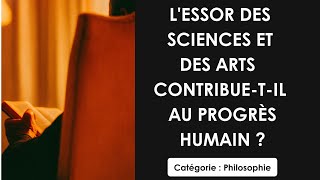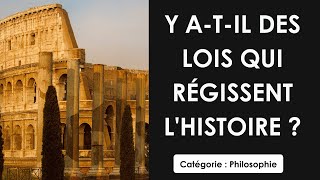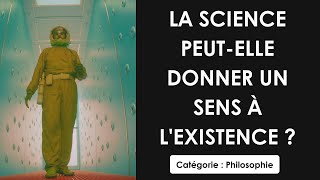Sur quoi se fonde notre responsabilité morale ?
Publié le 30/08/2012

Extrait du document

a) Etre son propre législateur, c’est obéir à la règle qu’on se prescrit : c’est la définition de l’autonomie. Cela signifie que le sujet moral peut opposer ses propres lois aux lois sociales, au nom de sa responsabilité propre (on parlera alors d’objection de conscience). b) Etre son propre juge, c’est s’observer, chercher scrupuleusement les motivations, les intentions premières de ses actions. Comme le juge, la conscience ne se laisse pas prendre par les apparences immédiates, elle se méfie de la « bonne conscience « (on pourra parler d’examen de conscience). c) Etre son propre gouvernement signifie qu’on doit assumer les décisions du tribunal, et en particulier récompenser et punir. La punition morale prend la forme essentielle du remords (on parlera alors de mauvaise conscience). Ainsi se définie par la conscience morale, la responsabilité n’est plus seulement un poids, c’est aussi une revendication : prendre en charge sa propre existence, s’engager dans un projet. Elle n’est plus seulement juridique ou éthique, elle devient métaphysique.
Liens utiles
- La morale se fonde-t-elle sur des lois naturelles ou des conventions sociales ?
- La société fonde-t-elle la morale ?
- Est-ce la morale qui fonde la liberté ou la liberté qui fonde la morale ?
- L'exigence de la responsabilité morale prouve-t-elle l'existence de la liberté ?
- Sur quoi ma conscience morale fonde-t-elle sa légitimité ?