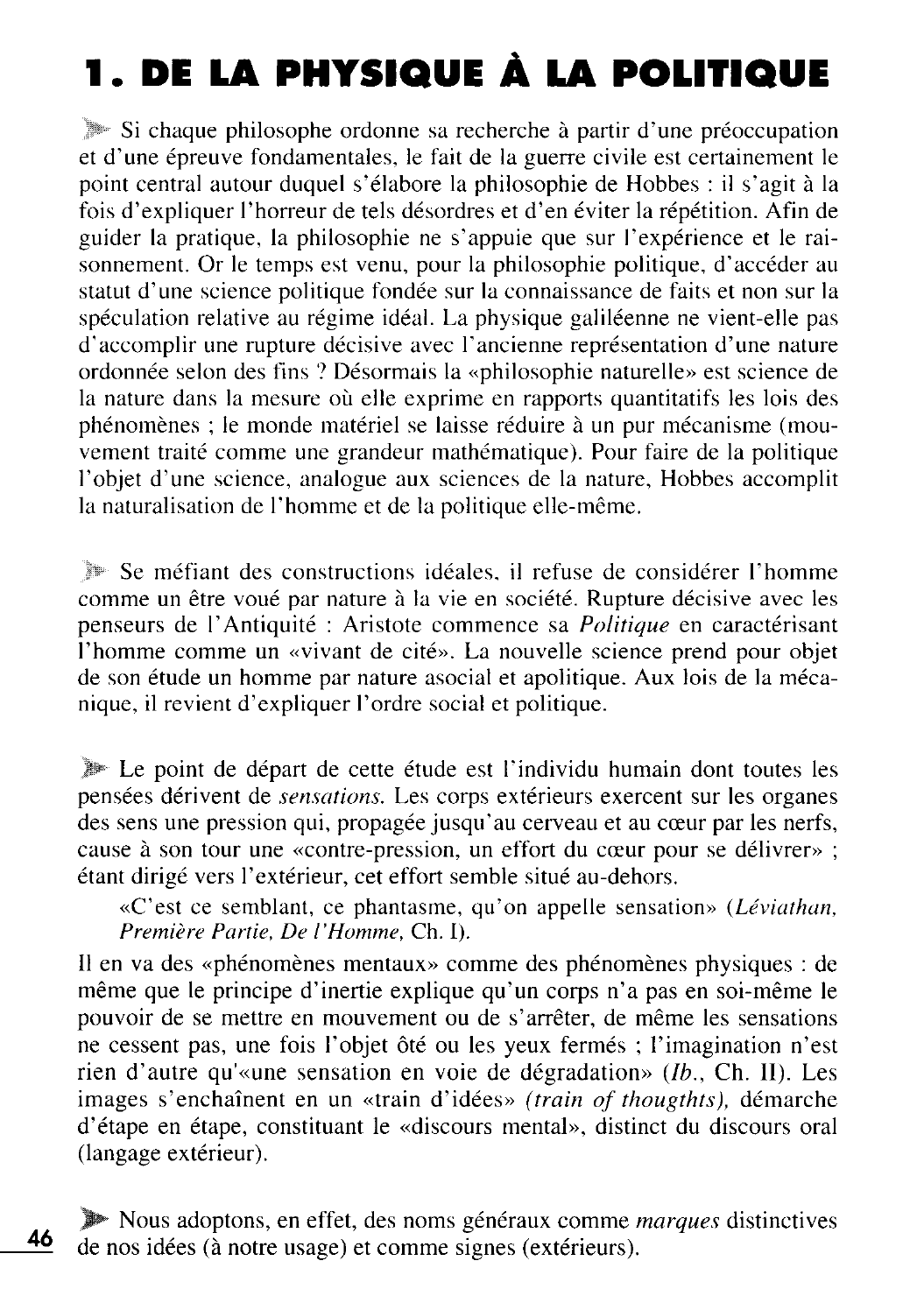THOMAS HOBBES
Publié le 14/06/2011

Extrait du document
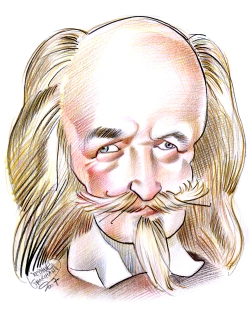
THOMAS HOBBES (1588-1679). — L'oeuvre du philosophe Hobbes intéresse l'histoire des idées plutôt que l'histoire littéraire. Mais un de ses ouvrages au moins, LEVIATHAN (1651), eut un certain retentissement dans le grand public. Il inquiéta les royalistes, qui lui reprochèrent d'encourager la dictature, par sa conception pessimiste d'une humanité naturellement méchante ou médiocre, qui doit être soumise à une autorité vigoureuse. Et les puritains lui reprochèrent de leur côté de vouloir soumettre même les sectes religieuses à la toute-puissance de l'État. Le style de Hobbes est formé sur celui de Bacon, mais il est plus dépouillé et atteint parfois une très nette et puissante sobriété.
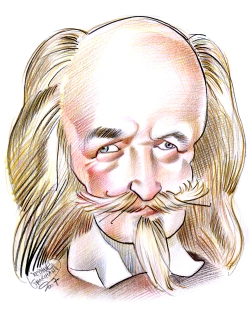
«
46
1 • DE LA PHYSIQUE À LA POLITIQUE
Si chaque philosophe ordonne sa recherche à partir d'une préoccupation
et
d'une épreuve fondamentales, le fait de la guerre civile est certainement le
point central autour duquel s'élabore la philosophie de Hobbes: il s'agit à la
fois d'expliquer l'horreur de tels désordres et
d'en éviter la répétition.
Afin de
guider la pratique, la philosophie
ne s'appuie que sur l'expérience et le rai
sonnement.
Or le temps est venu, pour la philosophie politique.
d'accéder au
statut
d'une science politique fondée sur la connaissance de faits et non sur la
spéculation relative au régime idéal.
La physique galiléenne ne vient-elle pas
d'accomplir une rupture décisive avec l'ancienne représentation
d'une nature
ordonnée selon des fins
? Désormais la est science de
la nature dans la mesure où elle exprime en rapports quantitatifs les lois des
phénomènes
; le monde matériel se laisse réduire à un pur mécanisme (mou
vement traité comme une grandeur mathématique).
Pour faire de la politique
l'objet
d'une science, analogue aux sciences de la nature, Hobbes accomplit
la naturalisation de l'homme et de la politique elle-même.
Se méfiant des constructions idéales.
il refuse de considérer l'homme
comme un être voué par nature à la vie en société.
Rupture décisive avec les
penseurs de
1' Antiquité : Aristote commence sa Politique en caractérisant
l'homme comme un «Vivant de cité>>.
La nouvelle science prend pour objet
de son étude un homme par nature asocial et apolitique.
Aux lois de la méca
nique,
il revient d'expliquer l'ordre social et politique.
Le point de départ de cette étude est l'individu humain dont toutes les
pensées dérivent de
sensations.
Les corps extérieurs exercent sur les organes
des sens une pression qui, propagée
jusqu'au cerveau et au cœur par les nerfs,
cause
à son tour une «contre-pression, un effort du cœur pour se délivrer>> ;
étant dirigé vers 1' extérieur, cet effort semble situé au-dehors.
«C'est ce semblant, ce phantasme, qu'on appelle sensation>> (Léviathan,
Première Partie, De l'Homme,
Ch.
1).
Il en va des «phénomènes mentaux>> comme des phénomènes physiques : de
même que
le principe d'inertie explique qu'un corps n'a pas en soi-même le
pouvoir de se mettre en mouvement ou de s'arrêter, de même les sensations
ne cessent pas, une fois l'objet ôté ou les yeux fermés
; l'imagination n'est
rien d'autre qu'«une sensation en voie de dégradation>> (lb., Ch.
Il).
Les
images
s'enchaînent en un «train d'idées>> (train of thougthts), démarche
d'étape en étape, constituant le
«discours mental>>, distinct du discours oral
(langage extérieur).
Nous adoptons, en effet, des noms généraux comme
marques distinctives
de nos idées
(à notre usage) et comme signes (extérieurs)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CORPS (DU), De corpore, 1655. Thomas Hobbes (résumé et analyse)
- LE LÉVIATHAN DE THOMAS HOBBES
- CORPS (Du) [De corpore] de Thomas Hobbes
- ÉLÉMENTS PHILOSOPHIQUES DU CITOYEN de Thomas Hobbes (résumé)
- HOMME (DE L’), De homine, 1658. Thomas Hobbes - étude de l'œuvre