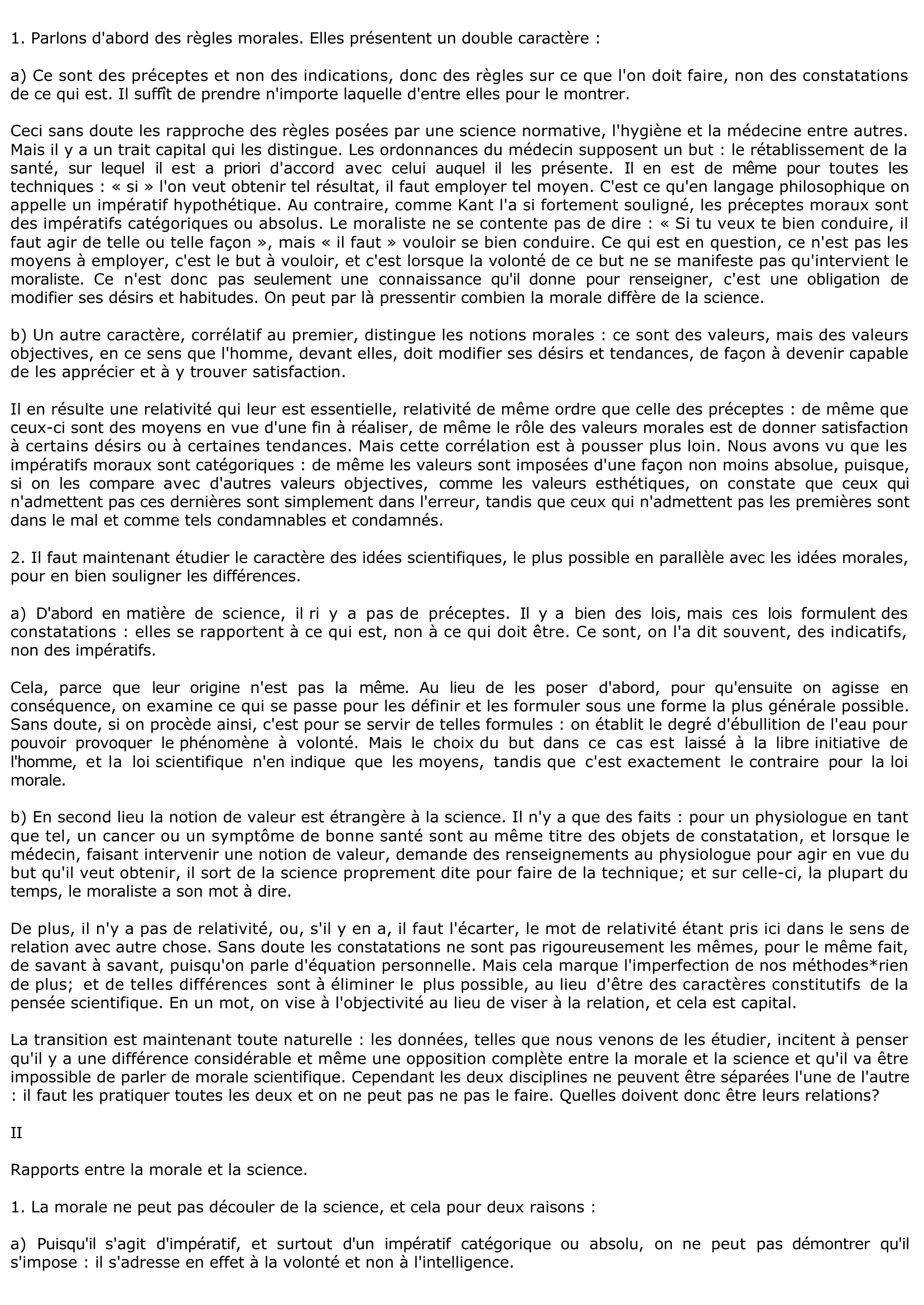Une morale peut-elle être scientifique ?
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
1.
Parlons d'abord des règles morales.
Elles présentent un double caractère :
a) Ce sont des préceptes et non des indications, donc des règles sur ce que l'on doit faire, non des constatationsde ce qui est.
Il suffît de prendre n'importe laquelle d'entre elles pour le montrer.
Ceci sans doute les rapproche des règles posées par une science normative, l'hygiène et la médecine entre autres.Mais il y a un trait capital qui les distingue.
Les ordonnances du médecin supposent un but : le rétablissement de lasanté, sur lequel il est a priori d'accord avec celui auquel il les présente.
Il en est de même pour toutes lestechniques : « si » l'on veut obtenir tel résultat, il faut employer tel moyen.
C'est ce qu'en langage philosophique onappelle un impératif hypothétique.
Au contraire, comme Kant l'a si fortement souligné, les préceptes moraux sontdes impératifs catégoriques ou absolus.
Le moraliste ne se contente pas de dire : « Si tu veux te bien conduire, ilfaut agir de telle ou telle façon », mais « il faut » vouloir se bien conduire.
Ce qui est en question, ce n'est pas lesmoyens à employer, c'est le but à vouloir, et c'est lorsque la volonté de ce but ne se manifeste pas qu'intervient lemoraliste.
Ce n'est donc pas seulement une connaissance qu'il donne pour renseigner, c'est une obligation demodifier ses désirs et habitudes.
On peut par là pressentir combien la morale diffère de la science.
b) Un autre caractère, corrélatif au premier, distingue les notions morales : ce sont des valeurs, mais des valeursobjectives, en ce sens que l'homme, devant elles, doit modifier ses désirs et tendances, de façon à devenir capablede les apprécier et à y trouver satisfaction.
Il en résulte une relativité qui leur est essentielle, relativité de même ordre que celle des préceptes : de même queceux-ci sont des moyens en vue d'une fin à réaliser, de même le rôle des valeurs morales est de donner satisfactionà certains désirs ou à certaines tendances.
Mais cette corrélation est à pousser plus loin.
Nous avons vu que lesimpératifs moraux sont catégoriques : de même les valeurs sont imposées d'une façon non moins absolue, puisque,si on les compare avec d'autres valeurs objectives, comme les valeurs esthétiques, on constate que ceux quin'admettent pas ces dernières sont simplement dans l'erreur, tandis que ceux qui n'admettent pas les premières sontdans le mal et comme tels condamnables et condamnés.
2.
Il faut maintenant étudier le caractère des idées scientifiques, le plus possible en parallèle avec les idées morales,pour en bien souligner les différences.
a) D'abord en matière de science, il ri y a pas de préceptes.
Il y a bien des lois, mais ces lois formulent desconstatations : elles se rapportent à ce qui est, non à ce qui doit être.
Ce sont, on l'a dit souvent, des indicatifs,non des impératifs.
Cela, parce que leur origine n'est pas la même.
Au lieu de les poser d'abord, pour qu'ensuite on agisse enconséquence, on examine ce qui se passe pour les définir et les formuler sous une forme la plus générale possible.Sans doute, si on procède ainsi, c'est pour se servir de telles formules : on établit le degré d'ébullition de l'eau pourpouvoir provoquer le phénomène à volonté.
Mais le choix du but dans ce cas est laissé à la libre initiative del'homme, et la loi scientifique n'en indique que les moyens, tandis que c'est exactement le contraire pour la loimorale.
b) En second lieu la notion de valeur est étrangère à la science.
Il n'y a que des faits : pour un physiologue en tantque tel, un cancer ou un symptôme de bonne santé sont au même titre des objets de constatation, et lorsque lemédecin, faisant intervenir une notion de valeur, demande des renseignements au physiologue pour agir en vue dubut qu'il veut obtenir, il sort de la science proprement dite pour faire de la technique; et sur celle-ci, la plupart dutemps, le moraliste a son mot à dire.
De plus, il n'y a pas de relativité, ou, s'il y en a, il faut l'écarter, le mot de relativité étant pris ici dans le sens derelation avec autre chose.
Sans doute les constatations ne sont pas rigoureusement les mêmes, pour le même fait,de savant à savant, puisqu'on parle d'équation personnelle.
Mais cela marque l'imperfection de nos méthodes*riende plus; et de telles différences sont à éliminer le plus possible, au lieu d'être des caractères constitutifs de lapensée scientifique.
En un mot, on vise à l'objectivité au lieu de viser à la relation, et cela est capital.
La transition est maintenant toute naturelle : les données, telles que nous venons de les étudier, incitent à penserqu'il y a une différence considérable et même une opposition complète entre la morale et la science et qu'il va êtreimpossible de parler de morale scientifique.
Cependant les deux disciplines ne peuvent être séparées l'une de l'autre: il faut les pratiquer toutes les deux et on ne peut pas ne pas le faire.
Quelles doivent donc être leurs relations?
II
Rapports entre la morale et la science.
1.
La morale ne peut pas découler de la science, et cela pour deux raisons :
a) Puisqu'il s'agit d'impératif, et surtout d'un impératif catégorique ou absolu, on ne peut pas démontrer qu'ils'impose : il s'adresse en effet à la volonté et non à l'intelligence..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on attribuer à la connaissance scientifique une valeur morale ? PLAN
- Commentez ce mot de H. Poincaré : Il ne peut pas plus y avoir de science morale qu'il ne peut y avoir de morale scientifique.
- Loi scientifique et loi morale.
- Une morale peut-elle être scientifique? La science suffit-elle à diriger l'action?
- L'expérience en morale. Comparaison avec l'expérience scientifique.