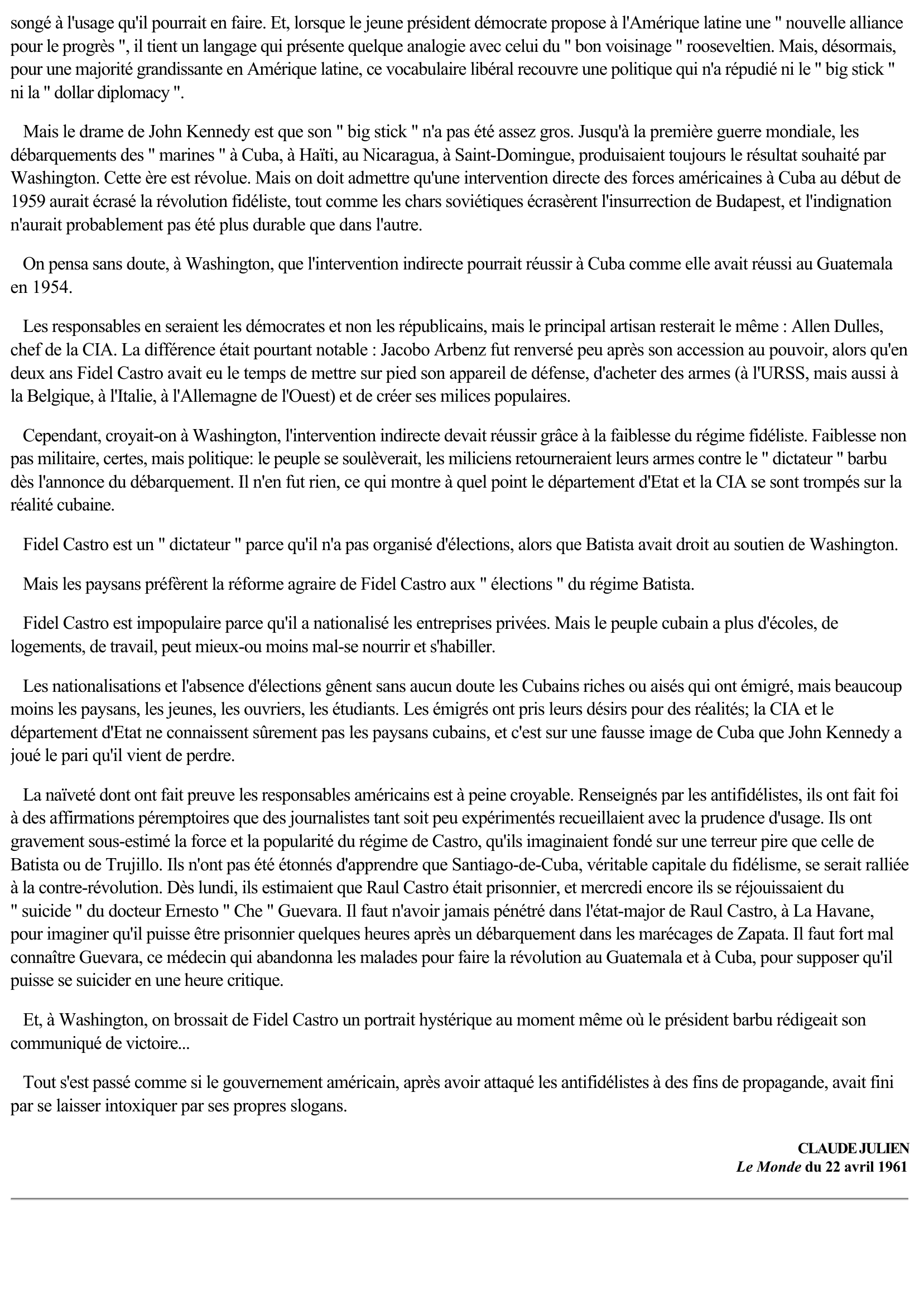Article de presse: La déroute de la baie des Cochons
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
«
songé à l'usage qu'il pourrait en faire.
Et, lorsque le jeune président démocrate propose à l'Amérique latine une " nouvelle alliancepour le progrès ", il tient un langage qui présente quelque analogie avec celui du " bon voisinage " rooseveltien.
Mais, désormais,pour une majorité grandissante en Amérique latine, ce vocabulaire libéral recouvre une politique qui n'a répudié ni le " big stick "ni la " dollar diplomacy ".
Mais le drame de John Kennedy est que son " big stick " n'a pas été assez gros.
Jusqu'à la première guerre mondiale, lesdébarquements des " marines " à Cuba, à Haïti, au Nicaragua, à Saint-Domingue, produisaient toujours le résultat souhaité parWashington.
Cette ère est révolue.
Mais on doit admettre qu'une intervention directe des forces américaines à Cuba au début de1959 aurait écrasé la révolution fidéliste, tout comme les chars soviétiques écrasèrent l'insurrection de Budapest, et l'indignationn'aurait probablement pas été plus durable que dans l'autre.
On pensa sans doute, à Washington, que l'intervention indirecte pourrait réussir à Cuba comme elle avait réussi au Guatemalaen 1954.
Les responsables en seraient les démocrates et non les républicains, mais le principal artisan resterait le même : Allen Dulles,chef de la CIA.
La différence était pourtant notable : Jacobo Arbenz fut renversé peu après son accession au pouvoir, alors qu'endeux ans Fidel Castro avait eu le temps de mettre sur pied son appareil de défense, d'acheter des armes (à l'URSS, mais aussi àla Belgique, à l'Italie, à l'Allemagne de l'Ouest) et de créer ses milices populaires.
Cependant, croyait-on à Washington, l'intervention indirecte devait réussir grâce à la faiblesse du régime fidéliste.
Faiblesse nonpas militaire, certes, mais politique: le peuple se soulèverait, les miliciens retourneraient leurs armes contre le " dictateur " barbudès l'annonce du débarquement.
Il n'en fut rien, ce qui montre à quel point le département d'Etat et la CIA se sont trompés sur laréalité cubaine.
Fidel Castro est un " dictateur " parce qu'il n'a pas organisé d'élections, alors que Batista avait droit au soutien de Washington.
Mais les paysans préfèrent la réforme agraire de Fidel Castro aux " élections " du régime Batista.
Fidel Castro est impopulaire parce qu'il a nationalisé les entreprises privées.
Mais le peuple cubain a plus d'écoles, delogements, de travail, peut mieux-ou moins mal-se nourrir et s'habiller.
Les nationalisations et l'absence d'élections gênent sans aucun doute les Cubains riches ou aisés qui ont émigré, mais beaucoupmoins les paysans, les jeunes, les ouvriers, les étudiants.
Les émigrés ont pris leurs désirs pour des réalités; la CIA et ledépartement d'Etat ne connaissent sûrement pas les paysans cubains, et c'est sur une fausse image de Cuba que John Kennedy ajoué le pari qu'il vient de perdre.
La naïveté dont ont fait preuve les responsables américains est à peine croyable.
Renseignés par les antifidélistes, ils ont fait foià des affirmations péremptoires que des journalistes tant soit peu expérimentés recueillaient avec la prudence d'usage.
Ils ontgravement sous-estimé la force et la popularité du régime de Castro, qu'ils imaginaient fondé sur une terreur pire que celle deBatista ou de Trujillo.
Ils n'ont pas été étonnés d'apprendre que Santiago-de-Cuba, véritable capitale du fidélisme, se serait ralliéeà la contre-révolution.
Dès lundi, ils estimaient que Raul Castro était prisonnier, et mercredi encore ils se réjouissaient du" suicide " du docteur Ernesto " Che " Guevara.
Il faut n'avoir jamais pénétré dans l'état-major de Raul Castro, à La Havane,pour imaginer qu'il puisse être prisonnier quelques heures après un débarquement dans les marécages de Zapata.
Il faut fort malconnaître Guevara, ce médecin qui abandonna les malades pour faire la révolution au Guatemala et à Cuba, pour supposer qu'ilpuisse se suicider en une heure critique.
Et, à Washington, on brossait de Fidel Castro un portrait hystérique au moment même où le président barbu rédigeait soncommuniqué de victoire...
Tout s'est passé comme si le gouvernement américain, après avoir attaqué les antifidélistes à des fins de propagande, avait finipar se laisser intoxiquer par ses propres slogans.
CLAUDE JULIEN Le Monde du 22 avril 1961.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Comment rédiger un article de presse
- Article de presse en Anglais Film Pokemon 1
- Cochons (baie des).
- Invasion de la baie des Cochons
- Rapport de la CIA sur l'invasion de la baie des Cochons.