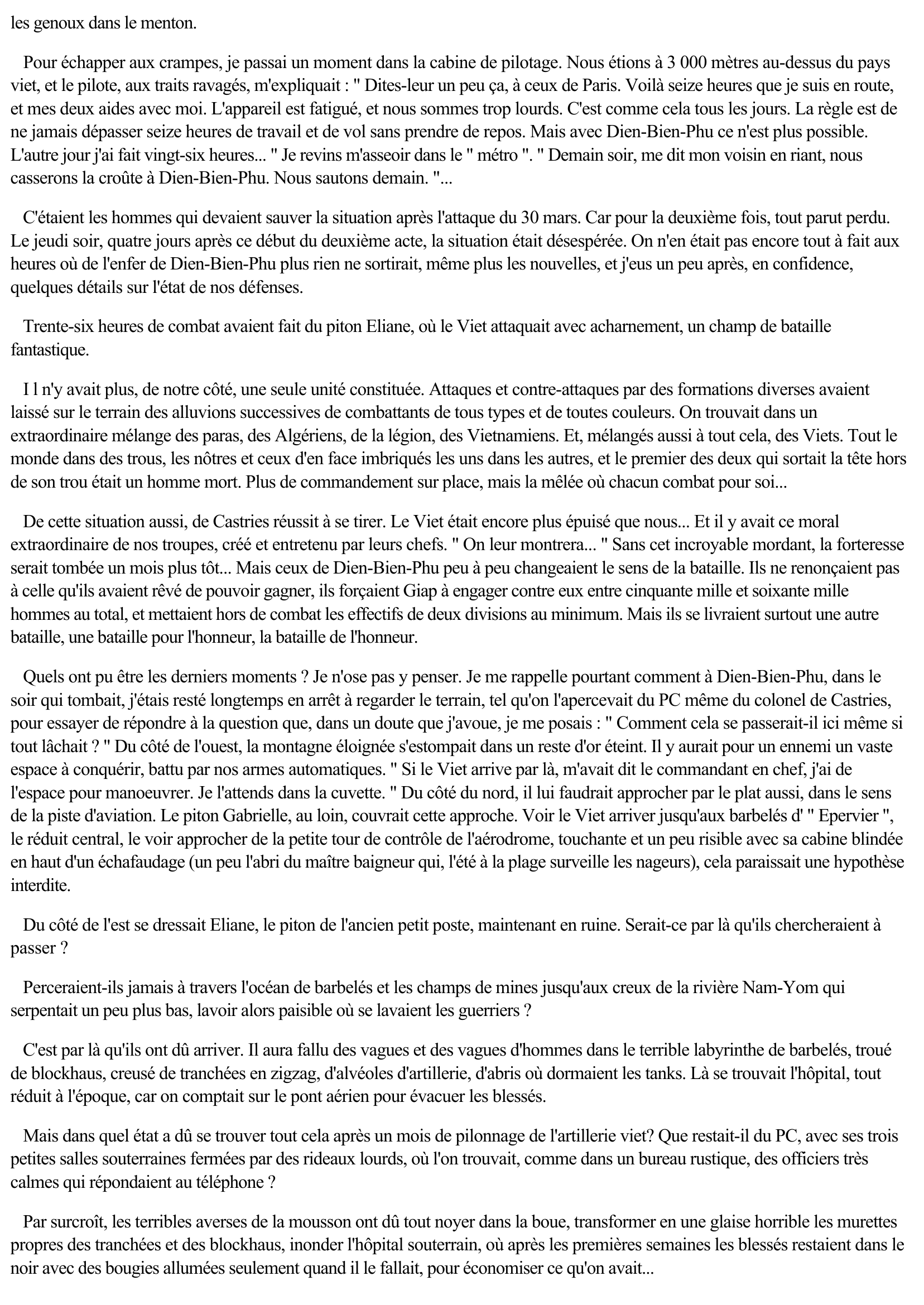Dien-Bien-Phu : pour l'honneur
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
«
les genoux dans le menton.
Pour échapper aux crampes, je passai un moment dans la cabine de pilotage.
Nous étions à 3 000 mètres au-dessus du paysviet, et le pilote, aux traits ravagés, m'expliquait : " Dites-leur un peu ça, à ceux de Paris.
Voilà seize heures que je suis en route,et mes deux aides avec moi.
L'appareil est fatigué, et nous sommes trop lourds.
C'est comme cela tous les jours.
La règle est dene jamais dépasser seize heures de travail et de vol sans prendre de repos.
Mais avec Dien-Bien-Phu ce n'est plus possible.L'autre jour j'ai fait vingt-six heures...
" Je revins m'asseoir dans le " métro ".
" Demain soir, me dit mon voisin en riant, nouscasserons la croûte à Dien-Bien-Phu.
Nous sautons demain.
"...
C'étaient les hommes qui devaient sauver la situation après l'attaque du 30 mars.
Car pour la deuxième fois, tout parut perdu.Le jeudi soir, quatre jours après ce début du deuxième acte, la situation était désespérée.
On n'en était pas encore tout à fait auxheures où de l'enfer de Dien-Bien-Phu plus rien ne sortirait, même plus les nouvelles, et j'eus un peu après, en confidence,quelques détails sur l'état de nos défenses.
Trente-six heures de combat avaient fait du piton Eliane, où le Viet attaquait avec acharnement, un champ de bataillefantastique.
I l n'y avait plus, de notre côté, une seule unité constituée.
Attaques et contre-attaques par des formations diverses avaientlaissé sur le terrain des alluvions successives de combattants de tous types et de toutes couleurs.
On trouvait dans unextraordinaire mélange des paras, des Algériens, de la légion, des Vietnamiens.
Et, mélangés aussi à tout cela, des Viets.
Tout lemonde dans des trous, les nôtres et ceux d'en face imbriqués les uns dans les autres, et le premier des deux qui sortait la tête horsde son trou était un homme mort.
Plus de commandement sur place, mais la mêlée où chacun combat pour soi...
De cette situation aussi, de Castries réussit à se tirer.
Le Viet était encore plus épuisé que nous...
Et il y avait ce moralextraordinaire de nos troupes, créé et entretenu par leurs chefs.
" On leur montrera...
" Sans cet incroyable mordant, la forteresseserait tombée un mois plus tôt...
Mais ceux de Dien-Bien-Phu peu à peu changeaient le sens de la bataille.
Ils ne renonçaient pasà celle qu'ils avaient rêvé de pouvoir gagner, ils forçaient Giap à engager contre eux entre cinquante mille et soixante millehommes au total, et mettaient hors de combat les effectifs de deux divisions au minimum.
Mais ils se livraient surtout une autrebataille, une bataille pour l'honneur, la bataille de l'honneur.
Quels ont pu être les derniers moments ? Je n'ose pas y penser.
Je me rappelle pourtant comment à Dien-Bien-Phu, dans lesoir qui tombait, j'étais resté longtemps en arrêt à regarder le terrain, tel qu'on l'apercevait du PC même du colonel de Castries,pour essayer de répondre à la question que, dans un doute que j'avoue, je me posais : " Comment cela se passerait-il ici même sitout lâchait ? " Du côté de l'ouest, la montagne éloignée s'estompait dans un reste d'or éteint.
Il y aurait pour un ennemi un vasteespace à conquérir, battu par nos armes automatiques.
" Si le Viet arrive par là, m'avait dit le commandant en chef, j'ai del'espace pour manoeuvrer.
Je l'attends dans la cuvette.
" Du côté du nord, il lui faudrait approcher par le plat aussi, dans le sensde la piste d'aviation.
Le piton Gabrielle, au loin, couvrait cette approche.
Voir le Viet arriver jusqu'aux barbelés d' " Epervier ",le réduit central, le voir approcher de la petite tour de contrôle de l'aérodrome, touchante et un peu risible avec sa cabine blindéeen haut d'un échafaudage (un peu l'abri du maître baigneur qui, l'été à la plage surveille les nageurs), cela paraissait une hypothèseinterdite.
Du côté de l'est se dressait Eliane, le piton de l'ancien petit poste, maintenant en ruine.
Serait-ce par là qu'ils chercheraient àpasser ?
Perceraient-ils jamais à travers l'océan de barbelés et les champs de mines jusqu'aux creux de la rivière Nam-Yom quiserpentait un peu plus bas, lavoir alors paisible où se lavaient les guerriers ?
C'est par là qu'ils ont dû arriver.
Il aura fallu des vagues et des vagues d'hommes dans le terrible labyrinthe de barbelés, trouéde blockhaus, creusé de tranchées en zigzag, d'alvéoles d'artillerie, d'abris où dormaient les tanks.
Là se trouvait l'hôpital, toutréduit à l'époque, car on comptait sur le pont aérien pour évacuer les blessés.
Mais dans quel état a dû se trouver tout cela après un mois de pilonnage de l'artillerie viet? Que restait-il du PC, avec ses troispetites salles souterraines fermées par des rideaux lourds, où l'on trouvait, comme dans un bureau rustique, des officiers trèscalmes qui répondaient au téléphone ?
Par surcroît, les terribles averses de la mousson ont dû tout noyer dans la boue, transformer en une glaise horrible les murettespropres des tranchées et des blockhaus, inonder l'hôpital souterrain, où après les premières semaines les blessés restaient dans lenoir avec des bougies allumées seulement quand il le fallait, pour économiser ce qu'on avait....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DIEN BIEN PHU (histoire).
- DIEN BIEN PHU (bataille de)
- DIEN BIEN PHU
- 1954 Dien Bien Phu (Photographie)
- Général CORNIGLION-MOLINIER: Dien-Bien-Phu ? un aérodrome qui se trouverait au Champ-de-Mars alors que l’ennemi occuperait la colline de Chaillot