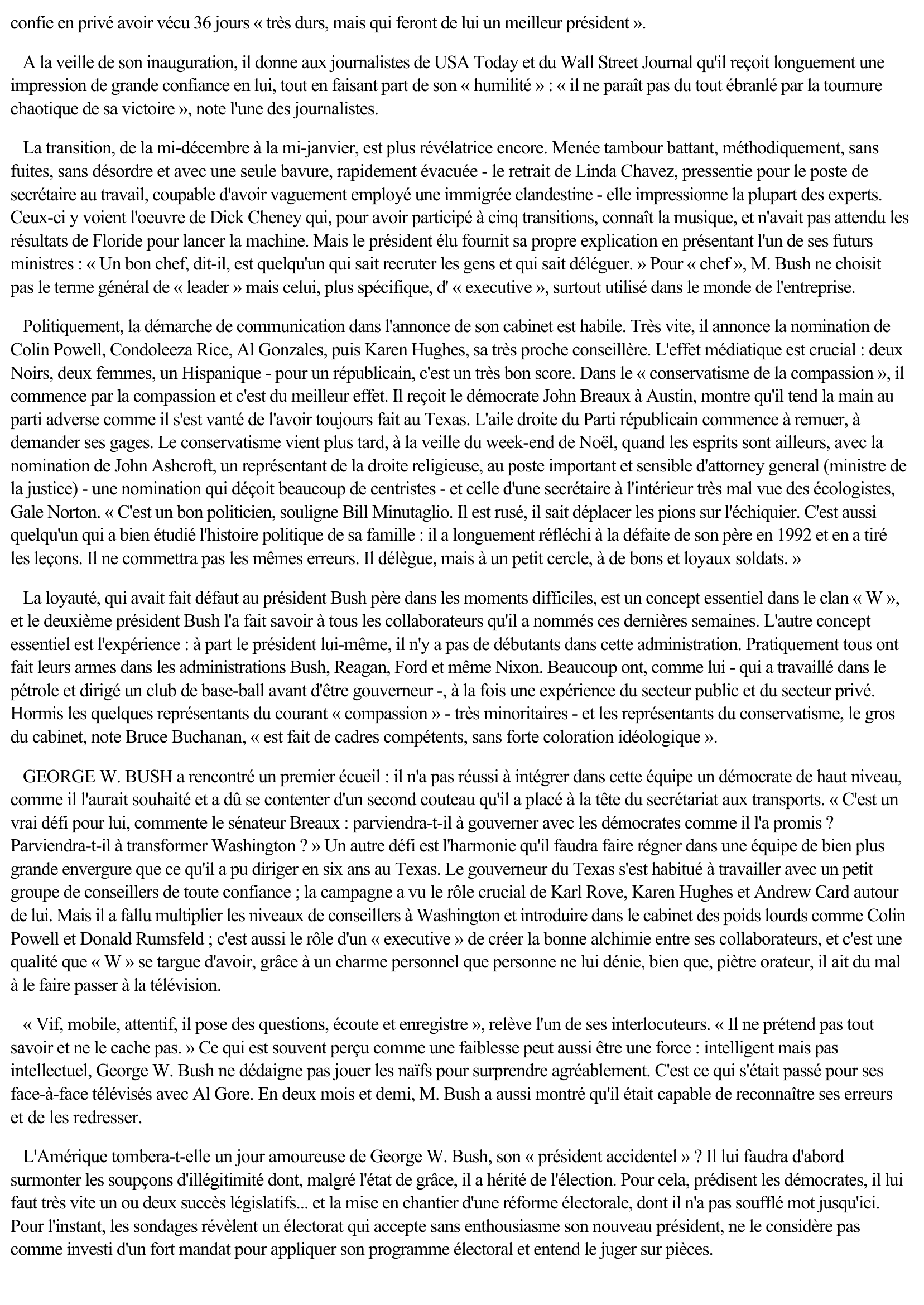George W. Bush, PDG de l'Amérique
Publié le 17/01/2022

Extrait du document


«
confie en privé avoir vécu 36 jours « très durs, mais qui feront de lui un meilleur président ».
A la veille de son inauguration, il donne aux journalistes de USA Today et du Wall Street Journal qu'il reçoit longuement uneimpression de grande confiance en lui, tout en faisant part de son « humilité » : « il ne paraît pas du tout ébranlé par la tournurechaotique de sa victoire », note l'une des journalistes.
La transition, de la mi-décembre à la mi-janvier, est plus révélatrice encore.
Menée tambour battant, méthodiquement, sansfuites, sans désordre et avec une seule bavure, rapidement évacuée - le retrait de Linda Chavez, pressentie pour le poste desecrétaire au travail, coupable d'avoir vaguement employé une immigrée clandestine - elle impressionne la plupart des experts.Ceux-ci y voient l'oeuvre de Dick Cheney qui, pour avoir participé à cinq transitions, connaît la musique, et n'avait pas attendu lesrésultats de Floride pour lancer la machine.
Mais le président élu fournit sa propre explication en présentant l'un de ses futursministres : « Un bon chef, dit-il, est quelqu'un qui sait recruter les gens et qui sait déléguer.
» Pour « chef », M.
Bush ne choisitpas le terme général de « leader » mais celui, plus spécifique, d' « executive », surtout utilisé dans le monde de l'entreprise.
Politiquement, la démarche de communication dans l'annonce de son cabinet est habile.
Très vite, il annonce la nomination deColin Powell, Condoleeza Rice, Al Gonzales, puis Karen Hughes, sa très proche conseillère.
L'effet médiatique est crucial : deuxNoirs, deux femmes, un Hispanique - pour un républicain, c'est un très bon score.
Dans le « conservatisme de la compassion », ilcommence par la compassion et c'est du meilleur effet.
Il reçoit le démocrate John Breaux à Austin, montre qu'il tend la main auparti adverse comme il s'est vanté de l'avoir toujours fait au Texas.
L'aile droite du Parti républicain commence à remuer, àdemander ses gages.
Le conservatisme vient plus tard, à la veille du week-end de Noël, quand les esprits sont ailleurs, avec lanomination de John Ashcroft, un représentant de la droite religieuse, au poste important et sensible d'attorney general (ministre dela justice) - une nomination qui déçoit beaucoup de centristes - et celle d'une secrétaire à l'intérieur très mal vue des écologistes,Gale Norton.
« C'est un bon politicien, souligne Bill Minutaglio.
Il est rusé, il sait déplacer les pions sur l'échiquier.
C'est aussiquelqu'un qui a bien étudié l'histoire politique de sa famille : il a longuement réfléchi à la défaite de son père en 1992 et en a tiréles leçons.
Il ne commettra pas les mêmes erreurs.
Il délègue, mais à un petit cercle, à de bons et loyaux soldats.
»
La loyauté, qui avait fait défaut au président Bush père dans les moments difficiles, est un concept essentiel dans le clan « W »,et le deuxième président Bush l'a fait savoir à tous les collaborateurs qu'il a nommés ces dernières semaines.
L'autre conceptessentiel est l'expérience : à part le président lui-même, il n'y a pas de débutants dans cette administration.
Pratiquement tous ontfait leurs armes dans les administrations Bush, Reagan, Ford et même Nixon.
Beaucoup ont, comme lui - qui a travaillé dans lepétrole et dirigé un club de base-ball avant d'être gouverneur -, à la fois une expérience du secteur public et du secteur privé.Hormis les quelques représentants du courant « compassion » - très minoritaires - et les représentants du conservatisme, le grosdu cabinet, note Bruce Buchanan, « est fait de cadres compétents, sans forte coloration idéologique ».
GEORGE W.
BUSH a rencontré un premier écueil : il n'a pas réussi à intégrer dans cette équipe un démocrate de haut niveau,comme il l'aurait souhaité et a dû se contenter d'un second couteau qu'il a placé à la tête du secrétariat aux transports.
« C'est unvrai défi pour lui, commente le sénateur Breaux : parviendra-t-il à gouverner avec les démocrates comme il l'a promis ?Parviendra-t-il à transformer Washington ? » Un autre défi est l'harmonie qu'il faudra faire régner dans une équipe de bien plusgrande envergure que ce qu'il a pu diriger en six ans au Texas.
Le gouverneur du Texas s'est habitué à travailler avec un petitgroupe de conseillers de toute confiance ; la campagne a vu le rôle crucial de Karl Rove, Karen Hughes et Andrew Card autourde lui.
Mais il a fallu multiplier les niveaux de conseillers à Washington et introduire dans le cabinet des poids lourds comme ColinPowell et Donald Rumsfeld ; c'est aussi le rôle d'un « executive » de créer la bonne alchimie entre ses collaborateurs, et c'est unequalité que « W » se targue d'avoir, grâce à un charme personnel que personne ne lui dénie, bien que, piètre orateur, il ait du malà le faire passer à la télévision.
« Vif, mobile, attentif, il pose des questions, écoute et enregistre », relève l'un de ses interlocuteurs.
« Il ne prétend pas toutsavoir et ne le cache pas.
» Ce qui est souvent perçu comme une faiblesse peut aussi être une force : intelligent mais pasintellectuel, George W.
Bush ne dédaigne pas jouer les naïfs pour surprendre agréablement.
C'est ce qui s'était passé pour sesface-à-face télévisés avec Al Gore.
En deux mois et demi, M.
Bush a aussi montré qu'il était capable de reconnaître ses erreurset de les redresser.
L'Amérique tombera-t-elle un jour amoureuse de George W.
Bush, son « président accidentel » ? Il lui faudra d'abordsurmonter les soupçons d'illégitimité dont, malgré l'état de grâce, il a hérité de l'élection.
Pour cela, prédisent les démocrates, il luifaut très vite un ou deux succès législatifs...
et la mise en chantier d'une réforme électorale, dont il n'a pas soufflé mot jusqu'ici.Pour l'instant, les sondages révèlent un électorat qui accepte sans enthousiasme son nouveau président, ne le considère pascomme investi d'un fort mandat pour appliquer son programme électoral et entend le juger sur pièces..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Bush, George W.
- George Herbert Walker Bush.
- George Bush.
- George Herbert Walker Bush - USA History.
- George Bush - USA History.