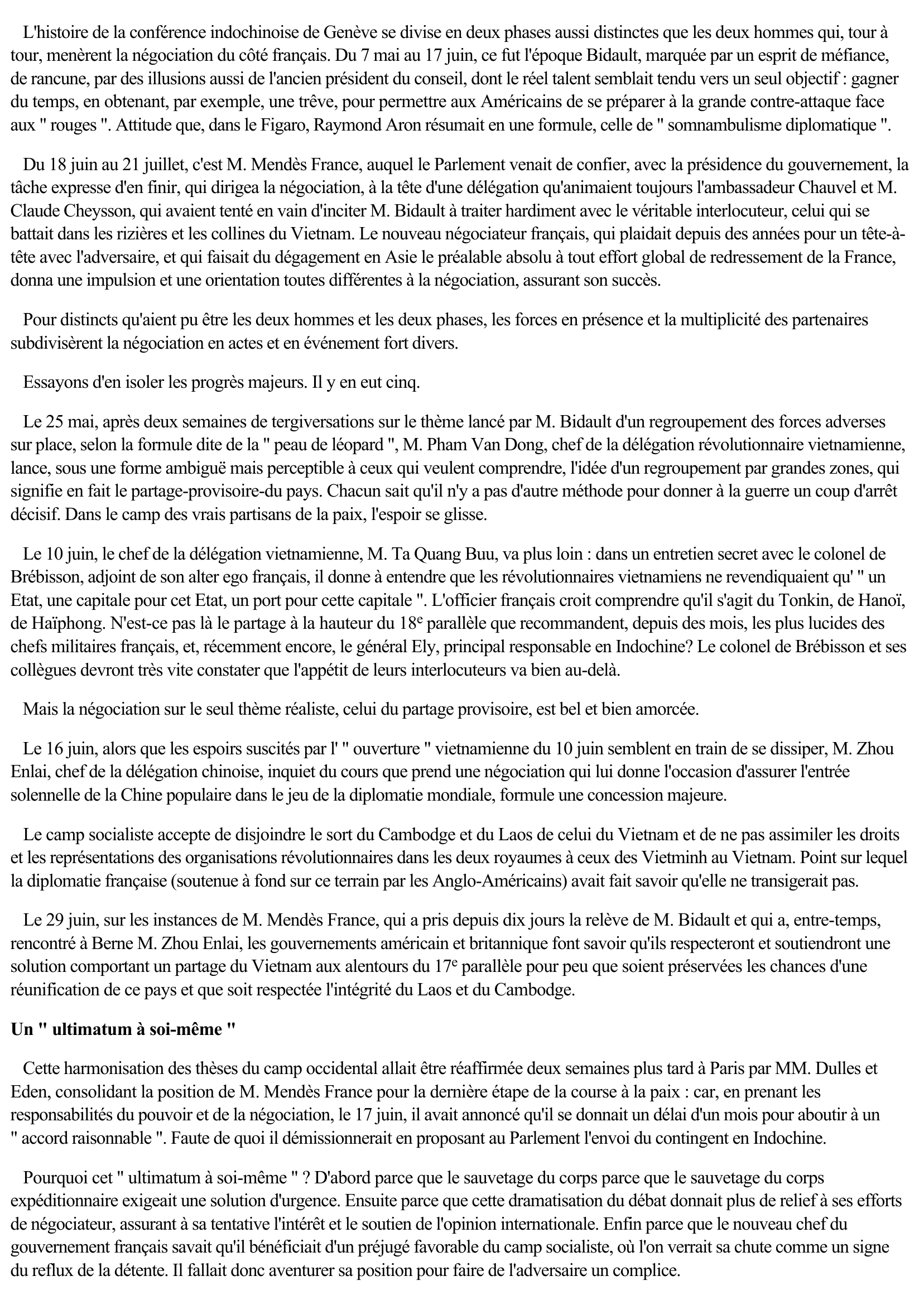Les accords de Genève
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
«
L'histoire de la conférence indochinoise de Genève se divise en deux phases aussi distinctes que les deux hommes qui, tour àtour, menèrent la négociation du côté français.
Du 7 mai au 17 juin, ce fut l'époque Bidault, marquée par un esprit de méfiance,de rancune, par des illusions aussi de l'ancien président du conseil, dont le réel talent semblait tendu vers un seul objectif : gagnerdu temps, en obtenant, par exemple, une trêve, pour permettre aux Américains de se préparer à la grande contre-attaque faceaux " rouges ".
Attitude que, dans le Figaro, Raymond Aron résumait en une formule, celle de " somnambulisme diplomatique ".
Du 18 juin au 21 juillet, c'est M.
Mendès France, auquel le Parlement venait de confier, avec la présidence du gouvernement, latâche expresse d'en finir, qui dirigea la négociation, à la tête d'une délégation qu'animaient toujours l'ambassadeur Chauvel et M.Claude Cheysson, qui avaient tenté en vain d'inciter M.
Bidault à traiter hardiment avec le véritable interlocuteur, celui qui sebattait dans les rizières et les collines du Vietnam.
Le nouveau négociateur français, qui plaidait depuis des années pour un tête-à-tête avec l'adversaire, et qui faisait du dégagement en Asie le préalable absolu à tout effort global de redressement de la France,donna une impulsion et une orientation toutes différentes à la négociation, assurant son succès.
Pour distincts qu'aient pu être les deux hommes et les deux phases, les forces en présence et la multiplicité des partenairessubdivisèrent la négociation en actes et en événement fort divers.
Essayons d'en isoler les progrès majeurs.
Il y en eut cinq.
Le 25 mai, après deux semaines de tergiversations sur le thème lancé par M.
Bidault d'un regroupement des forces adversessur place, selon la formule dite de la " peau de léopard ", M.
Pham Van Dong, chef de la délégation révolutionnaire vietnamienne,lance, sous une forme ambiguë mais perceptible à ceux qui veulent comprendre, l'idée d'un regroupement par grandes zones, quisignifie en fait le partage-provisoire-du pays.
Chacun sait qu'il n'y a pas d'autre méthode pour donner à la guerre un coup d'arrêtdécisif.
Dans le camp des vrais partisans de la paix, l'espoir se glisse.
Le 10 juin, le chef de la délégation vietnamienne, M.
Ta Quang Buu, va plus loin : dans un entretien secret avec le colonel deBrébisson, adjoint de son alter ego français, il donne à entendre que les révolutionnaires vietnamiens ne revendiquaient qu' " unEtat, une capitale pour cet Etat, un port pour cette capitale ".
L'officier français croit comprendre qu'il s'agit du Tonkin, de Hanoï,de Haïphong.
N'est-ce pas là le partage à la hauteur du 18 e parallèle que recommandent, depuis des mois, les plus lucides des chefs militaires français, et, récemment encore, le général Ely, principal responsable en Indochine? Le colonel de Brébisson et sescollègues devront très vite constater que l'appétit de leurs interlocuteurs va bien au-delà.
Mais la négociation sur le seul thème réaliste, celui du partage provisoire, est bel et bien amorcée.
Le 16 juin, alors que les espoirs suscités par l' " ouverture " vietnamienne du 10 juin semblent en train de se dissiper, M.
ZhouEnlai, chef de la délégation chinoise, inquiet du cours que prend une négociation qui lui donne l'occasion d'assurer l'entréesolennelle de la Chine populaire dans le jeu de la diplomatie mondiale, formule une concession majeure.
Le camp socialiste accepte de disjoindre le sort du Cambodge et du Laos de celui du Vietnam et de ne pas assimiler les droitset les représentations des organisations révolutionnaires dans les deux royaumes à ceux des Vietminh au Vietnam.
Point sur lequella diplomatie française (soutenue à fond sur ce terrain par les Anglo-Américains) avait fait savoir qu'elle ne transigerait pas.
Le 29 juin, sur les instances de M.
Mendès France, qui a pris depuis dix jours la relève de M.
Bidault et qui a, entre-temps,rencontré à Berne M.
Zhou Enlai, les gouvernements américain et britannique font savoir qu'ils respecteront et soutiendront unesolution comportant un partage du Vietnam aux alentours du 17 e parallèle pour peu que soient préservées les chances d'une réunification de ce pays et que soit respectée l'intégrité du Laos et du Cambodge.
Un " ultimatum à soi-même "
Cette harmonisation des thèses du camp occidental allait être réaffirmée deux semaines plus tard à Paris par MM.
Dulles etEden, consolidant la position de M.
Mendès France pour la dernière étape de la course à la paix : car, en prenant lesresponsabilités du pouvoir et de la négociation, le 17 juin, il avait annoncé qu'il se donnait un délai d'un mois pour aboutir à un" accord raisonnable ".
Faute de quoi il démissionnerait en proposant au Parlement l'envoi du contingent en Indochine.
Pourquoi cet " ultimatum à soi-même " ? D'abord parce que le sauvetage du corps parce que le sauvetage du corpsexpéditionnaire exigeait une solution d'urgence.
Ensuite parce que cette dramatisation du débat donnait plus de relief à ses effortsde négociateur, assurant à sa tentative l'intérêt et le soutien de l'opinion internationale.
Enfin parce que le nouveau chef dugouvernement français savait qu'il bénéficiait d'un préjugé favorable du camp socialiste, où l'on verrait sa chute comme un signedu reflux de la détente.
Il fallait donc aventurer sa position pour faire de l'adversaire un complice..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pierre Mendès France: L'homme des accords de Genève
- Les accords de Genève.
- GENÈVE (accords de)
- Genève (Accords de)
- Les accords de Genève