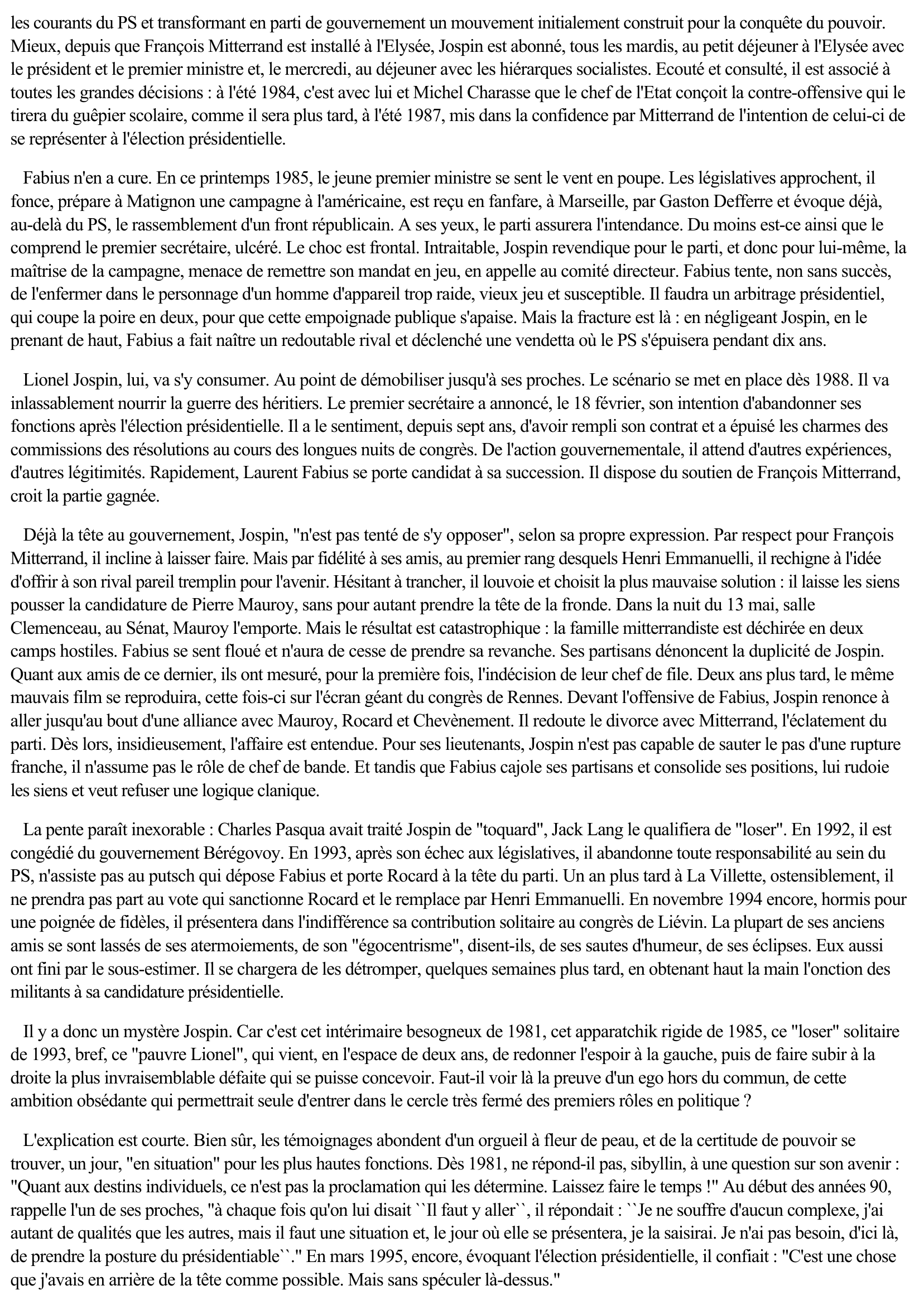Lionel Jospin, l'homme que l'on n'attendait pas
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
«
les courants du PS et transformant en parti de gouvernement un mouvement initialement construit pour la conquête du pouvoir.Mieux, depuis que François Mitterrand est installé à l'Elysée, Jospin est abonné, tous les mardis, au petit déjeuner à l'Elysée avecle président et le premier ministre et, le mercredi, au déjeuner avec les hiérarques socialistes.
Ecouté et consulté, il est associé àtoutes les grandes décisions : à l'été 1984, c'est avec lui et Michel Charasse que le chef de l'Etat conçoit la contre-offensive qui letirera du guêpier scolaire, comme il sera plus tard, à l'été 1987, mis dans la confidence par Mitterrand de l'intention de celui-ci dese représenter à l'élection présidentielle.
Fabius n'en a cure.
En ce printemps 1985, le jeune premier ministre se sent le vent en poupe.
Les législatives approchent, ilfonce, prépare à Matignon une campagne à l'américaine, est reçu en fanfare, à Marseille, par Gaston Defferre et évoque déjà,au-delà du PS, le rassemblement d'un front républicain.
A ses yeux, le parti assurera l'intendance.
Du moins est-ce ainsi que lecomprend le premier secrétaire, ulcéré.
Le choc est frontal.
Intraitable, Jospin revendique pour le parti, et donc pour lui-même, lamaîtrise de la campagne, menace de remettre son mandat en jeu, en appelle au comité directeur.
Fabius tente, non sans succès,de l'enfermer dans le personnage d'un homme d'appareil trop raide, vieux jeu et susceptible.
Il faudra un arbitrage présidentiel,qui coupe la poire en deux, pour que cette empoignade publique s'apaise.
Mais la fracture est là : en négligeant Jospin, en leprenant de haut, Fabius a fait naître un redoutable rival et déclenché une vendetta où le PS s'épuisera pendant dix ans.
Lionel Jospin, lui, va s'y consumer.
Au point de démobiliser jusqu'à ses proches.
Le scénario se met en place dès 1988.
Il vainlassablement nourrir la guerre des héritiers.
Le premier secrétaire a annoncé, le 18 février, son intention d'abandonner sesfonctions après l'élection présidentielle.
Il a le sentiment, depuis sept ans, d'avoir rempli son contrat et a épuisé les charmes descommissions des résolutions au cours des longues nuits de congrès.
De l'action gouvernementale, il attend d'autres expériences,d'autres légitimités.
Rapidement, Laurent Fabius se porte candidat à sa succession.
Il dispose du soutien de François Mitterrand,croit la partie gagnée.
Déjà la tête au gouvernement, Jospin, "n'est pas tenté de s'y opposer", selon sa propre expression.
Par respect pour FrançoisMitterrand, il incline à laisser faire.
Mais par fidélité à ses amis, au premier rang desquels Henri Emmanuelli, il rechigne à l'idéed'offrir à son rival pareil tremplin pour l'avenir.
Hésitant à trancher, il louvoie et choisit la plus mauvaise solution : il laisse les sienspousser la candidature de Pierre Mauroy, sans pour autant prendre la tête de la fronde.
Dans la nuit du 13 mai, salleClemenceau, au Sénat, Mauroy l'emporte.
Mais le résultat est catastrophique : la famille mitterrandiste est déchirée en deuxcamps hostiles.
Fabius se sent floué et n'aura de cesse de prendre sa revanche.
Ses partisans dénoncent la duplicité de Jospin.Quant aux amis de ce dernier, ils ont mesuré, pour la première fois, l'indécision de leur chef de file.
Deux ans plus tard, le mêmemauvais film se reproduira, cette fois-ci sur l'écran géant du congrès de Rennes.
Devant l'offensive de Fabius, Jospin renonce àaller jusqu'au bout d'une alliance avec Mauroy, Rocard et Chevènement.
Il redoute le divorce avec Mitterrand, l'éclatement duparti.
Dès lors, insidieusement, l'affaire est entendue.
Pour ses lieutenants, Jospin n'est pas capable de sauter le pas d'une rupturefranche, il n'assume pas le rôle de chef de bande.
Et tandis que Fabius cajole ses partisans et consolide ses positions, lui rudoieles siens et veut refuser une logique clanique.
La pente paraît inexorable : Charles Pasqua avait traité Jospin de "toquard", Jack Lang le qualifiera de "loser".
En 1992, il estcongédié du gouvernement Bérégovoy.
En 1993, après son échec aux législatives, il abandonne toute responsabilité au sein duPS, n'assiste pas au putsch qui dépose Fabius et porte Rocard à la tête du parti.
Un an plus tard à La Villette, ostensiblement, ilne prendra pas part au vote qui sanctionne Rocard et le remplace par Henri Emmanuelli.
En novembre 1994 encore, hormis pourune poignée de fidèles, il présentera dans l'indifférence sa contribution solitaire au congrès de Liévin.
La plupart de ses anciensamis se sont lassés de ses atermoiements, de son "égocentrisme", disent-ils, de ses sautes d'humeur, de ses éclipses.
Eux aussiont fini par le sous-estimer.
Il se chargera de les détromper, quelques semaines plus tard, en obtenant haut la main l'onction desmilitants à sa candidature présidentielle.
Il y a donc un mystère Jospin.
Car c'est cet intérimaire besogneux de 1981, cet apparatchik rigide de 1985, ce "loser" solitairede 1993, bref, ce "pauvre Lionel", qui vient, en l'espace de deux ans, de redonner l'espoir à la gauche, puis de faire subir à ladroite la plus invraisemblable défaite qui se puisse concevoir.
Faut-il voir là la preuve d'un ego hors du commun, de cetteambition obsédante qui permettrait seule d'entrer dans le cercle très fermé des premiers rôles en politique ?
L'explication est courte.
Bien sûr, les témoignages abondent d'un orgueil à fleur de peau, et de la certitude de pouvoir setrouver, un jour, "en situation" pour les plus hautes fonctions.
Dès 1981, ne répond-il pas, sibyllin, à une question sur son avenir :"Quant aux destins individuels, ce n'est pas la proclamation qui les détermine.
Laissez faire le temps !" Au début des années 90,rappelle l'un de ses proches, "à chaque fois qu'on lui disait ``Il faut y aller``, il répondait : ``Je ne souffre d'aucun complexe, j'aiautant de qualités que les autres, mais il faut une situation et, le jour où elle se présentera, je la saisirai.
Je n'ai pas besoin, d'ici là,de prendre la posture du présidentiable``." En mars 1995, encore, évoquant l'élection présidentielle, il confiait : "C'est une choseque j'avais en arrière de la tête comme possible.
Mais sans spéculer là-dessus.".
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Devoir maison d'Histoire: La rafle du Vel d'hiv et le discours de Lionel Jospin en 1997 (histoire)
- JOSPIN, Lionel (né en 1937) Enarque et professeur d'économie, il est secrétaire général du PS sous le premier septennat de François Mitterrand et ministre de l'Education sous le second (1988-1992).
- JOSPIN, Lionel (né en 1937) Enarque et professeur d'économie, il est secrétaire général du PS sous le premier septennat de François Mitterrand et ministre de l'Education sous le second (1988-1992).
- 1997: Lionel Jospin, Premier ministre d'un président de droite
- La cohabitation n'est pas un bon système dans la durée - Lionel Jospin